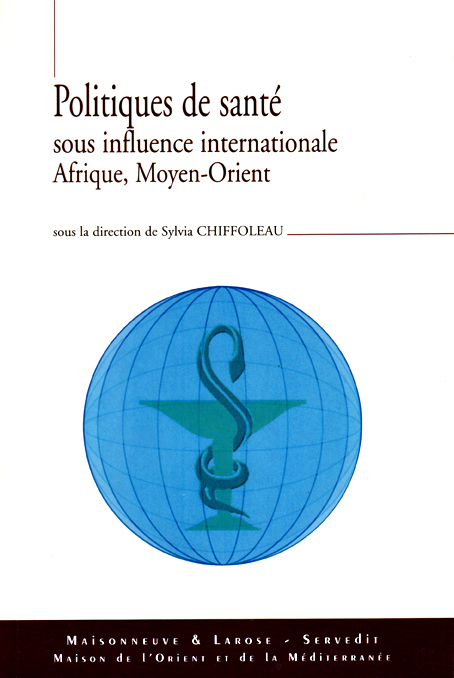
Sida, fièvre Ébola, SARS… Après une période dominée par la conviction que la science et la rationalité des comportements individuels et collectifs conduiraient à une éradication des maladies, les agents pathogènes ne cessent de nous rappeler aujourd’hui leur puissance et leur imprévisibilité. Dans un monde de plus en plus global et interdépendant, les maladies transmissibles renvoient aux dimensions collectives de la santé et à la nécessité d'assurer la protection de l'ensemble de la communauté.
Dans un contexte où, d’une part, les pays en développement n’ont plus les moyens d’assurer pleinement leur vocation sociale, et où, d’autre part, les agences internationales investissent le champ de la santé, la définition des politiques publiques de santé est de plus en plus perméable aux influences internationales. Elle s’inscrit désormais dans un système d'acteurs très largement renouvelé. Les États, soumis à une remise en cause profonde de leur rôle traditionnel, négocient avec divers intervenants, notamment les organisations internationales et les ONG, des réformes qui demeurent malheureusement trop souvent inadaptées aux spécificités locales.
Tout en analysant ces nouvelles configurations, cet ouvrage offre une dynamique de comparaison inédite entre deux régions, l’Afrique et le Moyen-Orient, à la fois proches, par bien des aspects de leurs systèmes de santé, et différentes, notamment dans leur degré de dépendance à l'égard des instances internationales. Les textes réunis ici s'appuient sur une connaissance approfondie des terrains abordés et proposent, au-delà des études de cas, des pistes visant à améliorer les procédures de coopération et d'action collective en matière de santé internationale.
Chiffoleau S.
Introduction. Politiques de santé sous influence internationale. Acteurs et processus
Les cadres de l’action : des modèles et des agendas en évolution
Tizio S.
Participation communautaire et rôle de l’État dans les politiques de santé. Quand un dogme chasse l’autre
Dejong J.
La santé reproductive au Moyen-Orient : un programme d'action défini au niveau international ?
Inadaptations et dysfonctionnements : les avatars de l’internationalisation des politiques de santé
Dibakana J.-A.
Les paradoxes de l’internationalisation des politiques de santé en Afrique subsaharienne. L’exemple du Congo
Gauvrit É.
Les tendances schizophréniques des réformes des politiques de santé en Afrique centrale
Boukhaïma S.
Le système de santé syrien : des réformes nécessaires dans un environnement contraignant
Karamé C.
La santé dans les Territoires palestiniens : entre persistance du conflit, relations infra-palestiniennes et surenchère des bailleurs de fonds internationaux
La part croissante des Églises et des ONG dans le champ de la santé
Flori Y.-A.
La contractualisation avec les bailleurs de fonds : vers une perte de spécificité des ONG ?
Gruénais M.-É.
La séparation de l’Église et de l’État et la réforme du système de santé au Cameroun
Ryfman P.
Une forme inédite de recomposition, ou comment des ONG réussissent là où des États échouent : l’accès aux médicaments essentiels des populations du Sud
Les réformes sectorielles : de la décision à la mise en œuvre locale
Chiffoleau S.
La réforme du système de santé égyptien : un nouveau type de processus politique entre logique internationale et enjeux nationaux
Destremau B.
L’exemption du coût des soins et l’accès des plus pauvres à la santé dans le cadre de la réforme du secteur de la santé au Yémen
Goulesque B.
Le rôle d’une ONG internationale (MSF) dans le cadre de la réforme du secteur de la santé au Yémen : bilan et perspectives du système d’exemption à Aden

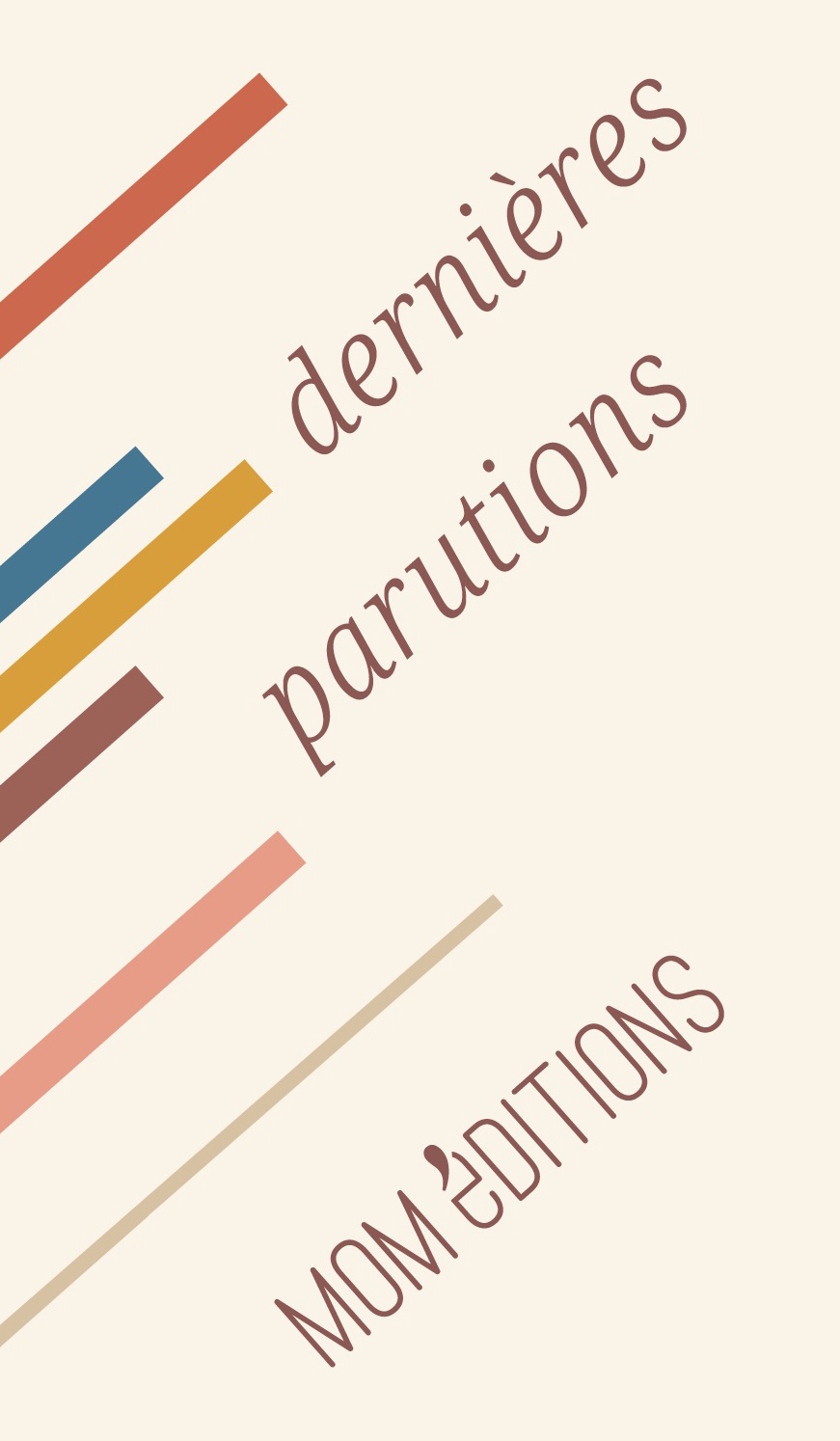 La
La 
















