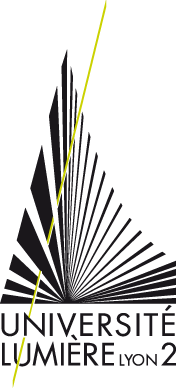Cote conservation : F/17/17258 / Document original conservé aux Archives Nationales, Paris.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE.
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
RECHERCHES SCIENTIFIQUES EN IRAN.
MISSION DE SUSIANE.
CAMPAGNE DE FOUILLES -1939 –
RAPPORT DE MISSION.
La Mission comprenait cette saison, Mr. de Mecquenem, chargé des fouilles, le Docteur J. Unvala et Mr. Mustafavi (
pl.I
) ; ce dernier, sous-directeur du Service archéologique de l'Iran, a bien voulu, tout en exerçant son contrôle général, se charger de la direction d'un de nos chantiers ; il s'agissait pour nous suppléer à l'absence du professeur Hennequin, qui attendait à Jérusalem le visa d'entrée en Iran.
Les travaux de fouille ont été commencés à Tchogha Zembil le 6 Février et se sont terminés le 8 Mars ; ils ont commencé à Suse, le 11 Mars et se sont terminés le 15 Avril ; Un sondage a été repris à Tépé Bouhallan, le 9 Mars et a été abandonné le 4 Avril.
I- Travaux à Tchoga Zembil
A)-Ziggourat (
pl.II
)
Chantier No.1-A l’angle ouest, une équipe a trouvé la fin du dallage qui précédait le 1er degré. Il avait une largeur de 16m.40 à partir de ce degré, la tranchée a été terminée à une profondeur de 1m.40. (p.2)
Chantier No.2-Travaux sur la face sud-ouest de la tour.
La saison précédente, nous avions déblayé le parement du 5ème degré ; nous avions reconnu, au pied du mur de briques cuites, un dallage en carreaux, à la cote 46m,10. En suivant cette fois le dallage, nous avons trouvé qu’il était interrompu à 1m.5. Ayant enlevé à ce moment des déblais sur une épaisseur de 0m.,70 nous avons retrouvé la brique crue sur une largeur de 0m,90 ; au-delà , se présentait un massif de briques cuites qui se prolongeat(sic) presque jusqu’au parement du 4ème degré. La saignée pratiquée avait environ 1m,50 de largeur.
Un peu au sud-est de ce travail, dans un ravinement nous avons déblayé à nouveau, une longueur de 1m.50 du 5ème parement. À 2m. de ce déblaiement, toujours au sud-est, nous avons trouvé un massif de briques cuites (cote inférieure : 45m.,70) ; il semble que ce massif et le précédent représentent des restes de la tour primitive ; La distance entre les 4ème et 5ème parements est ici 3m.,75, alors que dans la saignée précédente, elle dépassait 4m.
Une saignée de 1m.40 de largeur a été pratiquée au-dessus du mur du 5ème degré ; à 5m.,80 en arrière de ce mur, nous avons rencontré la paroi verticale du noyau de la tour ; elle a été suivie sur une hauteur de 4m.40 ; au-dessus de ce niveau, les briques crues étaient surmontées d’une épaisseur de 1m. environ de déblais et l’on est au point culminant du tell. Il n’y a pas à douter que nous avons affaire au 6ème degré, dont le parement a disparu. À la cote 50m.37, le sol comprenait une largeur de 0m.56 de briques crues, puis , en avant de celles-ci, un dallage de briques cuites. Sur ce dallage, ) 1m.29 du mur, s’élevait un massif de briques cuites, de 1m.80 de largeur et haut de 0m.,80. Nous pensons cette fois, qu’il pourrait, ce massif, être l’indice d’un escalier.
(p.3) Chantier No.4 – Face nord-est de la tour.
La chambre qui avait été trouvée en saillie dans le 3ème degré, et à moitié explorée l’an dernier, a été complètement vidée. Elle mesurait 6m.,90 de longueur, avec une largeur de 2m.75. Le mur du sud-est, atteignait la cote 41m.63. Il avait une largeur de 0m.,73 ; en arrière nous avons trouvé à la même cote, un massif de briques crues, reconnu sur une largeur de 2m.,15. Dans les déblais qui le recouvraient, se trouvait une grande dalle en grès. (Lgr.1m.57-largeur maxima :0m.,66-Epaisseur :0m.,17-0m.,20). À l’une des extrémités, la plus large, se trouvait un trou transversal de 0m.,30 de diamètre, et la dalle avait ses angles arrondis ; l’autre extrémité, mois large et moins épaisse devait être prise dans un mur.
En descendant au fond de la chambre, nous avons constaté des traces de dallages successifs à différents niveaux, -38m.,82 -38m.,62-38m.,02- chacune d’eux était précédé d’une couche charbonneuse présentant sans doute des débris de la charpente du bois. Le dallage primitif encore bien conservé, fut trouvé à la cote 37,28. Il était traversé dans sa largeur par une canalisation de 0m.30 de profondeur. Les murs étaient assez mal conservés au-dessous de la cote 38,82 ; dans un trou au niveau du dallage supérieur, se trouvait un galet de pierre (longueur : 0m.88) ; une extrémité est pointue, l’autre arrondie, était percé d’un trou circulaire dans l’angle sud-est, il a été retrouvé deux yeux de verre.
En avant de la chambre se trouvait un couloir d’accès ; il avait 1m.50 de largeur sur une longueur de 1m.80 ; il s’élargit ensuite par deux décrochements ; à la cote 39,69, courait sur le mur une rangée de briques inscrites à 6 lignes : à la cote, 38,82, qui est celle du dallage supérieur trouvé dans la chambre, le mur du couloir n’est plus qu’en briques crues.
(p.4) La présence de déblais antérieurs nous a empêchés cette saison de dégager la sortie du couloir d’accès et de reconnaître la présence d’un escalier.
Une tranchée pratiquée aussi près que possible de l’axe de la face nord-est, a trouvé le dallage inférieur précédant le 1er degré, à environ 7m.50 en avant de ce degré et à une profondeur d’environ 4m.
B)- Travaux à l’intérieur de la première enceinte.
Chantier No.1-Ouest de la tour. (
pl. VII
)
Le couloir déblayé en fin de saison 1938, aboutissait à une salle dallée à peu près carrée de 4m.40 de côté. Une partie du mur, face au N-E, était en briques cuites ; deux rangées de briques, l’une à Om.,70 au-dessus du dallage, l’autre à 1m.53 étaient composées de briques inscrites à 4 lignes ; le mur, face au S-E, était en briques crues, sauf pour les rangées correspondant aux cotes précédemment données ; celles-ci étaient en briques cuites et inscrites. À la fin du couloir, reposait sur le sol une grande dalle carrée, de 0m.72 de côté et de 0m.04 à 0m.,06 d’épaisseur ; elle était presqu’entièrement faite d’émail à l’exception d’un très mince noyau de terre cuite jaune. Derrière le mur en briques cuites, nous avons trouvé des assises de briques, nous faisant penser à un escalier. Au sud-est de la salle, s’ouvrait un corridor, en partie dallé de briques émaillées de grandes dimensions et de fragments de ces mêmes briques. Ce couloir de 3m. de longueur aboutissait à un mur de briques cuites. Au-delà , fut suivi un dallage, long de 6m.90 depuis le mur. Un deuxième couloir, de direction S.O-N.E, aboutissait à la même salle ; il avait une longueur de 8m.10. A cette extrémité ; le dallage supérieur manque ; nous savons que le dallage des chambres (p.5) est composé de six dallages successifs. ; 0m., 63 plus bas se trouvait un autre dallage, dessinant une chambre au N.E ; cette chambre était voûtée en carreaux de briques cuites ; en son milieu se trouvait un pilier carré de 0m.70 de côté, construit en carreaux émaillés de 0m.,39 de côté et 0m.11 d’épaisseur (
pl. VI, 4
) ; et, des carreaux analogues de 0m.,30 de côté. Une des faces latérales est émaillée en vert ou bleu (?), l’autre, montre des bandes blanches dessinant des carrés bleu foncé, ou une suite de cercles dessinés en bleu sur fond blanc (
pl. IV,1
) , avec un centre circulaire bleu. Les dimensions du pilier sont à peu près les mêmes que celles de la grande dalle d’émail ou des grandes briques émaillées trouvées dans la salle carrée et son couloir ; il est possible qu’elles aient été destinées d’abord à former le dessus d’un pilier analogue. Au N.E. de cette chambre est au même niveau un couloir large d’un mètre dix, long de 2m.,85 ; il s’élargit ensuite sur une longueur de 1m.,50, au moins de 0m.65 ; dans ce couloir, nous avons trouvé de très nombreuses perles en verre longues de 0m.25 environ (
pl. VI,3
) ; une de leurs extrémités est coupée carrément l’autre s’effile progressivement. Nous avons déjà les saisons précédente, trouvé de ces perles ; l’an dernier, nous avions été fiers d’en reconstituer une dizaine d’entières ; cette fois nous en avons près de 300. Nous ne voyons pas d’autre utilisation à ces perles que d’en composer des stores pour des portes, ou des costumes pour des idoles. Mais il faut remarquer que ces perles n’ont pas été trouvées à leur place primitive ; elles ont été réemployées, sans doute comme fétiches d’une nouvelle construction. C’est à ce titre que nous les rencontrons dans les maisons, placées entre des briques, près des portes, le plus souvent et en général, il ne s’agit que de petits fragments.
(p6) Au nord-est de la salle carrée précédente, se trouvait un mur en briques crues, à deux rangées de briques inscrites à 4 lignes, tout pareil au mur de la salle carrée ; à sa base, il a été trouvé des yeux de verre et des perles en verre, et des fragments d’os qui nous ont fait penser à un tombeau ; ce mur est descendu jusqu’à un dallage, du même niveau que celui trouvé au sud-ouest et au sud.est de la salle carrée, soit 0m.,63 au-dessous du dallage courant. Ce dallage représente sans doute le sol des premières constructions élevées en cet endroit. La nécessité de conserver le monument, nous a empêché de rechercher le plan primitif.
Chantier No.2-Nord-est de la tour.
A partir d’une trentaine de mètres du 1er degré de la tour, nous avons déblayé des dallages très étendus et des fondations de murs à redans successifs. Ces dallages se sont beaucoup rapprochés du ravin qui suit à peu près la tour sur trois faces à une soixantaine de mètres du 1er degré. Le niveau de ces dallages est à la cote 35,20. Le dallage entourant immédiatement la tour est à la cote 34,54, donc plus bas de 0m,56. Il serait intéressant de savoir comment se fait le raccord.
Chantier No.3- Constructions du sud-est de la tour.
Le déblaiement de la construction trouvée la saison précédente contre le mur d’enceinte a été terminé ; Mr.Mustafavi a dirigé le déblaiement d’un nouvel ensemble de fondations, au sud-ouest de la précédente. Le plan de ce groupe nous dispense d’entrer dans les détails ; il s’agit de bâtiment secondaires hâtivement édifiés avec des matériaux arrachés à la tour et à ses annexes. Nous avons recueilli des briques inscrites, une pointe de lance en cuivre, un poids en pierre, une poignée ( ?) en pierre, ornée d’ (p.7) une tête de bélier. Nous avons recueilli quelques fragments de figurines et des vases de terre cuite. Nous avons reconnu des foyers et trouvé en place des pierres trouées pour recevoir les montants de battants de portes.
Chantier No.4-Première enceinte
Nous avons fait une coupure transverse dans le mur de la première enceinte, à peu près au milieu du côté de direction S.E-N.0 vers l’Ab é Diz. Nous avons rencontré un fragment de dallage en briques cuites, établi sur briques crues ; il avait 1m.30 de long. Le dallage est continué en briques crues sur 6m.50, le mur est alors apparent, s’élevant par marches ; il est conservé sur une hauteur de 2m. et une largeur de 5m. ; il finit verticalement sur le bord du ravin.
C)-Travaux en dehors de la première enceinte ;
Le déblaiement des constructions à l’est a été repris : ces maisons sont en général mieux bâties que celles de la 1ère enceinte ; il a été trouvé quelques fragments de vases en fritte (
pl. IX,2
) et des vases de terre cuite.
Un petit sondage a déblayé un grand vase dans lequel une canalisation en poterie amenait l’eau. Un autre a fourni les débris d’un grand carreau en terre cuite émaillée (
pl. IX,1
) ; au centre d’un cadre aux angles garnis de bossettes, s’élevait un gros bouton dont la tête portait encore un signe cunéiforme.
Conclusion
Le côté du 6ème degré de la ziggurat a encore ; celui d’un 7ème degré, avec les mêmes caractéristiques aurait 42 mètres ; nous sommes donc amenés à confirmer notre opinion d’une réfection de la tour à étages, ne tenant pas compte des deux premiers degrés, sans doute enfouis sous les décombres dès cette époque (p.8) : il est difficile d’admettre en effet que la plateforme terminant la tour à étage ait eu plus de 30 mètres de côté ; le 6ème degré actuel ne serait donc que le 4ème de la réfection ; la face sud-ouest de la tour est celle qui était la moins encombrée de déblais : la recherche des parements était plus facile ; il est possible que la face nord-est ou la face nord-ouest plus hautes fournissent une indication sur le degré suivant.
Les travaux sur la tour ont fourni des briques inscrites à 4,5,6,8 et 11 lignes, mais toutes les briques inscrites trouvées en place : chapelle et 2ème degré, étaient à 6 et 8 lignes. A part les deux briques sémitiques publiées par le R.P.Scheil dans son dernier volume de textes susiens, toutes les inscriptions sont en langue anzanites et connues de Suse même. Elles sont toutes du roi Untash-Gal.
Les constructions déblayées en avant de la face nord-ouest avaient été d’abord interprétées comme des caveaux funéraires ; ce sont plutôt des sanctuaires, aux diverses divinités énumérées sur les briques. Il ne se rencontre guère d’objets intéressants et nous n’avons cette année comme la précédente recueilli aucune tablette.
Les maisons explorées autour du monument ne donnent que des plans sans élévation, et ne fournissent elles aussi que de très rares objets. Devant ces résultats, nous proposons de ne consacrer aux fouilles de Tchogha Zembil, qu’une quinzaine de jours de travail pour recueillir les renseignements nécessaires à l’établissement du plan définitif et d’abandonner le site après avoir récupéré de notre maison, la grande porte et les charpentes. (p. 9)
II- Travaux à Suse
A) Acropole.
Chantier No. 2- Sud-est du tell (
pl.XI
)
Nous avons continué l'exploration de la couche la plus ancienne ; Mr. Mustafavi a surveillé ce chantier ; nous avons trouvé de nombreux fragments de poterie peinte, parmi lesquels notre inspecteur a trié de nouveaux sujets décoratifs ; il a pu reconstituer deux vases ; nous n'avons trouvé que deux petits vases complets ; il a été recueilli quelques figurines d'animaux et objets de pierre.
Chantier No.4
Ce travail a été gêné par les pluies et il a fallu vider l'eau qui avait envahi le sondage ; les ouvriers ont été déplacés plusieurs fois ; la tranchée commencée a été creusée dans toute sa longueur sur environ 1m. de profondeur ; elle est restée dans le niveau de 3.000 avant notre ère.
B) Ville Royale.
Chantier No.1 (
pl.XIV
)
À l'est du chantier, nous avons travaillé entre les niveaux 0 et -3. Nous sommes là dans un remblayage fait à l'époque néobabylonienne pour la construction d'un temple fouillé en 1924 ; nous avons déblayé un dallage carré (
pl. XIII,2
) ; une cuve carrée affleurait les briques. Il a été trouvé un cylindre en chalcédoine (
pl.XV,2
) , un peu écorné et de nombreux fragments de tablettes, généralement en très mauvais état, de nombreuses figurines de terre cuite (
pl.XV,1
), le plus souvent incomplètes. De l'époque élamite, nous avons déblayé un caveau voûté (L : 1m.,40 – l : 0m.,95 - hr. sous voûte 1m.) (
pl. XIII,3
) , précédé d'un puits d'accès devant la porte (dimensions du puits 1m.,25 - 0m.,95). Dans le puits, se trouvait un squelette ; près de lui, plateaux de balance (p. 10) et poids ; dans le tombeau, restes de cinq individus, vase de cuivre, vases de terre cuite ; 3 figurines de terre cuite entières. Notons encore quelques tombes élamites dans des jarres : un fragment de vase en bitume, décoré d'arrière-trains de béliers?
Dans la bordure nord du chantier, nous avons terminé le déblaiement de chambres en briques crues du XXIIIème avant notre ère. Nous avons dégagé plusieurs sarcophages des XXème et XXIIème siècles (
pl. XV,3
) . Au-dessous, nous avons trouvé quelques tombes du XXVème siècle, assez riches, avec armes et épingles de cuivre ; une tombe du 28ème siècle contenait 6 grands vases (
pl. XV,4
) , une écuelle d'aragonite, un tranchet, un miroir : malheureusement, la dureté du terrain rendait impossible l'extraction des vases.
Chantier No. 5.
Il s'agit de l'enlèvement de la couche superficielle (prof. max. 1m.,50), pour préparer un nouveau sondage au milieu du tell. Nous avons rencontré des maisons arabes, ruinées jusqu'au carrelage des pièces : elles se trouvent datées par des monnaies de cuivre arabo-sassanides, trouvées au-dessus des dallages, de 60 ans environ après l'hégire, soit de la fin du VIIème siècle de notre ère : il a été trouvé des fragments de plâtre peint ; des débris de vases en terre cuite émaillée, de petites bouteilles de verre, de grandes jarres de terre cuite, une penture en fer, de petites lampes en cuivre et en terre cuite émaillée. Au-dessous des dallages, vases sassanides.
Chantier No. 4. (
pl. XVI
)
Nous trouvons d'abord un niveau arabe avec des dallages, de la céramique ; puis un niveau sassanido-parthe avec des tombes d'enfant dans des jarres, qui fournissent quelques fragments de cachets (
pl. XX, 1
) , des perles, des petites poupées en os (
pl. XVIII, 2
) ; l'une de celles-ci a été (p. 11) trouvée avec un bras articulé ; une autre est accroupie et c'est la première fois que nous rencontrons cette attitude ; quelques figurines sont en terre cuite; citons un médaillon représentant un cavalier (
pl. XVII, 1
) ; il est coiffé d'un bonnet, d'où s'échappent de nombreuses boucles ; il est vêtu d'une veste dont les plis tombent sur ses genoux ; il tient dans la main droite un bâton pointu qui représente peut-être une cravache. Un fragment de figurine grossière, représente un personnage couché sur un lit de repos (
pl. XVII,2
); la tête manque et il n'y a pas d'autre détail qu'un épais collier terminé par un gros médaillon. Une petite tête de femme en terre cuite est d'une facture plus hellénistique ; de nombreuses pièces de monnaie de cuivre, surtout, sont parthes, soit des rois arsacides, d'Elymaide ou de Séleucie sur le Tigre.
Un escalier (
pl. XIX,1
) , aux marches de briques cuites, fût suivi jusqu'au sol de roulage qui correspond d'ailleurs au sol de constructions en briques crues d'époque parthe ?, en tout cas post-achéménide, car nous avons trouvé la saison précédente un support de montant de porte fait d'une rosace de chapiteau de l'Apadana. L'escalier descendait à environ deux mètres au-dessous de ce niveau et aboutissait au dallage d'un petit caveau voûté ; le déblaiement nous montra qu'il s'agissait d'un caveau souterrain d'époque arabe (
pl. XIX, 3
) ; il mesurait 3m.33 de long et 1m.,95 de largeur ; la hauteur des pieds droits était de 0m.,74 et la clef de voûte était à 2m.,10 au-dessus du dallage. Au bas de la paroi, face à l'entrée, se trouvait une petite fenêtre voûtée (
pl. XIX,4
) ; la fouille au-delà du mur reconnut l'existence d'un puits ; dans plusieurs maisons arabes, nous avons fouillé des chambres en sous-sol, il y a été trouvé dans plusieurs cas, une grande jarre, qui contenait encore plusieurs gobelets pour puiser l'eau ; il s'agissait de serdabs ou pièces de repos pour les heures chaudes de (p. 12) l'été ; dans notre cas, le puits lui-même était à la disposition des occupants de la cave.
Nous noterons encore de ce chantier la découverte de deux fragments de stèles achéménides (
pl.XVIII,1
) .
Une tranchée d'une trentaine de mètres a été amorcée pour relier le chantier précédent au bord du tell vers l'est, en vue de son approfondissement. Nous avions fait précédemment une tranchée plus au nord dans le même but ; nous l'avons abandonnée à cause de sa trop grande longueur dans un terrain stérile, composé de déblais arabes. La nouvelle tranchée aura environ 50 mètres et traverse les mêmes couches, avec une hauteur moitié moindre. Le début a rencontré une construction partho-sassanide ; il a été recueilli un très beau cachet en chalcédoine : il comporte six faces gravées ; la plus grande montre un cavalier perçant une gazelle de son épieu ; à l'opposé est peut-être un gros chien ! on voit encore un lion, une hyène, une chèvre de montagne, un cerf.
C) Isthme
Nous avons ainsi désigné un chantier placé dans l'étroit passage entre deux ravins, qui fait communiquer la Ville Royale avec le Donjon. Nous avions trouvé que pour l'enterrement de corps dans un cimetière arabe, remontant au début de l'hégire, on s'était servi de toutes sortes de pierres ramassées sans doute dans les ruines du palais sassanide qui occupait le Donjon. Nous avons encore cette saison recueilli quelques crânes. Au-dessous de ce niveau, on rencontrait des pièces de monnaie d'époque parthe, des fragments de poterie grecque et de la poterie très compacte, vernissée rouge ; un fragment de pot assez épais portait un graffito grec qui paraît daté du premier siècle (
pl.XX, 3
) . C'est dans ce niveau que fût trouvé une tête de femme en marbre blanc (
pl.XXII
) ; elle est peut-être (p. 13) un peu plus grande que nature ; la coiffure est haute ; les cheveux, partagés au-dessus du front, sont disposés en bandeaux qui cachent le haut des oreilles ; ils sont serrés par une couronne crénelée, assez large avec une bordure inférieure ; sur cette bordure, on remarquait au moment de la découverte des traces de couleur rouge, oxyde de fer ; des boucles de cheveux descendent sur le cou, en arrière des oreilles ; le visage est plein avec des traits un peu forts, les prunelles et l'iris même des yeux sont indiqués ; le nez est long et droit ; la bouche sourit ; le cou montre les plis de la prospérité ; la partie postérieure de la tête ne montre qu'une ébauche de la coiffure ; le marbre est beau il est blanc mais avec des reflets jaunes ; il est coupé net à la base du cou ; celui-ci est percé d'un trou pour un goujon d'une quinzaine de centimètres ; sans doute, au moment de l'enlèvement du scellement, un éclat de pierre a sauté, en avant du cou ; la pièce est en tout cas sortie telle, cet éclat mis à part, de l'atelier du statuaire ; celui-ci nous est connu ; il a pris la précaution de signer son œuvre ; il l'a fait sur la couronne crénelée, sans trop se soucier de la symétrie, ni de l'espacement régulier des lettres -ANTIOXOS DRUANTOS EPOIEI - Sans doute, il comptait sur la peinture ou la dorure de la couronne pour que son nom soit moins apparent. La tête pouvait être fixée sur un socle, colonne ou pilier adossé à une muraille, ou compléter un corps exécuté dans une matière moins rare que le marbre. Le type de la femme représentée nous rappelle celui des petites têtes en terre cuite des figurines hellénistiques, celui des têtes à couronne tourelée des monnaies de Séleucie sur le Tigre ; les caractères grecs de l'inscription sont les mêmes que ceux de ces monnaies et nous font dater le monument de l'ère chrétienne. (p. 14) C'est une oeuvre grecque et sans doute exécutée en Ionie sinon en Grèce ; les hellénistes nous diront si son auteur est connu par quelque autre travail ; elle a été apportée à Suse, érigée et jetée bas ; puis enterrée pour être transportée à loisir par un pillard. Elle figurera avec honneur au Musée de Téhéran.
Nous avons trouvé dans ce chantier un puits maçonné en briques cuites d'assez grandes dimensions (1m.,90 x 1m.,70) : nous sommes descendus à 3m. de profondeur ; dans les terres, nous avons trouvé des poteries sassanides, et de nombreux ossements d'animaux.
Nous avons mis à part de la maçonnerie à la tête du puits : une brique à relief du panneau en terre cuite du griffon achéménide, et plusieurs fragments de briques en fritte émaillée des archers ; l'un de ces fragments se rapporte au carquois ; il est blanc avec des motifs verts foncés ; nous ne le connaissions que vert foncé avec des motifs noirs.
D) – Donjon.
(
pl. XXIII
)
a) de -5m.60 Ã -7m.60!
Nous n'avons travaillé que deux jours à ce niveau ; nous avons trouvé des traces de constructions du temple, des simulacres de tablettes en terre crue.
b) de -7m.60 Ã -9m.60
Plusieurs points d'attaques, mais résultats concordants et peu satisfaisants ; quelques tombes à même le sol, ou dans des jarres ; relativement pauvres ; quelques fragments de figurines en terre cuite.
c) de -9m.60 Ã -11m.
Est du tell. Tombe du XXVe avant notre ère contenant deux vases peints ; l'un donne une représentation de chèvres de montagne (
pl. XXVI
) , l'autre une suite de grandes poules (
pl. XXV,1
) ; des écuelles et de grands vases à ornements en cordes, bande peinte ou à stries (
pl. XXIV, 1 et 2
) . Des sondages au (p. 15) dessous du sol de roulage sont restés infructueux.
Centre du tell - tombes d'enfants avec quelques petits vases peints ; sondage au-dessous du sol infructueux ; plus au centre, dans un trou, nombreux fragments de bouchons de jarres portant des empreintes de cylindres ; plus à l'ouest, grand tombeau ; il contient de grands vases en mauvais état, quelques écuelles d'aragonite, des vases de cuivre, dont un gobelet à pied, orné de bossettes (
pl. XXVII,2
) ; deux boucles de sangle, un couteau, des pointes de flèches ; un peu plus loin, on dégageait une roue pleine en bois (
pl. XXVIII
) dont la jante est armée de 86 clous fondus en cuivre, et dont les têtes se touchent ; le diamètre de cette roue est de 0m.,83 ; au centre, le bois représenté par une trace charbonneuse, manquait sur un diamètre de 0m,17 cet emplacement doit correspondre d'abord à un cercle réunissant les trois planches qui forment la roue, et qui paraît avoir été fixé sur ces planches par quatre petits clous de part et d'autre ; et d'autre part à l'essieu ; D'autre part, de chaque côté du centre, est une paire de ligatures, formant une saillie charbonneuse sur les planches ; on ne voit pas de noeuds, ni de fils tordus ; nous pensons que ces liens étaient constitués par du cuir et les extrémités pouvaient être cousues. A 1m.,50 au sud de cette roue placée verticalement, peut-être contre le pied droit du tombeau voûté, se trouvaient trois autres roues, plus ou moins ovalisées (
pl. XXX,2
) ; l'une d'elles avait le même diamètre que la précédente et sa jante était garnie de 91 clous ; les deux autres étaient plus petites, de 0m.,664 de diamètre pour celles-ci ; il n'y a qu'une seule ligature de chaque côté du centre, et le centre non charbonneux a Om.,145 de diamètre ; la jante de chacune de ces roues était armée de 63 clous. Nous avions trouvé autrefois au Ier chantier de la Ville Royale, une roue analogue ; elle était régulièrement ovalisée et nous l'avons (p. 16) interprétée comme un bouclier ; en fait, une roue pleine peut-être utilisé comme bouclier ; mais la découverte actuelle de deux paires de roue correspond à un chariot. D'ailleurs, l'aspect est bien celui des roues de char représentées sur l'étendard trouvé à Our, qui est de peu antérieur au XXVIIIème siècle avant notre ère. Avec les roues se trouvaient deux pièces de cuivre fondu et armés de clous ; elles devaient rejoindre une pièce de bois ronde et un bois rectangulaire ; un décor prouve qu'elles étaient visibles ; nous supposons qu'il s'agissait de renforcer l'attache du timon du chariot avec la barre transverse qui le terminait. ?. Nous avons encore trouvé dans cette région quelques tombes un peu moins anciennes ; dans l'une, nous avons remarqué près du crâne de petits liens de plomb qui servaient à assujettir la coiffure ; dans une autre, les cheveux étaient entourés d'un long ruban d'argent. Une tombe du XXVème a fourni deux cylindres (
pl. XXVII,1
) .
Plus à l'Ouest, nous avons déblayé plusieurs sols de chambres et au-dessous, quelques tombes du XXVème ; l'une d'elles contenait avec quelques vases ordinaires, un long vase galbé en terre cuite grise (
pl. XXIX,1
) ; il était décoré de profondes incisions autrefois remplies de chaux ; des trous étaient préparés pour des anses funiculaires ; le fond est placé presque à mi hauteur du vase ; il est arrondi et c'est sa position qui oblige à considérer comme pied du vase ce que l'on prendrait plus volontiers comme le côté de l'ouverture.
Nous avons trouvé plusieurs figurines et quelques-unes paraissent représenter des équidés (
pl. XXIX,3
) ; citons encore dans une tombe une belle collection de pointes de flèche en silex (
pl. XXIX,2
) .
Nous avons profité d'un puits de drainage pour faire un sondage de l'épaisseur du tell ; nous sommes descendus à 3m. au-dessous du niveau de roulage dans un terrain argilo-calcaire qui représente le sol naturel sur ce point ; nous avons du reste constaté que notre niveau -11m. est à 9m. au-dessus du niveau de la plaine, en avant du Donjon. Nous rappelons qu'au sud de l'Acropole, le sol naturel apparaissait aussi à 9m au-dessus du niveau aquifère ; le niveau -11m. du Donjon est en réalité à environ 3m. au-dessous du début du sol naturel au sud de l'Acropole.
III- Tépé Bouhallan 2
Il y a deux buttes artificielles de ce nom à l’ouest de Suse, à environ 11km. et assez voisins de l’Ab é Diz ; nous avions commencé (p.17) la saison dernière, un sondage dans la butte la plus au Nord ; il s’était arrêté en fin de campagne, pensions nous, au début des couches de Suse I ; nous avons repris ce travail en augmentant les dimensions de la fouille ; un ancien chef de tribu s’est offert pour surveiller le travail : nous ne pouvions quitter les chantiers de Suse et sans surveillance, les chefs d’équipes avaient tendance à augmenter leurs résultats en y joignant le produit opérés sur d’autres points que leur sondage ; la coupe du tell risquait ainsi d’être faussée. Les données de la saison précédente furent vérifiées ; début dans les couches islamiques peu épaisses ; poterie sassanide, puis parthe et séleucide ; on passe ensuite brusquement aux couches de 3.200 à 3.500 avant notre ère avec comme documents une faucille en terre cuite et des fragments ; on arrive à une couche à vases peints, très pauvre du reste et l’on atteint le sol stérile à une profondeur de 8m.
IV- Tépé ZAHAB
Butte artificielle d’une centaine de mètres de longueur, Tépé Zahab se trouve à 7km. de Suse vers le Sud-est ; il avait été visité par le Dr. Unvala, il y a trois ans ; il en avait rapporté des vases arabes et sassanides ; un ouvrier nous apporta des pièces de monnaies en cuivre qu’il avait trouvées dans un pot émaillé ( pl.XXX,1 ) ; peu à peu, il nous apporta la plus grande partie de la trouvaille environ 800 pièces de la taille d’une drachme et une dizaine du module du tétradrachme : il n’y avait que du bronze, mais parfois il restait des traces d’argenture : toutes ces monnaies étaient de l’Elymaïde ; le Dr. Unvala retourna au tépé pour faire une fouille sur le point de découverte ; il trouva des restes de construction, des sarcophages parthes, et un deuxième pot émaillé semblable à celui qui avait contenu les pièces de monnaie.
L'inventaire des objets comprend 56 numéros pour Tchogha Zembil et 230 pour Suse. Nous avons rapporté à Téhéran 18 caisses d'antiquités qui ont été partagées en deux lots ; le tirage au sort au eu lieu le 30 Avril, au Musée National ; le lot n° 2 a été attribué à la France. Voici comment se sont partagés les objets les plus intéressants :
Lot No. 1 Lot No.2
Tête de femme en marbre - Ier siècle
Tête de lion terre cuite – XXIIIe
Fusaïole inscrite – agate – XXIIIe
2 Grands vases peints – XXVe
Médaillon à relief de cavalier – Ier
Poupée à bras articulé – Ier
2 Lots de clous cuivre - XXVIIIe
Coupe à bossettes cuivre – XXVIIIe
Tête de lance – cuivre – XXIIIe
Frgt. Stèle inscrite – Ve
100 perles longues – verre Xe
Vase à anse, émaillé - Ve après
Cachet chalcédoine – Ve après
Carreaux émaillé inscrit – Xe av
Vase à décor incisé – XXVe
Petit chien – or – XXXe
Grand vase peint – XXVe
Frgts vases peints – XXVe
Figurine femme couchée – Ier
Tête de femme terre cuite – Ier
Poupée accroupie – os – Ier
2 Lots clous cuivre XXVIIIe
Epingle à tête de taureau – XXVe
Anneau avec mains –XXIIIe
Frgt. Stèle inscrite - Ve
70 perles longues – verre – Xème
Vase à 2 anses émaillé
Cylindre-chalcedoine – VIIe avt.
Après le partage, nous avons emballé dix caisses d’antiquités qui ont voyagé avec nous jusqu’à Marseille ; elles sont arrivées au Louvre, le 13 Juin et ont été déballées le 15.
CONCLUSIONS.
Nous considérons comme terminés les deux chantiers de la Ville Royale : No.1 et Donjon. Nous avons en préparation les chantiers No. 4 et No. 5, en exploitation le petit chantier de l'Isthme et bien entendu l'Acropole. Le principal but actuel de nos recherches est le cimetière ou les cimetières utilisés entre 3.500 avant notre ère et 2.800, mais nous espérons aussi trouver des documents écrits antérieurs aux tablettes proto-élamites. D'autre part, nous avons toujours à combler une lacune importante dans la suite des rois d'Elam, entre la 1ere dynastie babylonienne et Untash-Gal, une lacune moins importante entre ce roi et Choutrouk Nakhounté et des indications sur la fin de la période élamite.
La couche de Suse I a une épaisseur de 3m. au Sud de l'Acropole, 3m.,50 à 400m. plus au Nord, 0m.,30 à l'Apadana, soit à 700m. du point le plus au Sud. Nous espérons trouver au centre de l'Acropole une couche plus épaisse et plus riche.
Le chantier No. 5 de la Ville Royale est situé sur une crète qui semble marquer l'ancienne limite de la ville élamite vers l'Est.
Nous avons été amenés pour des raisons non archéologiques à travailler davantage cette saison à Tchogha Zembil et nous n'avons obtenu que des résultats utiles pour les plans de la ziggurat ; ce fut au détriment de nos chantiers de Suse, mais comme nous l'avons exposé, les travaux de Tchogha Zembil semblent être suffisants pour nos possibilités, et nous pouvons reporter nos efforts sur Suse, où les objets sont plus nombreux.


 veuillez patienter...
veuillez patienter...