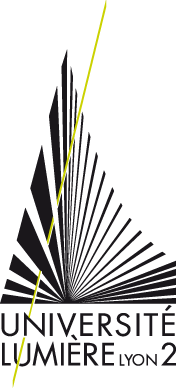Cote conservation : F/17/17258 / Document original conservÃĐ aux Archives Nationales, Paris.
MINISTÃRE DE LâEDUCATION NATIONALE.
RECHERCHES SCIENTIFIQUES
FOUILLES ARCHÃOLOGIQUES DE LâIRAN.
MISSION DE SUSIANE.
CAMPAGNE DE FOUILLES -1938.
RAPPORT DE MISSION.
La Mission ÃĐtait composÃĐe cette saison de MM. de Mecquenem, chargÃĐ des fouilles, J. Unvala et J. Michalon, architecte D.P.L.G.
Les inspecteurs du Service des AntiquitÃĐs de l'Iran ÃĐtaient MM. Minou'i et Reuwanbote.
La Mission ÃĐtait rassemblÃĐe à Suse le 13 FÃĐvrier.
Les travaux de fouilles ont ÃĐtÃĐ commencÃĐs à Tchogha Zembil le 21 FÃĐvrier et se sont terminÃĐs le 12 Mars. Ils ont commencÃĐ Ã Suse le 14 Mars et ont ÃĐtÃĐ arrÃĐtÃĐs le 3 Avril. Des sondages ont ÃĐtÃĐ poursuivis du 13 Mars au 1er Avril à TÃĐpÃĐ Bouhallan A et du 18 Mars au 3 Avril à TÃĐpÃĐ Bouhallan B.
I- Travaux à Tchogha Zembil
A)-Ziggourat.
Il sâagit dâune tour à ÃĐtages ; la base ÃĐtait carrÃĐe ; les angles sont orientÃĐs à peu prÃĻs aux points cardinaux ; la diagonale Nord-Sud est un peu à lâouest du Nord magnÃĐtique ; lâangle est de 3 degrÃĐs et demi.
Chantier 1- Une ÃĐquipe a dÃĐblayÃĐ lâangle Nord-ouest (
pl.V
) , qui avait ÃĐtÃĐ trouvÃĐ prÃĐcÃĐdemment à 1m. de profondeur ; un puits a permis (p. 2) de suivre le parement sur cet angle, depuis la cote 40m.80 (au-dessus de lâAb ÃĐ Diz) jusquâà la cote 34,90, oÃđ le sol naturel a ÃĐtÃĐ rencontrÃĐ. Ce travail a permis de voir deux dÃĐcrochements sur les cÃītÃĐs de lâangle. Le parement avait une ÃĐpaisseur de 2m.,75. Une tranchÃĐe dâenviron 3m. de largeur a rencontrÃĐ Ã la cote 37,86, un nouveau parement à 8m.,50 du premier (entre les surfaces externes). 81 avait une ÃĐpaisseur de 0m.80 et prÃĐsentait une rangÃĐe de briques inscrites à 8 lignes bien entiÃĻres et les clous bien orientÃĐs. Ce mur fut suivi sur une hauteur dâenviron 2m. (cote : 35,84). Un dallage sâamorçait alors avec une brique dâÃĐpaisseur posÃĐe sur des fragments de briques ; en avant, nouveau parement, à 3m. du prÃĐcÃĐdent et de 0m.,42 dâÃĐpaisseur ; il descendit jusquâà la cote 34,54, soit une hauteur de 1m.,30. Il ÃĐtait arrÊtÃĐ par un dallage de fragments de carreaux posÃĐs sur briques crues. Ce dallage fut suivi sur une longueur de 5m.,50 ; il ÃĐtait alors à une profondeur de 3m.,50 au dessous du sol actuel.
Chantier 2- Une ÃĐquipe travaillait sur la face Sud-ouest (
pl. II
et
III,3
) et a mis au jour une longueur de 4M. dâun parement qui se trouve le 5ÃĻme (
pl. III,4
) à partir du degrÃĐ de 1m.,30, signalÃĐ tout à lâheure et qui affleurait à la cote 49,60 ; il a ÃĐtÃĐ suivi jusquâà un dallage à la cote 46,10, soit sur 3m.,50. Le 4ÃĻme parement ÃĐtait à 4m., 75 du 3ÃĻme et le 5ÃĻme à 3m.,40 en retrait sur le 4ÃĻme. Le mur prÃĐsentait une apparence singuliÃĻre ; les briques dâune rangÃĐe sur deux avaient ÃĐtÃĐ grossiÃĻrement coupÃĐes ; nous avons un instant pensÃĐ que lâon avait dÃĐtruit une ornementation ; nous avons vu bientÃīt que le mur nâayant que deux carreaux dâÃĐpaisseur, 0m.,80 lâappareillage des matÃĐriaux amenait à une alternance de carreaux en saillie ; le maçon avait jugÃĐ plus commode de ravaler ces saillies aprÃĻs la pose, les briques ÃĐtant bien maintenues (p.3) par le poids des assises supÃĐrieures ; lâalternance des surfaces rugueuses et lisses formait ornement ou plutÃīt ÃĐtait cachÃĐe par un revÊtement à la chaux.
Dans une saignÃĐe perpendiculaire, destinÃĐe à retrouver un 6ÃĻme parement (qui nâa pas ÃĐtÃĐ atteint) il a ÃĐtÃĐ dÃĐgagÃĐ un gros fragment de pierre de seuil en grÃĻs du pays, et recueilli des dÃĐbris de clous dÃĐcoratifs en terre cuite ÃĐmaillÃĐe.
Chantier No. 3 âDÃĐblaiement de lâangle Sud (
pl.II
) . La tranchÃĐe a rencontrÃĐ des ÃĐboulis trÃĻs ÃĐpais et recueilli des fragments de briques inscrites. Le 2ÃĻme parement a ÃĐtÃĐ retrouvÃĐ et dÃĐgagÃĐ sur une longueur de 3m. , partie de la base Sud-est. Ce travail a permis de vÃĐrifier que la base de la Ziggourat ÃĐtait bien carrÃĐe.
LâÃĐquipe a ÃĐtÃĐ dÃĐplacÃĐe pour rechercher des affleurements des parements supÃĐrieurs ; elle a trouvÃĐ les 4ÃĻme et 5ÃĻme, mais glissÃĐs hors de leur position normale.
Chantier No. 4-Face Nord-est. (
pl. III,1
et
IV
)
Il faut se rappeler que, sur cette face, avaient ÃĐtÃĐ dÃĐgagÃĐs des murs en briques cuites, sortant de lâalignement du 3ÃĻme parement ; ils portaient à croire à lâexistence dâun sanctuaire sur cette face. Le travail ÃĐtait difficile en raison de la prÃĐsence dâune forte ÃĐpaisseur dâÃĐboulis au-dessus de la chambre prÃĐsumÃĐe ; deux ÃĐquipes furent occupÃĐes sur ce point ; la moitiÃĐ environ dâune chambre fut dÃĐterminÃĐe et vidÃĐe ; le remplissage ÃĐtait de terre mÊlÃĐe à des fragments de carreaux, des dÃĐbris de bois carbonisÃĐ, des pierres de grÃĻs taillÃĐes en clefs de voÃŧte ; le dallage fut atteint à la cote 37,28 ; LâintÃĐrieur de la chambre paraÃŪt avoir mesurÃĐ 5m.80 sur 2m.70, et prÃĐsentait une porte au Nord-est.
Il a ÃĐtÃĐ recueilli des fragments de briques inscrites et des dÃĐbris de clinquant dâor.
B) â Travaux à lâintÃĐrieur de la 1ÃĻre enceinte (p.4)
Chantier No.1-Ouest de la ziggourat.
Les travaux de 1936 sur ce point nâavaient pas repris en 1937 ; ils avaient ÃĐtÃĐ arrÊtÃĐs par un long mur en briques crues qui paraissait indiquer le terre plein de base de la tour à ÃĐtages ; la pluie avait cependant à notre arrivÃĐe, mis à jour un petit dallage carrÃĐ ; il fut dÃĐgagÃĐ et lâon reconnut un pilier carrÃĐ, construit sur un dallage et dâun mÃĻtre de hauteur. Contre le pilier du cÃītÃĐ N.E. ÃĐtait posÃĐ sur le dallage un long dard de cuivre oxydÃĐ ; il mesure 0m.,546 de longueur, une extrÃĐmitÃĐ ÃĐtait pointue et lâautre ÃĐtait un large fer de lance ; au nettoyage, on reconnut que la tige ÃĐtait un serpent qui le tenait le large plat du fer dans sa gueule ; la tÊte ÃĐtait dâexÃĐcution exacte et soignÃĐe ; en arriÃĻre du cou, on distinguait une inscription cunÃĐiforme de 0m.,10 de longueur, trÃĻs altÃĐrÃĐe ; le dos de lâanimal convexe ÃĐtait ornÃĐ dâincisions imitant le dÃĐcor de la peau ; le ventre plat et la gorge ÃĐtaient ÃĐcailleux ; le fini du travail, comme ce que lâon peut dÃĐduire de lâinscription indiquent un objet votif dÃĐdiÃĐ Ã une divinitÃĐ ; câest plutÃīt un sceptre quâune arme.
à la suite de cette dÃĐcouverte, le dÃĐblaiement du dallage fut entrepris avec trois ÃĐquipes ; Il sâÃĐtendit en avait du pilier et de part et dâautre, dessinant une salle ÃĐtroite (largeur :2m.) de 10m.,10 de longueur totale, limitÃĐe par des murs de briques crues ; un couloir sâouvrit au S. est, large de 0m.,90 et long de 2m.,60 ; il aboutit à une deuxiÃĻme salle de 6m.,90 de long sur 3M. de large. Un pilier carrÃĐ sâÃĐlevait en face du premier, haut de 0m.,77. Un nouveau couloir sâouvrait au S. est, il fut suivi sur 6m.,50, arrivant à 24m. du 1er degrÃĐ de la ziggourat ; le dÃĐgagement dâune maçonnerie superficielle empÊcha de poursuivre lâexploration en profondeur. Le remplissage des salles ÃĐtait des briques crues plus ou moins fondues ; à la base, on remarquait des dÃĐbris de bois calcinÃĐ et des terres charbonneuses (p.5) et des dÃĐbris dâossements. Le dallage paraissait couvert de chaux ; les carreaux enlevÃĐs, on trouva cinq lits superposÃĐs de lits de fragments de carreaux ; on recueillit sur le dallage et dans les interstices, de nombreuses perles de fritte, de pierres et de verre. PrÃĻs du pilier de la 1ÃĻre chambre, se trouvait, outre le sceptre, un petit saumon dâargent, du poids de 170 grammes (MusÃĐe de TÃĐhÃĐran). PrÃĻs du pilier de la 2ÃĻme, ÃĐtaient plusieurs petits poissons et deux petits oiseaux en fritte ÃĐmaillÃĐe ; Ces objets, comme les perles faisaient partie de colliers ; nous avons observÃĐ des fragments de fils de cuivre passÃĐs dans les trous de suspension ; les perles de verre ÃĐtaient de plusieurs natures ; les unes petites et rondes, dâautres ÃĐtaient circulaires, avec une face plate et lâautre bombÃĐe dâun diamÃĻtre variant de 15 à 30 millimÃĻtres ; la face convexe ÃĐtait partagÃĐe en trois zones avec un cercle central foncÃĐ, rappelant un Åil ; dâautres enfin ÃĐtaient cylindriques, dâun diamÃĻtre de 10 à 15 millimÃĻtres dâune longueur de 20 à 25 centimÃĻtres, et de deux couleurs au moins, jaune et blanc, blanc et bleu foncÃĐ, en spirales ; nous avions trouvÃĐ des fragments nombreux de ces perles, surtout en 1936, dans une salle au Sud-ouest de la premiÃĻre, mais aussi dans presque toutes les constructions dÃĐblayÃĐes, mais jamais nous nâavions pu en reconstituer dâentiÃĻres ; nous en avons à prÃĐsent huit ; elles ont une extrÃĐmitÃĐ coupÃĐe doit, et lâautre en pointe ÃĐmoussÃĐe ;
La destination de ces cylindres de verre nous ÃĐchappe.
Notons encore des petits yeux, composÃĐs de trois parties : la pupille, petite pastille en bitume, le blanc de lâÅil, en marbre, ou en gypse, se logeant dans une coque de bitume ou de cuivre ; quelques cylindres.
Notons aussi plusieurs petits clous de cuivre et des dÃĐbris de cuivre informes.
Un sondage au sud-ouest de la 1ÃĻre salle a rencontrÃĐ un dallage en (p. 6) surface et, en profondeur, (cote 36,40) un dallage oblique sur les autres constructions et qui pourrait Être le fond dâun aqueduc ; plus au sud-ouest encore, à lâangle droit sur la galerie trouvÃĐe en 1936, se trouvait une longue salle, large de 3m.,60, qui a ÃĐtÃĐ dÃĐgagÃĐe sur 15m.,70 limitÃĐe au sud-est par un ravin ; sur le dallage, il a ÃĐtÃĐ recueilli des perles cylindriques en verre, une paire dâanneaux en cuivre utilisÃĐs pour renforcer des bois de la toiture, une paire de gros crochets de cuivre, (peut-Être gonds de porte) et une douzaine dâyeux, gÃĐnÃĐralement trouvÃĐs par paires, presque plus grands que des yeux normaux. Nous pensons que ces yeux ÃĐtaient destinÃĐs à des tÊtes en terre crues, simulacres de tÊtes humaines, pour les cÃĐrÃĐmonies funÃĻbres, aprÃĻs exposition aux animaux sauvages, du rÃĐensevelissement des restes. Il est possible que lâensemble des constructions de cette face de la Ziggourat reprÃĐsente des caveaux funÃĐraires. Lâorientation des murs, au contraire des cÃītÃĐs des la tour, est sud-ouest-nord-est et S.E.N.O, magnÃĐtique.
Chantier No.2-Est de la Ziggourat.
Une ÃĐquipe a fait un petit sondage pour chercher à lâEst de la tour une galerie symÃĐtrique de celle de lâouest ; elle a rencontrÃĐ des restes de construction de surface et a ÃĐtÃĐ dÃĐplacÃĐe, un dÃĐblaiement important sur ce point nâÃĐtant pas opportun.
Chantier No.3- Le dÃĐblaiement des constructions trouvÃĐes lâannÃĐe prÃĐcÃĐdente a ÃĐtÃĐ repris, et poussÃĐ jusquâau mur de la 1ÃĻre enceinte. Des murs ÃĐpais de un mÃĻtre, conservÃĐs sur une hauteur parfois de prÃĻs dâun mÃĻtre cinquante, dessinent des chambres rÃĐguliÃĻres ou non. Le plan annexÃĐ nous dispense de description ; peut-Être sâagit il de caves ? â dans ce travail nous avons recueilli de nombreuses briques (p.7) inscrites rÃĐemployÃĐes dans la construction, des carreaux ÃĐmaillÃĐs, en terre cuite (dimensions : 0m.,39-0m.,395-0m.,11) dÃĐcorÃĐs soit de trois groupes en ligne de cercles concentriques, (3), soit dâune suite de trois lozanges ; des jarres de terre cuite, quelques fragments de figurines, quelques perles, des pointes de flÃĻches, et ÃĐpingles en cuivre. Nous avons trouvÃĐ en place plusieurs pierres de support de gonds de porte et des pierres de meule à grains rÃĐemployÃĐes.
C) Travaux dans la deuxiÃĻme enceinte (
plan
)
Une ÃĐquipe a ÃĐtÃĐ employÃĐe à des sondages en diffÃĐrents points ; elle a ÃĐtÃĐ ensuite fixÃĐe à un dÃĐblaiement de constructions à fleur de sol ; à lâest du prÃĐcÃĐdent chantier ; il a ÃĐtÃĐ trouvÃĐ quelques vases de terre cuite, dont un grand vase à cordons (MusÃĐe de TÃĐhÃĐran)
Le dÃĐblaiement de constructions plus à lâest a ÃĐtÃĐ repris ; il a ÃĐtÃĐ recueilli un pied, et un fragment de pied, dâun grand bassin en fritte ÃĐmaillÃĐe, trouvÃĐ fragmentÃĐ en cet endroit la saison prÃĐcÃĐdente, (MusÃĐe de TÃĐhÃĐran), quelques fragments de vases ÃĐlamites en fritte et en terre cuite ÃĐmaillÃĐe, deux petits singes assis en terre cuite, et des vases en terre cuite fragmentÃĐs.
Nous avons omis de signaler un sondage en bordure du ravin de la 1ÃĻre enceinte, au sud du chantier No.3. Il a ÃĐtÃĐ trouvÃĐ une sorte de dÃĐpotoir et de nombreux vases de terre cuite ; parmi ceux-ci, signalons un type curieux rÃĐpÃĐtÃĐ assez souvent, et dont nous avons pu restaurer un spÃĐcimen ; le fond est plat et triangulaire, le col est rond, le raccordement se fait au-dessus de la panse.
D)-Travaux en dehors des enceintes.
Nos deux inspecteurs ont bien voulu se charger de surveiller une ÃĐquipe de fouille prospectant dans la plaine de lâAb ÃĐ Diz, au Nord de la Ziggourat. Ils ont explorÃĐ un premier monticule, oÃđ sur un sol trÃĻs dur et chargÃĐ de gypse, ils ont trouvÃĐ des restes de constructions (p.8), une collection de lampes et de bouteilles dâÃĐpoque parthe ; un peu plus au nord, presquâau niveau de la plaine, ils ont suivi un dallage sur une vingtaine de mÃĻtres de long, probablement fondations de mur.
Le Dr. Unvala partit une aprÃĻs midi sous la conduite de SÃĐid KhÃĐrim visiter un site de ruines à Obeyeh, à 6km. environ ; il vit des restes de constructions peu anciennes et peu importantes.
Conclusion
La ziggourat ou Khourkibrat de Tchogha Zembil sâest avÃĐrÃĐe beaucoup plus importante que nous lâavions pensÃĐ aprÃĻs deux explorations, deux degrÃĐs sont enfouis assez profondÃĐment ; ce fait permet dâespÃĐrer trouver bien conservÃĐes des amorces dâescaliers, des saillies dÃĐcoratives, mais au prix dâun grand effort. Le cÃītÃĐ du premier degrÃĐ a environ 103m. celui du second est 97mÃĻtres, celui du 3ÃĻme 80m, du 4ÃĻme est 71m et celui du 5ÃĻme 64m.20.
La face Nord-Est, ÃĐtant toujours à lâabri du soleil, a un intÃĐrÊt particulier ; câest gÃĐnÃĐralement celle qui porte lâescalier ; les ascensions ÃĐtant moins pÃĐnibles faites à lâombre, câest aussi le cÃītÃĐ oÃđ lâon construit plus volontiers le temple, bien que le sommet de la tour doive en comporter un, et lâespace libre au sommet devait Être assez considÃĐrable, mÊme pour un grand temple à moins de multiplier les ÃĐtages. Notre face N.E. est couverte dâÃĐboulis peu commodes pour le travail.
Les constructions du Nord-ouest paraissent trÃĻs intÃĐressantes ; elles nous faciliteront lâapproche de la ziggourat en nous fournissant des bibelots nouveaux, et peut-Être des inscriptions. Les constructions plus ÃĐloignÃĐes de la ziggourat perdent au contraire de leur intÃĐrÊt en apparaissant trÃĻs postÃĐrieures à la tour et trÃĻs remaniÃĐes ; notre intention est de concentrer nos efforts sur le centre de la premiÃĻre enceinte.
TRAVAUX Ã Suse
A) â ACROPOLE.
Chantier No.2. Sud-est du Tell (
pl. XI, 2
et
pl.XII
)
a- Dans un ravin, à la suite des pluies d'hiver, on trouve un fragment de stÃĻle en grÃĻs ; il porte en bas-relief, une tÊte de serpent : gueule ouverte, la langue saillante et pontue (sic), le corps ÃĐcailleux ; le motif, comme la nature de la pierre, nous ont fait penser qu'il s'agit d'un dÃĐbris nouveau de la grande stÃĻle en grÃĻs d'Untash-Gal conservÃĐe au MusÃĐe du Louvre ! Le Service des AntiquitÃĐs de l'Iran, dans son intelligente bienveillance, nous a fait attribuer ce fragment avant partage.
Du niveau p (IIÃĻme Niveau) Ã -3m.,60.
à la partie supÃĐrieure, fonds de silos et fours ; grand cratÃĻre trÃĻs fragmentÃĐ, (MusÃĐe du Louvre) avec peintures rouges et noir-bleu, de la panse au col ; peinture pulvÃĐrulente trÃĻs peu solide ; dÃĐcor gÃĐomÃĐtrique ; nombreux fragments de vases analogues. Plus bas, dans des restes de constructions indiquÃĐes surtout par des amorces de canalisations, quelques tombes d'enfants, marquÃĐes par des amulettes et des perles de pÃĒte et de pierre, des boules, des fusaÃŊoles d'aragonites, des masses d'armes ou poignÃĐes de canne en pierre, des cylindres et fragments de cylindres ; signalons un petit veau couchÃĐ en pierre dure, d'un travail soignÃĐ (MusÃĐe du Louvre) - Un vase, fermÃĐ par une ÃĐcuelle renversÃĐe, renfermait des ossements d'enfant trÃĻs jeune, accompagnÃĐ d'une fusaÃŊole et d'un anneau à bÃĐliÃĻre en coquille. - Tombe d'enfant sous les ÃĐclats d'un grand vase, avec coquille d'Unio et perles de pÃĒte blanche en trÃĻs grand nombre ; nous avons recueilli des hameçons et des (p. 10) ÃĐpingles de cuivre ; ces derniÃĻres, souvent à tÊtes ornÃĐes, enfin quelques tablettes proto-ÃĐlamites, et des empreintes de cachets sur des bouchons de jarre en terre crue.
Plus au Nord, nous avons ouvert une nouvelle tranchÃĐe de 0m. à -1m.,50. - Nous avons trouvÃĐ des fragments de vases polychromes, comme dans le travail prÃĐcÃĐdent ; un grand vase de terre cuite, quelques empreintes sur terre crue ; les ouvriers nous ont remis de nombreuses amulettes en forme de poissons, oiseaux, une tortue, gÃĐnÃĐralement en albÃĒtre, parfois en aragonite, d'un genre tout diffÃĐrent de ce que nous avions l'habitude de trouver à ce niveau. Comme ces objets manquent en gÃĐnÃĐral de trous de suspension, ou de support, et à cause de leur originalitÃĐ, nous avons de grands doutes sur leur origine ; nous supposons qu'ils sont l'ouvrage de quelque artiste local, content de peu de profit ; notre enquÊte n'a pas rÃĐussi à le dÃĐcouvrir.
De -3m.,60 Ã -5m.-
Nous avons trouvÃĐ des vases de terre cuite, surtout des ÃĐcuelles grossiÃĻres, mais aussi des vases à 4 boutons, des vases à bec ; des ÃĐcuelles en bitume, en gypse ; des cachets plats, des empreintes sur bouchons de jarres ; des percuteurs, poids de balance, tÊtes de cannes en pierre ; des clous, des perles et des amulettes en terre cuite ; un curieux objet est un poisson de terre cuite, (MusÃĐe de TÃĐhÃĐran) ; il a la bouche ouverte et un orifice s'ouvre au milieu du dos ; les yeux, les ÃĐcailles et les nageoires sont soigneusement reprÃĐsentÃĐs.
De -4m.,50 Ã -8m.,50.
Nombreux vases de terre cuite, surtout ÃĐcuelles grossiÃĻres ; un petit vase contenait encore des graines ; à la base du niveau, un gd (sic) vase en terre cuite jaune, à fond plat, largement ouvert, (D : 70,5 cm) et presque aussi haut ; il ÃĐtait dÃĐcorÃĐ en haut d'une ceinture circulaire (p. 11), travaillÃĐe au pouce ; il avait ÃĐtÃĐ anciennement cassÃĐ ; de part et d'autre de la fÊlure ÃĐtaient forÃĐs deux trous tous les 17 à 19 centimÃĻtres ; dans les trous, on pouvait recueillir une matiÃĻre noire, qui doit reprÃĐsenter le reste d'une corde, peut-Être en jonc. Nous avons trouvÃĐ des paquets de fusaÃŊoles en terre cuite, de bobines, de clous de mÊme matiÃĻre ; un burin et un outil de potier de terre cuite ; des hameçons, des aiguilles, des ÃĐpingles de cuivre ; des cachets plats, l'un d'eux en aragonite, en forme de tÊte de lion ; des empreintes sur terre crue, une pointe de flÃĻche en os.
De -8m.,50 Ã -9m.,50
Nous avons, à l'ouest de notre tranchÃĐe, trouvÃĐ quelques spÃĐcimens de ces empreintes de cachets boutons à personnages et à ornements gÃĐomÃĐtriques, sur lesquels nous avons attirÃĐ l'attention de ces deux derniÃĻres saisons ; ces empreintes ne sont pas cette fois en trÃĻs grands fragments, mais nous avons eu la chance de trouver un cachet bouton à ornements gÃĐomÃĐtriques justement de ce style. MÊme par sa facture, il se distingue des cachets boutons de la couche qui surmonte, comme ceux de Suse I qui se trouvent immÃĐdiatement au-dessous. Nous trouvons alors de nombreux fragments de la poterie peinte archaÃŊque.
De -9m.,50 Ã -11m.
Fragments de poterie peinte de Suse I. A -11m. sol naturel.
Chantier No.4.
Faute de personnel, nous nous sommes limitÃĐs à une tranchÃĐe de 5m. de largeur pour l'approfondissement de ce sondage ; il est descendu de 6m. à 7m.,60. Nous avons encore trouvÃĐ des clous de fondation en terre cuite, dissÃĐminÃĐs sur le terrain, ou rÃĐunis par 2 ou 3. Au-dessous, le sol devient moins dur et a une couleur brune, peut-Être due à des traces de vÃĐgÃĐtation ; nous devons arriver à Ourouk IV.
(p. 12)
B)- VILLE ROYALE.
Chantier No.1- Sud-ouest du tell (
pl. XV,1
)
Est du chantier - à partir du Niveau O, restes de constructions, tÊtes de puits et tombes nÃĐo-babyloniennes en fosses et dans des jarres ; on trouve des vases de terre cuite : nous devons citer particuliÃĻrement un petit vase peint en terre cuite rouge, avec dÃĐcor gÃĐomÃĐtrique brun-rouge il a trois pieds et se dÃĐtachant de la bordure deux petits boutons en saillie, percÃĐs verticalement pour une anse funiculaire ; (MusÃĐe de TÃĐhÃĐran). Nous avons eu l'occasion de voir des vases tout à fait semblables, dans ce MusÃĐe, grÃĒce à l'obligeance de la Conservation, et provenant des fouilles du Dr. E. Schmidt au Louristan ; le Dr. Contenau a trouvÃĐ des vases analogues à TÃĐpÃĐ Giyan, prÃĻs de NÃĐhavend, mais sans boutons en saillie ; Ces vases se trouvent donc datÃĐs du VIIÃĻme siÃĻcle environ avant notre ÃĻre ; à un niveau infÃĐrieur, nous avons trouvÃĐ deux autres vases peints, ÃĐlamites cette fois, et d'un genre plus commun à Suse. Dans des puits, nous avons recueilli des fragments de cÃĐramique arabe et sassanide ; dans un autre, à quelques mÃĻtres du chantier, des vases nÃĐo-babyloniens en flÃŧte et un pied de meuble ou de plateau, sans doute en bois ; il avait ÃĐtÃĐ recouvert d'une feuille trÃĻs mince de cuivre ; elle montre une dÃĐcoration de godrons et une boule ; cette derniÃĻre porte des ornements gravÃĐs et repoussÃĐs (MusÃĐe de TÃĐhÃĐran).
Au-dessous du niveau nÃĐo-babylonien, nous trouvons le niveau ÃĐlamite, reprÃĐsentÃĐ par des tombes en jarres et des caveaux funÃĐraires en briques cuites (
pl.XV, 2 et 3
) ; l'un de ces derniers ÃĐtait construit d'une maniÃĻre un peu nouvelle ; les pieds droits comportaient d'abord des briques en parpaings, puis des rangÃĐes horizontales ; nous avons trouvÃĐ dans le mobilier funÃĐraire, des vases de terre cuite, un poignard (p. 13) de cuivre, et des restes informes de tÊtes en terre crue, ou plutÃīt en boue sÃĐchÃĐe ; les yeux de ces simulacres ont ÃĐtÃĐ mieux conservÃĐs ; ils ÃĐtaient en bitume et portaient des traces de peinture. Nous avons trouvÃĐ quelques poids de balance ; les uns en forme d'ellipsoÃŊdes allongÃĐes, plusieurs, en hÃĐmatite, en cornaline et quartz en formes de petit canards ; un autre, ce qui est plus rare, ÃĐtait une petite tÊte de boeuf en hÃĐmatite ; (ce que nous appelons hÃĐmatite, Fe293, pourrait Être du reste du rutile, Ti 02).
Nous avons trouvÃĐ quelques cylindres, nÃĐobabyloniens et ÃĐlamites ; parmi ceux-ci, notons en passant une scÃĻne assez frÃĐquente, gravÃĐe sur des cylindres en bitume, du XXe au XVIIe siÃĻcle avant notre ÃĻre ; le dieu est assis sur un trÃīne ; il tient de la main droite un gobelet ou vase à boire ; en face de lui, se tient debout un serviteur, ou peut-Être une figuration de la personne que l'on vient d'inhumer ; dans ce cas, le mort se prÃĐsente en solliciteur du breuvage de vie ; celui-ci est contenu dans une amphore au fond conique ; au-dessus de ce rÃĐcipient, entre les personnages, un oiseau, et le croissant lunaire ; le reste du champ est occupÃĐ par une butte ou tour à trois ÃĐtages ; au sommet s'ÃĐlÃĻvent trois arbres, dont les branches opposÃĐes deux à deux se relÃĻvent obliquement ; Si cette ramure s'abaissait au lieu de se lever, nous n'aurions aucun doute à dÃĐterminer ces arbres comme des conifÃĻres. Ces arbres sont trÃĻs rares en Perse ; cependant Pline (Livre XII,39) dit qu'il existe en Perse, sur le mont Zagros, dans le territoire de SittacÃĐ, une sorte de cyprÃĻs, aux branches blanches, au bois odorifÃĐrant dans les foyers ; les Parthes en mettent des feuilles dans leur boisson. Le nom rapportÃĐ par Pline est : bratus. Il paraÃŪt que les feuilles de cyprÃĻs, dont il y a beaucoup à Chiraz, sont encore utilisÃĐes pour parfumer l'eau de boisson. La SittacÃĐ de Pline, est sans doute la contrÃĐe arrosÃĐe par le fleuve Sitakos mentionnÃĐ par Arrien ; c'est la riviÃĻre (p. 14) Mund actuelle, dont un affluent prend sa source non loin de Firouzabad, à 100 km. au sud de Chiraz.
à la base du niveau, nous avons trouvÃĐ des sarcophages sans moulures et recueilli des anneaux et pectoraux en argent, des armes et des vases de cuivre.
PrÃĻs des tombeaux, nous avons eu quelques tablettes inscrites en terre crue, de nombreuses figurines de terre cuite, de menus objets, parmi lesquels un dÃĐ en terre cuite, d'ÃĐpoque nÃĐobabylonienne (MusÃĐe de TÃĐhÃĐran).
Du cÃītÃĐ ouest de la fouille, nous trouvons des tombes du XXVÃĻme avant notre ÃĻre, fournissant quelques vases de terre cuite ; au-dessous, des constructions en briques crues dont le dÃĐblaiement n'a pu Être terminÃĐ.
Chantier No.5. (
pl.XVI
)
Nous avons ouvert un nouveau chantier sur la Ville Royale, sur la crÊte face à l'ouest ; nous avons nivelÃĐ un espace de 8m. de largeur sur une trentaine de mÃĻtres de longueur, à une profondeur variant de 0m. à 2m. - nous avons rencontrÃĐ des constructions arabes, recueilli des fragments de cÃĐramique, quelques cachets sassanides, des piÃĻces de monnaie ; un grand vase est d'un type nouveau pour cette ÃĐpoque. Citons encore un moule de fondeur en pierre olaire, destinÃĐ Ã fondre des bijoux.
Isthme
Les travaux du Donjon occupant moins de personnel, les ÃĐquipes disponibles ont ÃĐtÃĐ reportÃĐes au Nord, attaquant par l'est et par l'ouest l'Isthme qui prÃĐcÃĻde la presqu'ÃŪle formÃĐe par le Donjon ; nous sommes un peu en avant de la grande porte d'entrÃĐe du palais sassanide.
à l'est, nous avons trouvÃĐ des tombes arabes du IXÃĻme siÃĻcle de notre ÃĻre. (p. 15) Les corps sont parfois posÃĐs sur des dÃĐbris de pierre travaillÃĐes, empruntÃĐes au palais sassanide ; nous avons trouvÃĐ des morceaux de marbre, des fragments de colonnes achÃĐmÃĐnides, un fragment de calcaire sur lequel est ÃĐcrit en grec : ARXIEPEUS, grand prÃĻtre ; une partie de bassin en calcaire blanc porte quelques hiÃĐroglyphes ÃĐgyptiens ; de ce chantier, proviennent quelques fragments de briques ÃĐmaillÃĐes achÃĐmÃĐnides, un petit morceau de tablette en terre cuite de Darius Ier. Plus bas, nous trouvons quelques vases parthes, dont l'un ÃĐmaillÃĐ ; avec des dÃĐbris de vases, nous recueillons plusieurs kilogs de petites piÃĻces en plomb, pesant de 1gr.,5 à 2gr.,5. Ces piÃĻces sont des monnaies de CharacÃĻne, des rois AttambÃĐlos et ThionnÃĻsÃĐs, du premier siÃĻcle avant notre ÃĻre. Nous avons dÃĐgagÃĐ des restes de construction en briques crues ; sur un socle de briques cuites, se trouvait un manchon de puits en poterie, doublÃĐ d'un autre ; c'ÃĐtait peut-Être un rÃĐservoir d'eau. Au niveau infÃĐrieur, -3m., nous trouvons des tombes nÃĐobabyloniennes, accompagnÃĐes de vases de terre cuite ; dans un puits de la mÊme ÃĐpoque, nous trouvons de grandes jarres en terre rouge et des vases fragmentÃĐs, parfois ÃĐmaillÃĐs ; plusieurs ÃĐtaient à long col ÃĐtroit et munis d'une anse. Citons encore quelques fragments de figurines hellÃĐnistiques.
à l'ouest, au dessous du cimetiÃĻre arabe, nous trouvons des tombes ÃĐlamites ; l'une d'elles ÃĐtait dans un vase ventru, à cordons et dÃĐcorÃĐ de peintures. Deux sarcophages ÃĐtaient sans moulures. Une petite statuette hellÃĐnistique, en marbre a ÃĐtÃĐ trouvÃĐe non loin ; (MusÃĐe du Louvre). La tÊte ÃĐtait anciennement rapportÃĐe et manque.
Donjon-
(
pl. XVIII
et
pl.XX
)
Nous avons continuÃĐ les fouilles des IVe et Ve Niveaux. (p. 16) Au IVe Niveau, nous trouvons des sarcophages d'Our III, des tombes en fosses et en jarres ; on recueille quelques vases,armes, anneaux, et perles ; Au VÃĻme, des tombes en fosse, avec des vases de pierre et de cuivre, des vases peints, du XXXÃĻme siÃĻcle avant notre ÃĻre au XXIIIÃĻme (
pl. XXII, 1,2 et 4
) . Nous avons à signaler parmi ces vases peints, quelques types nouveaux : un bol à pied, (Diam. du bord sup. 0m.,205), dÃĐcorÃĐ de damiers, de bandes rouges et noires, (MusÃĐe de TÃĐhÃĐran) ; un vase ÃĐlevÃĐ Ã fond circulaire plat, la panse jusque prÃĻs du col est colorÃĐe en rouge, une large bande rouge est à la base du col, l'espace intercalaire est dÃĐcorÃĐ d'oiseaux, sÃĐparÃĐs par paires, de groupes de traits obliques ; ce dÃĐcor est brun noir - une grande marmite porte au-dessus de la panse un dÃĐcor rouge et noir, suite de triangles, lozanges et traits et une reprÃĐsentation solaire ; une marmite de mÊme type, prÃĐsente l'aigle aux ailes ÃĐployÃĐes ; une autre, une suite de gazelles, de grandes dimensions et de vives couleurs : noir et rouge, mais de formes grossiÃĻrement stylisÃĐes ; (MusÃĐe de TÃĐhÃĐran) ; une autre marmite, de pÃĒte jaune clair, est dÃĐcorÃĐe en brun vert, (MusÃĐe du Louvre) de bande circulaires, de triangles et lignes sinueuses ; ce dÃĐcor s'interrompt pour la prÃĐsentation d'un couple d'ÃĐquidÃĐs de profil à droite ; ils ont la queue lisse, sÃĐparÃĐe seulement à l'extrÃĐmitÃĐ en bouquet de poils ; la criniÃĻre est courte, ce sont des caractÃĻres asiniens, mais la tÊte est petite relativement au corps et les oreilles sont courtes ; le port de la tÊte sur le cou est plutÃīt celui du cheval ; la prÃĐsence du cheval est dÃĐniÃĐ par nombre d'archÃĐologues pour la MÃĐsopotamie avant le XVIIe siÃĻcle avt J.C. ; c'est à tort puisque le cheval est figurÃĐ sur des tablettes de Warka de Ourouk IV, sur des outils en os de Suse de mÊme ÃĐpoque, sur des tablettes proto-ÃĐlamites de Suse, (3.200-3000 avt. J.C.), par une figurine en aragonite d'Aghnil (p. 17). Il est cependant possible que le cheval importÃĐ du plateau iranien, n'ait pas fait l'objet d'ÃĐlevage en MÃĐsopotamie, avant les Assyriens. Nous avons encore à signaler un vase peint de 0m.,52 de hauteur (
pl.XXI
) , à panse haute, colorÃĐe en rouge, puis de bandes noires ; au dessus, jusqu'au col, sont quatre hexagrammes, figure à 6 sommets reliÃĐs par une ligne continue ; cette figure se rencontre sur les tablettes proto-ÃĐlamites, comme signature de scribe ; elle est moins cÃĐlÃĻbre que le pentagramme ou que le sceau de Salomon, qui est aussi un hexagramme, mais qui prÃĐsente des sommets reliÃĐs par trois. Dans cette figure, les six cÃītÃĐs sont ÃĐgaux ; dans la nÃītre, deux de ces mÊmes cÃītÃĐs sont remplacÃĐs par des diamÃĻtres du cercle circonscrit.
Nous avons recueilli dans ce niveau, quelques armes, un miroir, une poignÃĐe de canne en cuivre, quelques figurines de terre cuite, une collection d'empreintes de cylindres sur bouchons de jarres en terre crue, quelques cylindres cachets.
Citons encore de ce chantier, un fragment de vase en bitume taillÃĐ, portant figurÃĐ en lÃĐger relief un motif souvent trouvÃĐ sur les vases peints : demi-cercles concentriques, sÃĐparÃĐs par des champs de deux en deux rayonnÃĐs. (MusÃĐe de TÃĐhÃĐran).
III- TEPE BOUHALLAN
A)- TÃĐpÃĐ Bouhallan A.
Nous avons terminÃĐ le grand sondage commencÃĐ la saison prÃĐcÃĐdente en descendant sur la moitiÃĐ de sa largeur jusquâau sol naturel ; (0m.,50 plus bas que le premier sondage â soit 18m.,30 Ã partir du sommet.) Sur les 2m.,50 de hauteur de travail, nous avons trouvÃĐ :
1o - tiers supÃĐrieur : fragments de poterie peinte ou non, assez nombreux ; gobelets, ÃĐcuelles, marmites, petits cratÃĻres, grands gobelets (p.18) Ã pied creux, poterie grossiÃĻre, Ã pÃĒte rugueuse, peinte ou non, rouge, noire ou grise ; balles de fronde terre cuite, lames de silex avec traces de bitume, lame de silex retouchÃĐe pour lui former une soie dâemmanchement.
2o- tiers moyen ; les fragments de poterie deviennent plus rares ; à signaler : fusaÃŊole peinte ; fragments dâun trÃĻs grand vase de 0m.,015 dâÃĐpaisseur ; une marmite, une coupe avec croix de Malte peinte à lâintÃĐrieur ; un cornet à fond pointu ; des gobelets avec des bandes dans le sens de la hauteur.
3o- tiers infÃĐrieur ; fragments trÃĻs rares ; marmite de 0m.,01 dâÃĐpaisseur, dÃĐcorÃĐe de bandes circulaires, dont deux sont rÃĐunies par de courts traits verticaux ; col de marmite, fragment de sabre ( ?) en terre cuite avec peintures, gobelet à bandes peintes dans le sens de la hauteur du vase ; fragment de grand gobelet avec de la peinture en relief ; fragment de petit cratÃĻre ; poterie jaune grossiÃĻre, poterie rouge à engobe.
La coupe de ce tell montre des sols de chambre ou de silos, des fours jusquâà une profondeur de 5m. (soit 1m. environ au dessus du travail prÃĐcÃĐdent.
B)-TÃĐpÃĐ Bouhallan B.
Ce site est à environ 3km. au Nord-ouest du prÃĐcÃĐdent, et un peu moins loin de Suse que celui-ci. La butte principale, un peu allongÃĐe (70m. sur 60m.) a une douzaine de mÃĻtres de hauteur ; elle est entourÃĐe de nombreux tertres, et vers lâouest se trouve un tÃĐpÃĐ moins important ; en surface de ce site, on trouve de la poterie islamique et des briques cuites, des fragments de poterie sassanide et de la poterie peinte.
Une tranchÃĐe de 2m. de largeur est descendue, de 4m.,35 sur une longueur de 6M. Nous avons trouvÃĐ au dÃĐbut un niveau islamique puis un (p.19) mÃĐlange de poteries sassanides, parthes, sÃĐleucides. Les vases sassanides sont de grandes jarres à fond rond ; du niveau arabe, collier et cornaline inscrite au nom des imams ; plus bas, vers 3m. de profondeur, lames de faucilles et faucille en terre cuite, fragments de vases dâOurouk IV, mais il y a encore un fragment dâÃĐcuelle ÃĐmaillÃĐe sassanido-parthe ; plus bas, vers 4m. apparaissent des fragments de poterie peinte, plus ou moins grossiÃĻre ; mÊlÃĐe encore à de la poterie trÃĻs belle, jaune clair, à bec cylindrique au dessous du col, ou col de vase se terminant par un repli vertical ; un bouchon de jarre en terre crue, une grande ÃĐcuelle blanche ; à 4m.,30, fragments de petits cratÃĻres Suse I, de gobelets, balle de fronde.
Conclusions.
Notre campagne a ÃĐtÃĐ raccourcie par le manque de fonds dÃŧ à la dÃĐvaluation du franc, et par la nÃĐcessitÃĐ de rÃĐparer notre matÃĐriel roulant ; les nouveaux chantiers n'ont pas pu fournir leur appoint, en raison du temps de prÃĐparation nÃĐcessaire et les anciens moins actifs à cause de l'ouverture de nouvelles tranchÃĐes n'ont donnÃĐ qu'au prorata de leur exploitation. Les ouvriers mettent environ huit jours à reprendre les habitudes des outils, et cette pÃĐriode a plus d'importance pour une campagne courte ; nous avons cependant 53 numÃĐros d'inventaire pour Tchogha Zembil et 186 pour Suse et TÃĐpÃĐ Bouhallan ; nous avons transportÃĐ Ã TÃĐhÃĐran 17 caisses d'antiquitÃĐs ; le dÃĐtail en est reportÃĐ aux annexes de notre rapport. AprÃĻs le partage, huit caisses ont ÃĐtÃĐ faites pour Être adressÃĐes directement de Baghdad au MusÃĐe du Louvre ; elles sont arrivÃĐes le 17 Juin, et ont ÃĐtÃĐ remises au DÃĐpartement des AntiquitÃĐs Orientales.


 veuillez patienter...
veuillez patienter...