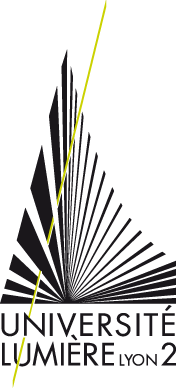Cote conservation : F/17/17258 / Document original conservÃĐ aux Archives Nationales, Paris.
IÃĻre Partie :
Travaux de fouilles.
La Mission de Susiane se trouva rassemblÃĐe à Suse le 26 Janvier, 1937. Elle comprenait cette saison : Mr. R de Mecquenem, Directeur des Fouilles, Mr. et Mme Moghadam, Inspecteurs du Service des AntiquitÃĐs de l'Iran, Mr. J.M. Unvala, docteur en philologie, Mr. J. Michalon, architecte diplÃīmÃĐ.
Du 30 Janvier au 4 FÃĐvrier, la Mission contrÃīla les sondages, effectuÃĐs la saison prÃĐcÃĐdente à TÃĐpÃĐ Bendebal ; le 6 FÃĐv. elle visitait TÃĐpÃĐ Bouhallan. La prÃĐparation de chantiers de Suse, commencÃĐe le 26 Janvier, fut terminÃĐe le 6 FÃĐvrier et les fouilles commencÃĻrent à Suse, le 7 fÃĐvrier, pour se terminer le 20 Mars. Il fut employÃĐ environ mille ouvriers, rÃĐpartis entre 65 ÃĐquipes et six chantiers : Acropole, Ville Royale 1 et 4, Donjon, Ville des Artisans, TÃĐpÃĐ Bouhallan.
ACROPOLE
Chantier n° 2, au Sud du Tell (
pl. I
et
II,1
) .
Au sud-est du chantier, du Niveau II, (environ 10 m. au dessous de la surface primitive) Ã -3m.,50.
Les tablettes proto-ÃĐlamites apparaissent dans le premier tiers de la fouille ; jusqu'à -3m, nous rencontrons des fours, des restes de constructions, dont les murs, en briques crues et terre pilÃĐe, sont conservÃĐs sur une hauteur de 0m.,20 à 0m.,75. Les sols de chambres sont des lits de graviers, ou de terre battue, parfois durcie (p. 2) au feu ou recouverte d'une natte de roseau. Il semble qu'il s'agit de fondations et de caves, plus ou moins habitÃĐes pendant l'ÃĐtÃĐ. Des conduites d'eau, soit ouvertes, soit cylindro-coniques sont souvent posÃĐes sur des briques rectangulaires, longues et minces. Nous trouvons des tombes d'enfants : parfois les ossements placÃĐs dans de grands vases sont discernables ; en gÃĐnÃĐral, la tombe se reconnaÃŪt au mobilier : vases à oreillettes percÃĐes, vases à anses surÃĐlevÃĐes, à becs ouverts ou dirigÃĐs vers le haut, grandes marmites - vases de pierre, gypse et aragonite, collier de perles, cylindres et cachets, amulettes (parmi celles-ci, citons deux petits sangliers en marbre rouge, aux yeux incrustÃĐs de pÃĒte blanche, et dont les pattes de derriÃĻre sont rÃĐunies pour former une sorte de spatule pointue) - le cuivre est rare ; il est reprÃĐsentÃĐ par un outil, un paquet de celts rÃĐunis par l'oxyde, des ÃĐpingles dont la tÊte est parfois ornÃĐe ; nous avons recueilli des supports en pierre pour gonds de porte, des tÊtes de masse ou de canne, des fusaÃŊoles en terre cuite, en gypse, en aragonite, des grosses billes, en bitume, en marbre ; on trouve d'assez nombreux fragments de vases de terre cuite ornÃĐs de peintures rouges et bleu-noir en dessins gÃĐomÃĐtriques, dont la couleur est presque effacÃĐe.
Les rÃĐsultats ÃĐtant plus intÃĐressants à la base de la fouille, nous avons poursuivi en profondeur au-dessous des tranchÃĐes prÃĐcÃĐdentes.
-3m50 à -5m. Vers l'est nous avons presque aussitÃīt atteint le niveau des ÃĐcuelles grossiÃĻres et des vases à becs dirigÃĐs vers le bas ; nous avons recueilli des empreintes de sceaux sur bouchons de terre crue et des tablettes ne comportant que des chiffres. Ces empreintes sont parfois curieuses : l'une d'elles montre un temple ÃĐlevÃĐ sur une plate-forme et des personnages dont un archer ; une autre montre le retour de la pÊche : la barque, à proue relevÃĐe, est laissÃĐe (p. 3) à la garde d'un batelier muni d'une longue perche. Les pÃĐcheurs partent avec leurs prises. Vers l'ouest, nous trouvons des tombes d'enfants : l'une d'elles prÃĐsentait une grande marmite, un petit vase à bec (
pl.IV,1
), un autre à quatre oreillettes, deux vases hauts, un vase conique, une collection de poids en forme de petits pions, un poids en forme de clochette, un cachet en forme de sanglier, des perles cylindriques en fritte, losanges en aragonite, une ÃĐpingle en cuivre.
Le niveau infÃĐrieur, -4m à -9m. a ÃĐtÃĐ exploitÃĐ Ã environ 40 m. au sud du chantier prÃĐcÃĐdent. A l'est, en bordure du tell, le niveau des ÃĐcuelles grossiÃĻres apparaÃŪt à 1m. de profondeur, et, vers l'ouest à 2m. Au-dessus, se rencontrent des tablettes protoÃĐlamites trÃĻs primitives, des vases peints, des fragments de vases peints à dÃĐcors gÃĐomÃĐtriques en noir sur fond rouge. Nous rencontrons des tombes d'enfants : l'une montrait le squelette d'un enfant de moins de 12 ans, couchÃĐ sur le cÃītÃĐ, les membres flÃĐchis, la tÊte au sud ; le mobilier comprenait un collier de perles de terre cuite, de 4m de dÃĐveloppement, des perles de cornaline et de pÃĒte, un cachet archaÃŊque, une fusaiole de terre cuite, une lame de silex. Une tombe, un peu plus profonde, montrait les restes d'un enfant, pris entre deux nattes ; prÃĻs de lui, des ÃĐcuelles grossiÃĻres, un vase biberon, une lame de silex, un poinçon en os, un cachet et un fragment de cachet. Nous avons trouvÃĐ des ÃĐpingles en cuivre, de nombreuses fusaÃŊoles de terre cuite, un petit flacon à trois goulots. - Dans la hauteur moyenne, se trouvaient des constructions en briques crues, aux murs trÃĻs massifs, mais sans continuitÃĐ, des fours, des puits de drainage ; au milieu des ruines, on rencontrait des tombes d'enfants, indiquÃĐes par des paquets d'ÃĐcuelles, de vases à quatre oreillettes ou à anse surÃĐlevÃĐe ou à poignÃĐe versoir ; des vases en pierre et bitume taillÃĐ, des cÃīnes (p. 4) en terre cuite, des cachets plats ; nous avons recueilli des lames de silex et une lame d'obsidienne prises dans leur enduit de montage ; cette derniÃĻre est la premiÃĻre que nous avons trouvÃĐ dans cette condition ; une autre trouvaille exceptionnelle est celle d'une dÃĐfense de sanglier, ÃĐgalement prise dans une pÃĒte bitumineuse, pour servir de couteau ou d'outil ; il est curieux de remarquer que la dÃĐfense se dit "lame" en dialecte louri. Nous avons ÃĐgalement trouvÃĐ deux outils, l'un en cuivre, l'autre en os, pouvant servir de poinçons, avec un manche ovoÃŊde en bitume - des pesons, des percuteurs, en pierre - des bobines ou poids de filet, en terre cuite, des balles de fronde en terre crue, une pointe de flÃĻche en os, de faucilles en terre cuite ; nous avons rencontrÃĐ, à -7m des briques cuites (0m.,30 x 0m.,15 x 0m.,07). à la base du chantier, à l'est, se trouvaient des empreintes sur terre crue et des fragments de vases de Suse I.
La couche infÃĐrieure a ÃĐtÃĐ explorÃĐe ; -9m. Ã -11m.
Nous avons trouvÃĐ plusieurs tombes d'enfants de la plus ancienne civilisation susienne ; elles renfermaient chacune un petit vase peint et un cachet ; on trouvait parfois des figurines d'animaux (
pl.IV,3
et
pl. VI,1
) , surtout des poules et des perdrix, et nous avons reconnu nettement des fragments de figurines humaines, dont une reprÃĐsentant un homme, est peinte et assise (
pl.VI,1
) . Vers l'ouest du chantier, la civilisation prÃĐcÃĐdente, dite des ÃĐcuelles grossiÃĻres ÃĐtait encore reprÃĐsentÃĐe par une ÃĐpaisseur de 0m.,75 et a fourni un lot d'empreintes sur terre crue, comme celles du niveau prÃĐcÃĐdent à l'est ; nous avions eu la saison prÃĐcÃĐdente, un lot d'empreintes analogues et l'originalitÃĐ des reprÃĐsentations nous avait frappÃĐ ; nous hÃĐsitions à les attribuer à la civilisation de Suse I ; cette saison, nous les avons trouvÃĐ accompagnÃĐes de cÃĐramique du niveau supÃĐrieur, qui correspond (p. 5) au niveau IV. de Ouruk-Warka. Les personnages sont vÊtus de longues robes ou de pantalons, coiffÃĐs de bonnets ou de tiares aux grandes proportions ; le soleil, la lune, apparaissent dans le champ avec une facture rappelant plutÃīt l'art de la fin du IIIÃĻme millÃĐnaire que l'art de Suse I ; les personnages des plus anciens vases peints sont vÊtus de pagnes courts et ne paraissent pas coiffÃĐs ; mÊme originalitÃĐ dans les empreintes de ces cachets boutons sans personnages : quelques unes montrent des animaux, mais plus gÃĐnÃĐralement une croix, à centre indiquÃĐ par un petit carrÃĐ, et dont les branches ÃĐgales se terminent par des sortes de fleurons. Ces empreintes sont du reste trÃĻs diffÃĐrentes de celles que nous avons trouvÃĐes dans la couche supÃĐrieure ; notons que les cachets et les cylindres qui servent à les produire nous manquent.
Nous avons poussÃĐ jusqu'Ã -11m. la fouille de la couche archaÃŊque dans l'ouest de la tranchÃĐe ; il nous a semblÃĐ que nombre des fragments de vases peints recueillis n'appartenaient pas aux vases de la nÃĐcropole ; les stylisations de motifs sont diffÃĐrentes et se rapprochent davantage du style des vases trouvÃĐs en dehors de Suse.
Chantier No.3, Ã l'ouest de la tranchÃĐ Morgan.
Nous avons travaillÃĐ là au dÃĐbut de la saison : le chantier avait ÃĐtÃĐ prÃĐparÃĐ les annÃĐes prÃĐcÃĐdentes : il s'agissait d'explorer l'ancienne bordure du tell, que les constructions du village de Suse ne nous permettent plus d'aborder autrement. Au-dessous du IIÃĻme Niveau, nous avons trouvÃĐ des vases de terre cuite et un petit vase de plomb ; à l'ÃĐtage infÃĐrieur, des fragments de vases peints.
Chantier No.4, au centre du tell.
Une recherche antÃĐrieure, vers 1911, avait fouillÃĐ le centre du tell (p. 6), jusqu'à -4m.,50 au-dessous du IIe niveau ; nous avons voulu en profiter pour reconnaÃŪtre l'existence et l'ÃĐpaisseur de la couche archaÃŊque sur ce point. Nous avons tracÃĐ un sondage de 17 m. de longueur et 8m. de largeur ; il a ÃĐtÃĐ descendu à -5m.,70 ; nous avons commencÃĐ de l'approfondir sur une largeur de 6m. Nous sommes parvenus à -6m.,10. Il faut encore peut-Être descendre de 3m. pour rencontrer la couche dÃĐsirÃĐe. Nous avons trouvÃĐ dans ce travail, des sols en terre pilÃĐe recouverte de chaux et de nombreux cÃīnes et clous dÃĐcoratifs, tantÃīt rÃĐunis en paquets, tantÃīt dissÃĐminÃĐs sur une longueur d'environ 1m. Ces amas avaient ÃĐtÃĐ jusque ici considÃĐrÃĐs comme des dÃĐpÃīts de fondation ; il nous paraÃŪt difficile de maintenir cette opinion ; nous avons cinq de ces dÃĐpÃīts rÃĐpartis sur une longueur de 5m.,50 par exemple et à des niveaux variant de 0m.,30 de l'un à l'autre. Nous pensons plutÃīt qu'il s'agit de tombes d'enfants dont les ossements ont ÃĐtÃĐ complÃĻtement dissous, comme nous l'avons souvent constatÃĐ pour des tombes prises dans la terre pilÃĐe ou trÃĻs compacte ; nous avons trouvÃĐ avec ces cÃīnes des fragments de poterie rouge et des clous en bitume taillÃĐ.
VILLE ROYALE
Chantier No.1 ; Ã la pointe sud-ouest. (
pl.V
)
Nous avons enlevÃĐ des dÃĐblais et un peu de terrain au-dessus de la voie de roulage pour dÃĐgager la face nord du chantier et pour enlever une nouvelle tranche dans la partie centrale, la plus ancienne, de la butte funÃĐraire. Cette tranchÃĐe a donnÃĐ trÃĻs rapidement des tombes du XXVÃĻme avant notre ÃĻre ; Ã la base du chantier, nous avons atteint les tombes du XXVIIIÃĻme. Nous avons recueilli de beaux vases de terre cuite parfois dÃĐcorÃĐs de peinture (
pl. VII,1
) . Le plus intÃĐressant est un vase polychrome qui, entre le col et la panse porte des dessins gÃĐomÃĐtriques encadrant un soleil avec figure grossiÃĻrement humaine (p. 7) en son centre, un petit quadrupÃĻde et un personnage en silhouette. Il se trouvait dans une tombe avec des armes, dont une tÊte de canne, en cuivre, et un vase oblong en aragonite, un peu dÃĐformÃĐ par la pression des terres, et dÃĐcorÃĐ d'une tÊte de bÃĐlier en haut relief (
pl.VI,2
) .
Sur la face est du chantier : la moitiÃĐ sud de l'attaque est descendue dans des dÃĐblais, qui ont fourni des perles, des fragments de vases de bitume taillÃĐs (
pl.IX,2
et
X,1
) , des morceaux de tablettes inscrites inutilisables, un fragment important de pot en terre cuite, avec inscription d'Attapakshou (
pl.VIII,2
) . La partie nord a rencontrÃĐ des tombeaux voÃŧtÃĐs ÃĐlamites (
pl.VI,4
) . Le mobilier de ces caveaux comprenait des vases de terre cuite, des poids de balance ; nous avons recueilli des osselets, astragales de mouton et trois osselets en cuivre. Presque tous ces caveaux renfermaient des tÊtes en ronde bosse, en terre crue, avec des traces de peintures, et des yeux rapportÃĐs. Il a pu en Être sauvÃĐ quatre ; deux se rapportent à des femmes (
pl.VIII,1
et
IX,1
) , une à un homme fait, l'autre à un jeune homme (
pl.VIII,3
) . Notons encore de ce mobilier, un poinçon en cuivre, encore emmanchÃĐ dans un cylindre de bois et un fragment d'os portant, incisÃĐs, quelques caractÃĻres cunÃĐiformes.
Au dessous de ces caveaux, l'on rencontrait des traces de dallages, des restes de constructions et au-dessous de la terre pilÃĐe stÃĐrile : ce n'est qu'à la base de la tranchÃĐe, que nous avons retrouvÃĐ des sarcophages des XXÃĻme et XXIIIÃĻme siÃĻcles ; leur mobilier ÃĐtait pauvre ; nous avons eu cependant un vase cylindrique à 4 boutons, dont la panse ÃĐtait dÃĐcorÃĐe d'incisions remplies de chaux et dessinant deux oies et des rangÃĐes de petits cercles superposÃĐes, des vases de cuivre, en mauvais ÃĐtat, quelques cylindres. (p. 8) Nous signalerons un dÃĐ, cube en bitume taillÃĐ ; comme les nÃītres, il porte sur ses faces des points en creux ; sur les dÃĐs classiques, la somme des points de deux faces opposÃĐes est 7, et, si l'on tourne le dÃĐ autour d'un axe perpendiculaire à une face, la somme des points rencontrÃĐs et 14 ; il n'en est pas ainsi sur le dÃĐ du XXIIIÃĻme millÃĐnaire ; les faces 6 et 1, par exemple, sont adjacentes. Ce dÃĐ est le plus ancien rencontrÃĐ, de cette forme ; les spÃĐcimens archaÃŊques connus jusqu'ici, sont à 4 pointes.
Le chantier a fourni de nombreuses figurines de terre cuite, des types connus, des tablettes inscrites, un vase rond en fritte ÃĐmaillÃĐe.
Chantier No.4.
Ce chantier a ÃĐtÃĐ repris seulement dans sa partie est ; il est restÃĐ dans les couches partho-sassanides, sur 5m. de hauteur. Dans des puits, ont ÃĐtÃĐ recueillis des vases et fragments de vases arabes. Le terrain montre des pans de murs en briques crues ; nous avons rencontrÃĐ des tombes d'enfants dans des jarres et recueilli des perles de pÃĒte, des poupÃĐes en os (
pl. XI,3
) ; l'une d'elles montre encore un des bras rapportÃĐ. Nous avons trouvÃĐ des piÃĻces de monnaie, en gÃĐnÃĐral d'ÃĐpoque parthe ; un lot de plus de 200 petits bronzes, prÃĐsente 4 types diffÃĐrents du monnayage de SÃĐleucie sur le Tigre, datÃĐs de 327 de l'ÃĻre sÃĐleucide, soit de la fin du Ier siÃĻcle de notre ÃĻre. Comme à cette date, la ville de SÃĐleucie ÃĐtait en rÃĐbellion, il est possible que ces piÃĻces aient ÃĐtÃĐ frappÃĐes à Suse. à la base, de ce chantier, nous avons trouvÃĐ une volute de chapiteau achÃĐmÃĐnide transformÃĐe en support de gond de porte et deux fragments de pierres inscrites, d'ÃĐpoque respectives nÃĐo-babylonienne et achÃĐmÃĐnide.
Au sud du chantier prÃĐcÃĐdent, sur la presqu'ÃŪle sÃĐparant (p. 9) la Ville Royale du Donjon, une ÃĐquipe a recherchÃĐ Ã l'emplacement sur lequel, la saison prÃĐcÃĐdente, nous avions trouvÃĐ un beau fragment de koudourrou. Nous avons trouvÃĐ un cimetiÃĻre d'ÃĐpoque arabe, datÃĐ par une petite tablette en terre crue (
pl.X,2
) ; elle porte estampÃĐ un verset du Coran ; l'ÃĐcriture la prouve antÃĐrieure au XIÃĻme siÃĻcle. Les corps sont ÃĐtendus de l'est à l'ouest ; la tÊte est souvent trouvÃĐe regardant le sud. Nous avons pu conserver quelques crÃĒnes. Les corps sont souvent placÃĐs sur des lits de cailloux, empruntÃĐs aux dÃĐbris du palais sassanide ; il s'y rencontrait des dÃĐbris de colonnes, de chapiteaux, achÃĐmÃĐnides et partho-sassanides. Nous avons recueilli trois fragments ayant appartenus à des statues, deux petits fragments de marbre portant inscription grecque (
pl.X,5
et
pl.XII,2
) . - Au-dessous, nous avons dÃĐblayÃĐ deux caveaux ÃĐlamites (
pl.XI,4
) : l'un d'eux renfermait une collection de poids en hÃĐmatite. Citons encore de ce chantier une tÊte de lion en fritte ÃĐmaillÃĐe bleue, amulette d'origine ÃĐgyptienne.
DONJON
(
pl.XIV
)
De -3m.,20 Ã -7m.,60-
Tombes du XXÃĻme et XXIIIÃĻme siÃĻcles avt. notre ÃĻre ; jarres funÃĐraires (
pl.XIII,1
) et sarcophages. Nous avons recueilli, quelques cylindres et des tablettes inscrites, un fragment de vase en pierre avec bas-relief, fleur et taureau (
pl. XIII,3
) , deux vases en bitume taillÃĐ, des vases, armes, outils, bague et bracelets de cuivre, des pendants d'oreille en argent, des figurines de terre cuite.
De -7m.,60 Ã -9m.,60-
Tombes à mÊme la terre du XXIIIÃĻme et XXVÃĻme siÃĻcles - Nous avons eu un beau vase incisÃĐ, avec reprÃĐsentation de deux oies ; un couperet en cuivre, dans les moins anciennes ; dans les tombes en fosse, des vases peints monochromes, des armes et miroirs de cuivre (p. 10), quelques cylindres cachets et empreintes sur bouchons de jarres, des fragments de tablettes et des figurines en terre crue.
De -9m.,60 Ã -10m.,60-
Tombes en fosse des XXVÃĻme et XXVIIIÃĻme siÃĻcles avt. notre ÃĻre (
pl. XIII,4
) . Elles se rencontrent dispersÃĐes dans la moitiÃĐ est du chantier. Plusieurs contenaient de nombreux vases de terre cuite, qui dans les plus anciennes fosses ÃĐtaient peints en trois couleurs â noir, et rouge sur fond clair. Les dessins sont en gÃĐnÃĐral gÃĐomÃĐtriques. Un de ces vases fait cependant exception, (Hauteur : 0m.,50 - DiamÃĻtre maximum : 0m.,40) ; c'est une grande marmite carÃĐnÃĐe (
pl. XIII,2
) . La panse est rouge ; l'ÃĐpaule est à dessins noirs et rouges sur engobe crÃĻme. Trois scÃĻnes sont figurÃĐes, sÃĐparÃĐes par des dessins gÃĐomÃĐtriques : Le premier tableau reprÃĐsente de gauche à droite : un personnage, dessinÃĐ en silhouette, assis sur le sommet d'une tour à trois ÃĐtages ; il paraÃŪt signaler à un individu assis dans un char aux deux roues flamboyantes, attelÃĐ d'un bovidÃĐ et que paraÃŪt conduire un troisiÃĻme individu plus petit. Le timon, largement courbÃĐ dans un plan vertical, pour faciliter les tournants, est muni d'un pilier vertical comme on en voit sur les charrues d'ÃĐpoque cassite. Le deuxiÃĻme panneau est occupÃĐ par un grand aigle, les ailes ÃĐployÃĐes, les griffes menaçant deux oiseaux, poules ou perdrix. Le troisiÃĻme reprÃĐsente une tour à trois ÃĐtages sur laquelle trÃīne un personnage : au devant est une deuxiÃĻme tour à deux ÃĐtages avec personnage assis au sommet et, plus loin, un quadrilatÃĻre dressÃĐ sur un petit cÃītÃĐ : des lignes partent du cÃītÃĐ supÃĐrieur : est-ce un autel, un grand vase ou serait-ce le char dÃĐtelÃĐ, vu par l'arriÃĻre. S'il en ÃĐtait ainsi, nous pourrions supposer qu'il s'agit de montrer le voyage du soleil, partant de l'est pour se reposer à l'ouest ; le soleil de midi ÃĐtant symbolisÃĐ par l'aigle. (p. 11) Cette idÃĐe nous est venue à cause du grand nombre de cylindres dont les scÃĻnes sont en rapport avec le dieu solaire, fourni par les tombes de ce cimetiÃĻre. Les cylindres à inscriptions portent en gÃĐnÃĐral le nom de Shamash et de sa parÃĻdre Aa. - D'autres hypothÃĻses ont ÃĐtÃĐ ÃĐmises, telle qu'une figuration du voyage du mort aux enfers.
La peinture de ce vase, trÃĻs visible lors de la dÃĐcouverte, ÃĐtait trÃĻs pulvÃĐrulente et s'attÃĐnuait au moindre souffle ; nous avons dÃŧ la fixer à la gomme arabique pour terminer le dÃĐgagement ; nous avons vainement tentÃĐ d'obtenir une gomme soluble dans l'alcool pour faire du fixatif plus solide ; pour le transport, nous avons fixÃĐ Ã nouveau avec un vernis à l'acÃĐtone et celluloÃŊd. Ce vase unique est au MusÃĐe de TÃĐhÃĐran, ainsi qu'un grand vase à dÃĐcor gÃĐomÃĐtrique trouvÃĐ Ã cÃītÃĐ de lui. La tombe contenait un troisiÃĻme vase, à peinture noire sur engobe crÃĻme, montrant deux suites de gazelles, et huit vases moyens à peintures noires et rouges. à proximitÃĐ, nous avons dÃĐblayÃĐ les squelettes d'une paire de bovidÃĐs. Ces animaux de petite taille ÃĐtaient ÃĐtendus devant les traces noirÃĒtres d'une mangeoire en bois (
pl.XVII
) ; nous avons trouvÃĐ les armatures en cuivre de leur licol et une paire d'entraves ; non loin, nous savons reconnu un squelette humain à cÃītÃĐ de vases de terre cuite commune, un petit couteau de cuivre et une tÊte de canne en argent. Il est difficile d'admettre que ce soit un accident qui ait rÃĐuni bÊtes et gardien dans la mort puisque nous sommes en plein cimetiÃĻre. Nous avons du reste dÃĐjà trouvÃĐ auprÃĻs de deux sarcophages du XXIIIÃĻme siÃĻcle avant notre ÃĻre, des bandages de roues de chars et des reste d'ÃĐquidÃĐs. Il est plus probable que l'attelage de boeufs (p. 12) ou de taureaux a ÃĐtÃĐ sacrifiÃĐ avec son maÃŪtre ; la corrÃĐlation de cette tombe avec la prÃĐcÃĐdente n'est pas assez nette pour imposer l'idÃĐe que le conducteur du char et ses animaux ÃĐtaient sacrifiÃĐs à la mort de leur maÃŪtre ; c'est en tout cas le rapprochement de cette tombe avec la prÃĐcÃĐdente que montre le vase au char attelÃĐ de bovidÃĐs, qui a fait penser à un voyage funÃĻbre. Le sacrifice des familiers sur la tombe de leur maÃŪtre est à Suse exceptionnel ; nous avons trouvÃĐ des jarres funÃĐraires ÃĐlamites contenant des ossements incomplets d'enfants mÊlÃĐs à des os d'animaux ; un petit sarcophage du XXVIIIÃĻme siÃĻcle contenait avec le squelette de l'enfant un crÃĒne d'adulte.
L'ouest de la fouille ne nous a pas donnÃĐ de tombes à vases peints : nous avons trouvÃĐ des dallages et une brique inscrite, un clou dÃĐcoratif au nom de Pouzour Choushinak ; dans un puits nous avons recueilli quelques tablettes.
De -10m.,60 Ã -12m.
Nous avions peine à nous faire à l'idÃĐe que les cinq mÃĻtres qui restent au-dessus du niveau de la plaine, ÃĐtaient du sol naturel : nous avons fait un nouveau sondage sans rÃĐsultat.
VILLE des ARTISANS
Le Dr. Unvala a fait quelques sondages en bordure des ruines en face de la Ville Royale. Il a dÃĐblayÃĐ des constructions arabes, qui nous paraissent avoir ÃĐtÃĐ des sous-sols ; il a trouvÃĐ de grandes jarres, des gobelets ; au-dessous, se trouvaient des jarres funÃĐraires sassanides ; il a ÃĐtÃĐ recueilli de menus objets. Sur un autre emplacement, il a dÃĐblayÃĐ un caveau souterrain de l'ÃĐpoque partho-sassanide (
pl.XXI
) . La chambre mesurait 3m. sur 2m. Le long de trois parois rÃĐgnaient des banquettes, sur lesquelles (p. 13) trois sarcophages ÃĐtaient posÃĐs ; ils contenaient des dÃĐbris d'ossements ; une dizaine de vases ÃĐmaillÃĐs (
pl.XXII
) , une vingtaine de lampes en terre cuite ont ÃĐtÃĐ recueillis. Un escalier, couvert par de petits voÃŧtins dÃĐcrochÃĐs, permettait l'accÃĻs, Ã une profondeur de 4m.,50. Comme les caveaux analogues prÃĐcÃĐdemment dÃĐcouverts, celui-ci a ÃĐtÃĐ conservÃĐ et son entrÃĐe murÃĐe.
Une butte assez basse, à 1km. environ au sud du Donjon a ÃĐtÃĐ explorÃĐe ; il a ÃĐtÃĐ trouvÃĐ plusieurs jarres funÃĐraires et des sarcophages anthropoÃŊdes. Deux couvercles dÃĐcorÃĐs assez grossiÃĻrement de l'"ange de la mort" les ailes repliÃĐes, ont ÃĐtÃĐ rapportÃĐs ; malgrÃĐ nos efforts, ils sont arrivÃĐs en trÃĻs petits fragments ; la vÃĐgÃĐtation les avait atteints et ils avaient ÃĐtÃĐ dÃĐsagrÃĐgÃĐs par les racines. Ces couvercles de prÃĻs de deux mÃĻtres de longueur ÃĐtaient en deux parties : l'un d'eux prÃĐsentait sur chacune de ses moitiÃĐs un monogramme t, peut-Être marque d'atelier qui rappelle des monogrammes relevÃĐs sur la numismatique du Ier siÃĻcle de notre ÃĻre ; c'est du reste la date probable de ce cimetiÃĻre.
TEPE BENDEBAL
Le relevÃĐ du tÃĐpÃĐ a ÃĐtÃĐ exÃĐcutÃĐ par Mr. Michalon. La butte mesure 170 mÃĻtres de longueur et domine le terrain environnant dâune dizaine de mÃĻtres. La rÃĐvision des trois sondages de lâannÃĐe prÃĐcÃĐdente a ÃĐtÃĐ opÃĐrÃĐe par lâabatage de la moitiÃĐ de la longueur des ÃĐtages de pelleteurs. Elle a donnÃĐ les rÃĐsultats suivants : Au sommet, sur une ÃĐpaisseur dâenviron 1 mÃĻtre, terrain de recouvrement avec tombes musulmanes - Fragments de cratÃĻres à 4 boutons de la pÃĐriode dâOurouk IV â Tessons peints : les fragments de vases de la nÃĐcropole de Suse I, grands gobelets et cratÃĻres, à lâexclusion de marmites et coupes, se rencontrent assez frÃĐquents jusquâà -3m.50 et disparaissent à -6m. âà la partie supÃĐrieure, on trouve (p.14) de petits gobelets, à panse galbÃĐe, dÃĐcorÃĐs de bandes et de lignes ponctuÃĐes ; dans la partie moyenne, une forme frÃĐquente est celle de gobelets en cornets, à fond arrondi, de parois trÃĻs minces ; à lâextÃĐrieur du fond est parfois une croix incisÃĐe. Plus bas, ce sont des gobelets plus rÃĐguliers, dÃĐcorÃĐs de bandes longitudinales. Du haut jusquâen bas, sont des marmites de pÃĒte grossiÃĻre jaune, ornÃĐes parfois de bandes ; un exemplaire porte des croix de Malte ; des gobelets, à fond plat et largement ouverts ; ils sont dÃĐcorÃĐs de bandes de dessins gÃĐomÃĐtriques ; des cratÃĻres à large fond plat, trÃĻs foncÃĐs en couleur ; des bols, des coupes dont lâintÃĐrieur est barrÃĐ de traits curvilignes. Nous nâavons pas trouvÃĐ de mÃĐtal dans cette nouvelle coupe, mais de nombreux broyeurs et houes en pierre : des fusaÃŊoles, peintes ou non, en terre cuite, des balles de fronde en terre crue, des lames de silex. Nous avons des perles en terre cuite, en pierre avec des mÃĐplats ornÃĐs dâincisions, des cachets plats, des figurines dâanimaux en terre cuite. Le sol vierge se trouve à -9m. du sommet ; la coupe ci-dessus a donc 8m. de hauteur, pour la pÃĐriode antÃĐrieure à 3.500 avt. notre ÃĻre.
TEPE BOUHALLAN
Ce tÃĐpÃĐ se trouve à 8km. à lâest de Suse, à 1km. de la rive droite de lâAb ÃĐ Diz. Câest une butte assez rÃĐguliÃĻrement conique, dominant la plaine dâune douzaine de mÃĻtres, et dont la base est de 60m. de diamÃĻtre. Le relevÃĐ en a ÃĐtÃĐ fait par Mr. J. Michalon. Une premiÃĻre tranchÃĐe, longue de 11m. large de 5m. à partir du sommet, est descendue à 10m. de profondeur, au N.Ouest. Un sondage, au sud-est, commencÃĐ Ã 2m. environ au-dessous du sommet, est descendu à 8m. au dessous. Il mesurait 11m. sur 7m. Ce travail a ÃĐtÃĐ exÃĐcutÃĐ par trois ÃĐquipes, de 50 ouvriers au total (p.15) entre le 6 FÃĐvrier et le 31 Mars.
La poterie fine de la nÃĐcropole de Suse I, sâest rencontrÃĐe du sommet jusquâà 6m. de profondeur : exclusivement sous forme de bols et gobelets ; on rencontre aussi des gobelets dont le dÃĐcor est original ; et une poterie voisine de celle de BendÃĐbal. Les cornets signalÃĐs de ce dernier site se rencontrent dans toute la hauteur de la coupe, ainsi que les marmites grossiÃĻres, les ÃĐcuelles rouges et noires. Nous avons pu restituer quelques vases nous avons trouvÃĐ un vase grossier et une coupe complets. Nous nâavons pas trouvÃĐ de mÃĐtal, mais des lames de silex et dâobsidienne, des broyeurs, des tÊtes de canne, en pierre ; lâune de ces derniÃĻres en roche noire bien polie est dÃĐcorÃĐe dâincision. Les figurines en terre cuite ont ÃĐtÃĐ rares : nous avons recueilli un beau cachet plat, de forme carrÃĐe avec trou central.
CHOGHA ZEMBIL
Nous avons dÃŧ modifier lâorthographe du nom actuel du site ; à la premiÃĻre visite, en 1935, la phonÃĐtique locale nous avait donnÃĐ Tchoq ÃĐ Zembil, mot persan que lâon nous traduisait le fond du panier ; ce mot Tchoq ou TchÃĒk signifie plutÃīt fissure, fente ; en 1936, à TÃĐhÃĐran, on nous a conseillÃĐ dâÃĐcrire Shoq du mot arabe shq. qui a la mÊme signification que Tchok en persan, mais que lâon nous traduisait cette fois le dessus du panier. Le mot Zembil est un mot persan aussi bien quâarabe ; cependant son origine est persane. Cette discussion a ÃĐtÃĐ reprise cette saison ; le mot Chogha, est lâÃĐquivalent en arabe, du district couramment employÃĐ pour ÂŦ butte artificielle Âŧ ou tell. Le chemin de fer a adoptÃĐ pour nommer la station No.7. non loin de Chogha Zembil, lâappellation ÂŦ Haft Chogha Âŧ du nom du tell ou tÃĐpÃĐ voisin ; elle signifie les sept tÃĐpÃĐs ; le nom de ces ruines nous avait toujours ÃĐtÃĐ (p.16) donnÃĐ comme Haft shagal, les 7 chacals-nom persan- haft nâÃĐtant pas arabe ; lâinterprÃĐtation du chemin de fer nâest pas homogÃĻne, mais le pays ÃĐtant habitÃĐ par des iraniens et des arabes, il est possible quâelle soit vraie ; en tous cas elle prouve la frÃĐquence du mot Chogha, et lâappellation Chogha Zembil ÃĐcarte lâemploi un peu dÃĐlicat du mot TchÃĒk.
Les travaux ont commencÃĐ le 27 Mars, ont ÃĐtÃĐ terminÃĐ le 17 Avril (
pl. XXVIII
) ; il a ÃĐtÃĐ employÃĐ environ 200 ouvriers formant onze ÃĐquipes. La maison de la Mission a ÃĐtÃĐ terminÃĐe le 5 avril ; jusquâalors, la main dâÅuvre ÃĐtait surtout employÃĐe à la recherche des matÃĐriaux dans les fondations des murs dâenceinte. Une tranchÃĐe avait cependant ÃĐtÃĐ poussÃĐe sur la face de la tour à ÃĐtage regardant le Nord-est (
pl. XXVI,1
) et dans lâaxe approximatif de cette face.
Une deuxiÃĻme tranchÃĐe fut ensuite commencÃĐe à une dizaine de mÃĻtres plus au nord. Celle-ci rencontra un parement de briques cuites, à 5 m. plus en avant ; en suivant le sommet de la rangÃĐe de briques, on vit que le niveau de cellesâci sâÃĐlevait en zigzag, et nous pensions dÃĐjà à un escalier ; mais la suite du travail nous donna une chambre, dont les murs avaient ÃĐtÃĐ dÃĐmolis systÃĐmatiquement. Elle mesurait 2m.75 de longueur et il pourrait sâagir dâun sanctuaire.
Nous avons continuÃĐ un dÃĐblaiement de constructions au nord de la Ziggourat, Ã lâextÃĐrieur de la plateforme ; nous avons trouvÃĐ des restes de murs et de dallages, des aqueducs (
pl. XXVI,2
) ; nous avons recueilli des poteries. Un autre dÃĐblaiement a ÃĐtÃĐ commencÃĐ Ã lâest (
pl. XXVII
) ; des murs ÃĐtaient conservÃĐs parfois sur un mÃĻtre de haut ; les chambres nous ont cependant parues Être des caves, nous avons trouvÃĐ quelques vases ; lâun dâeux contenait des perles et (p.17) des perles cachets en fritte ; nous avons recueilli trois petites tÊtes de taureaux en terre cuite, appartenant à des vases ou à des animaux dÃĐcoratifs ; dans les constructions se trouvaient des briques inscrites dâUntash-gal, rÃĐemployÃĐes. Un dallage, fait de carreaux placÃĐs à champ, comprenait uniquement des briques ÃĐmaillÃĐes sur une des faces rectangulaires ; le dÃĐcor sur chacune dâelles ÃĐtait composÃĐ de trois cercles blancs et bleus sur fond bleu. Nous avons trouvÃĐ des dÃĐbris des clous dÃĐcoratifs en poterie trouvÃĐs prÃĐcÃĐdemment avec lâinscription : Moi, Untash-gal (interprÃĐtÃĐe à tort par moi comme Dour Untash gal) et une poterie analogue dont la tÊte ÃĐlargie est dÃĐcorÃĐe de petites bosses circulaires.
Plus loin de la Ziggourat, vers lâest, au delà de la 1ÃĻre enceinte, nous avons continuÃĐ le dÃĐblaiement dâune construction et recueilli des fragments de figurines en terre cuite, de vases en fritte ; parmi ceux-ci, un bassin à 4 pieds, (nous en avons un seul, en forme de pied de taureau).
La plupart des documents trouvÃĐs se rapportent à ce que nous appelons à Suse le nÃĐo-babylonien ; il est possible que cette dÃĐnomination doive comprendre la fin de la pÃĐriode ÃĐlamite et que les ruines trouvÃĐes soient lâeffet du raid dâAssourbanipal mais il se peut que nous ayons affaire aux restes dâune ville restaurÃĐe à lâÃĐpoque nÃĐobabylonienne et abandonnÃĐe à lâÃĐpoque achÃĐmÃĐnide.
APADANA
En 1923, nous avions trouvÃĐ dans la fouille du portique est de la salle hypostyle, un chapiteau bicÃĐphale et lâÃĐlÃĐment de fut de colonne qui venait immÃĐdiatement au dessous ; ces deux masses de pierre ÃĐtaient tombÃĐes à lâest du portique, au dehors, (p.18) de lâenceinte du palais ; nos travaux de recherches du soutÃĻnement en briques cuites, du mur dâenceinte, nous firent dÃĐcouvrir la base de la colonne et un fragment important dâun autre ÃĐlÃĐment du fÃŧt ; la saison suivante, nous fÃŧmes amenÃĐs à recouvrir de terre les parties ornementÃĐes de cette colonnes pour ÃĐviter les dÃĐprÃĐdations et lâeffet des intempÃĐries ; nous avions signalÃĐ le chapiteau au Service des AntiquitÃĐs de lâIran et il avait ÃĐtÃĐ question de le transporter au MusÃĐe. Mr. Moghadam avait reçu des instructions et une avance de fonds pour ÃĐtudier ce transport. AprÃĻs les fÊtes du Naurouz, nous avons fait dÃĐcouvrir les fragments du chapiteau et lâÃĐvaluation du poids total se monta à une quinzaine de tonnes ; la dÃĐpense du transport fut ÃĐvaluÃĐe à une douzaine de mille francs, ce qui dÃĐpassait de beaucoup les crÃĐdits allouÃĐs ; nous avons recouvert à nouveau le chapiteau aprÃĻs avoir mis de cÃītÃĐ les petits ÃĐlÃĐments susceptibles de se perdre ; Ces derniers ont ÃĐtÃĐ emballÃĐs et apportÃĐs à TÃĐhÃĐran par nos soins. Son Excellence, le Ministre de lâInstruction Publique sur le rapport de Mr. Moghadam, appuyÃĐ par Mr. Godard et le Directeur du Service, probablement informÃĐ que la dÃĐvalorisation du franc rendait difficile notre dÃĐpart de Perse, voulut bien nous rembourser les frais que nous avions dÃŧ faire pour ce chapiteau. ; nous avons ainsi reçu la somme de 500 RÃĐals avec beaucoup de reconnaissance.
Conclusion.
La Mission a rapportÃĐ Ã TÃĐhÃĐran 37 caisses dâantiquitÃĐs, correspondant à 450 numÃĐros dâinventaires. Le partage des antiquitÃĐs a pour la premiÃĻre fois ÃĐtÃĐ opÃĐrÃĐ dans les annexes du nouveau MusÃĐe. Le tirage au sort a eu lieu le 4 Mai 1937, sous la prÃĐsidence de Son Excellence Hekmat, Ministre de lâInstruction Publique. Le No 1 a ÃĐtÃĐ attribuÃĐ Ã lâIran. Voici la rÃĐpartition des objets les plus marquants :
Lot 1 Lot 2
2 Vases peints du XXXVÃĻme avt.J.C. 2 Vases peints dito
2 Grds. Vases peints du XXVIIIÃĻme dito 3 Grds. Vases peints dito
1 TÊte de cannne argent dito 2 TÊtes de canne dito cuiv.
3 frgts. de vases à reliefs - XXIIIIe 1 Vase à relief â XXVIIIe.
1 Vase peint et incisÃĐ Do. 1 Vase peint et incisÃĐ - XXII
1 TÊte terre crue XIIIÃĻme 1 TÊte terre crue XIIIe.
1 Vase en fritte ÃĐmaillÃĐe XÃĻme 1 Vase fritte ÃĐmaillÃĐe Xe.
Nous avons laissÃĐ Ã TÃĐhÃĐran outre les deux caisses de fragments de chapiteaux, des briques de construction trouvÃĐes dans les couches archaÃŊques, et des briques voussoirs des tombeaux ÃĐlamites ; une collection de tessons peints de Suse I, 2 lots de monnaies inclassables, des vases arabes, sassanides, ÃĐlamites, trop encombrants pour le transport à Paris. Nous avons rapportÃĐ 13 caisses dâantiquitÃĐs.


 veuillez patienter...
veuillez patienter...