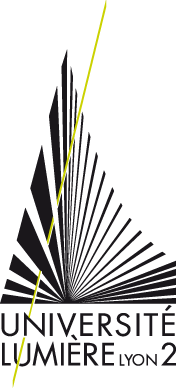Cote conservation : F/17/17257 / Document original conservÃĐ aux Archives Nationales, Paris.
I Travaux et rÃĐsultats.
Les prÃĐparatifs commencÃĐs le 20 DÃĐcembre 1932 furent terminÃĐs le 1er Janvier 1933 ; les travaux commencÃĻrent à cette date. Le nombre des ouvriers employÃĐs ÃĐtait dÃĐjà de 850, le 7 Janvier ; de 935 le 31 du mÊme mois ; il ÃĐtait encore de 892 le 20 Mars, de 826 le 31 ; il descendit à 686 le 6 Avril. Les recherches ont ÃĐtÃĐ arrÊtÃĐes le 14 Avril.
Les ÃĐquipes (57 au maximum), ont ÃĐtÃĐ rÃĐparties sur sept chantiers principaux :
Deux chantiers sur l'Acropole -1 et 2.
Quatre chantiers sur la Ville Royale -1, 2, 3, et Donjon.
Un chantier sur la Ville des Artisans.
Nous avons ÃĐtÃĐ amenÃĐs à faire de plus une petite recherche sur le Tell de l'Apadana.
Travaux sur l'Acropole
1- Sondage au Sud du chÃĒteau (
pl.I
)
Continuation de travaux antÃĐrieurs.-Chantier ouvert le 1er Janvier, arrÊtÃĐ le 14 Avril.
Trois ÃĐquipes (8 wagons) du 1er Janvier au 19 FÃĐvrier ont travaillÃĐ Ã l'ÃĐlargissement de la tranchÃĐe, entre le IIe Niveau et la cÃīte 7,m.75 au-dessous. Il a ÃĐtÃĐ recueilli au cours du travail quelques vases de terre cuite, de petits vases de pierre, des amulettes, des cachets archaÃŊques, des outils de pierre et de cuivre, un outil en os ; lâobjet le plus prÃĐcieux fut une amulette en agate, autrefois sertie dans une monture de mÃĐtal, portant inscription au nom de Kurigalzou.
Le niveau infÃĐrieur fut explorÃĐ Ã la couffe. Nous avions l'annÃĐe prÃĐcÃĐdente reconnu l'existence d'une citerne, rectangulaire en plan (14 mÃĻtres sur 7.), creusÃĐe dans le massif ancien, et garnie de murs de soutÃĻnement en briques cuites ; nous l'avions dÃĐblayÃĐe jusqu'au niveau de 7m,75 au-dessous du IIe Niveau ; un massif ÃĐpais en briques cuites qui limitait la face nord, finissait à ce niveau ; nous en avions conclu Être arrivÃĐ Ã la base de la construction ; en enlevant les briques de la face ouest, nous avons trouvÃĐ un nouveau massif sur cette face ; il se terminait par un escalier (
pl.II,1
) ; la prÃĐtendue citerne ÃĐtait en rÃĐalitÃĐ un grand puits descendant jusqu'au niveau aquifÃĻre ; tous les objets trouvÃĐs dans les terres de remplissage ÃĐtaient d'ÃĐpoque achÃĐmÃĐnide ; nous pouvions supposer qu'il avait ÃĐtÃĐ comblÃĐ Ã (p. 2) l'arrivÃĐe des troupes d'Alexandre le Grand et qu'il avait servi plus ou moins de cachette ; nous avons poursuivi le dÃĐblaiement.
Nous sommes descendus en fin de campagne, à 13 mÃĻtres au-dessous du IIe Niveau sans atteindre le fond ; le niveau hydrostatique doit Être trouvÃĐ 1m,50 ou 2m. plus bas. Le remplissage a l'aspect d'une boue sÃĐchÃĐe ; nous y avons trouvÃĐ des perles de pÃĒte et de cornaline, un cachet cylindrique en agate, avec gravure de style achÃĐmÃĐnide, de nombreux fragments de vase en arragonite, portant inscriptions cunÃĐiformes trilingues et cartouche ÃĐgyptien des rois achÃĐmÃĐnides et particuliÃĻrement XerxÃĻs, des pierres informes qui paraissent par leur matiÃĻre des dÃĐbris de statues archaÃŊques, de morceaux d'oreilles et de cornes en calcaire gris, provenant des chapiteaux bicÃĐphales de l'Apadana ; nous avons trouvÃĐ deux petits fragments d'un vase ÃĐmaillÃĐ ; le dÃĐcor floral est trÃĻs analogue à celui des briques ÃĐmaillÃĐes de l'escalier du palais ; nous en avions recueilli deux fragments l'annÃĐe derniÃĻre, qui avaient ÃĐtÃĐ attribuÃĐs par le sort au MusÃĐe de TÃĐhÃĐran ; notons encore un tesson de pot, portant un graffite de caractÃĻre aramÃĐen, un trÃĻs petit fragment de tablette en terre cuite, charte en langue anzanite de la fondation du palais de Darius. Proviennent des ÃĐboulis du mur de soutÃĻnement, quelques dÃĐbris de briques inscrites d'ÃĐpoque ÃĐlamite.
Nous pouvons conclure de cette exploration que le puits est d'ÃĐpoque ÃĐlamite, qu'il a ÃĐtÃĐ utilisÃĐ seulement comme citerne à l'ÃĐpoque achÃĐmÃĐnide ; cette citerne s'est comblÃĐe peu à peu durant cette pÃĐriode pour disparaÃŪtre aux temps sassanides.
L'exploitation du niveau infÃĐrieur (-7m,75 jusqu'au sol vierge) a montrÃĐ des fonds de silos et deux fours de potier (
pl.III,4
) . Il a ÃĐtÃĐ recueilli des cachets boutons (
pl.III,5
) et des figurines de terre cuite, reprÃĐsentant en gÃĐnÃĐral des animaux, mais aussi une jambe peinte de petit personnage ; citons encore : des balles de fronde en terre crue, des lames de silex et d'obsidienne et surtout des fragments de petites coupes en obsidienne ; de semblables vases ont ÃĐtÃĐ signalÃĐs dans des couches infÃĐrieures de Warka.
Nous avons trouvÃĐ de nombreux fragments de vases peints ou à engobe rouge ; nous n'avons observÃĐ aucun vestige de cuivre, ni du reste, d'aucun mÃĐtal façonnÃĐ.
2- Chantier du sud de l'Acropole (
pl.IV
)
Continuation des travaux de l'annÃĐe prÃĐcÃĐdente. Deux niveaux de roulage, quatre ÃĐtages d'exploitation.
A- entre le IIe niveau et 3m,80 au-dessous
Nous avons trouvÃĐ des tombes à mÊme la terre indiquÃĐes surtout par du mobilier ; les ossements avaient, en gÃĐnÃĐral, complÃĻtement disparu. Les tombes d'enfants ÃĐtaient reconnaissables à la prÃĐsence de colliers de perles de pÃĒte blanche, garnis de petites amulettes, à des jouets, tels que boules polies de marbre ou de bitume, ou palets ou pions de jeux en terre cuite, à des vases en pierre. Il n'a pas ÃĐtÃĐ trouvÃĐ Ã ce niveau de poupÃĐes en terre cuite. PrÃĻs des tombes d'adulte, il y avait de grandes jarres de terre cuite, des ÃĐcuelles grossiÃĻres, des tÊtes de masse en pierre, rarement du cuivre ; il faut citer cependant une pointe de lance de ce mÃĐtal, et quelques ÃĐpingles ; on trouvait des cylindres archaÃŊques, des ÃĐpingles et outils en os. PrÃĻs de l'axe du tell, nous avons recueilli des tablettes proto-ÃĐlamites, en terre crue, des fragments de bouchons (p. 3) de jarres avec des empreintes de sceaux, de petits bouchons portant des signes proto-ÃĐlamites. Les tablettes inscrites se trouvaient encore à la base de la tranchÃĐe. Nous avons recueilli des vases d'arragonite et d'albÃĒtre, des vases dÃĐcorÃĐs de bandes peintes en particulier un vase à bec ouvert ; les vases peints proprement dits à dÃĐcor rouge et noir, ne rÃĐsistant pas à l'eau, ne se rencontraient que tout à fait dans la partie supÃĐrieure de la tranchÃĐe.
B- entre 3m80 et 5m70 au-dessous du IIe Niveau
Nous rencontrons encore des tombes à mÊme la terre indiquÃĐes surtout par des ÃĐcuelles grossiÃĻres, en terre cuite ; on trouve aussi des jarres, des vases à bec, des marmites à anse. Des tombes plus riches prÃĐsentent des vases en pierre, parfois marbre, mais aussi taillÃĐs dans du grÃĻs. Les tablettes proto-ÃĐlamites manquent, mais il se rencontre encore des bulles d'argile crue, soit rondes, comme des boules plus allongÃĐes, parfois plates ; l'une de ces derniÃĻres prÃĐsente en empreinte la reproduction d'un atelier de tissage : de part et d'autre de la piÃĻce, deux individus accroupis se passent la navette ; à l'extrÃĐmitÃĐ opposÃĐe, un ouvrier debout manoeuvre les fil de la chaÃŪne au moyen d'un curieux dispositif. Les tombes d'enfants renferment parfois des figurines d'animaux, plus souvent des fusaÃŊoles et des palets, aussi des clous de terre cuite. Ces derniers objets ÃĐtaient utilisÃĐs pour remplacer nos clous dans des murs de terre crue, et parfois servaient à l'ornementation des murs, mais leur prÃĐsence en groupe dans des tombes d'enfants nous ferait penser que les bambins les utilisaient comme quilles.
Le cuivre est trÃĻs rare. Il apparaÃŪt seulement sous forme d'ÃĐpingles aux tÊtes souvent ornementÃĐes, d'aiguilles parfois longues et minces, rarement des hameçons, on ne trouve ni anneaux ni bracelets.
C- entre 5m70 et 9m10 au-dessous du IIe niveau
à la partie supÃĐrieure de la fouille, les tombes prÃĐcÃĐdentes se retrouvent plus rares ; en profondeur, nous trouvons des restes de constructions, plate formes et murs en briques crues, le plus souvent rectangulaires (28 x14 x10). Les larges faces sont souvent irrÃĐguliÃĻres, mais ne sont pas plan convexes. Il se rencontre aussi quelques briques cuites.
Nous recueillons des outils de potier en pierre et en terre cuite, une collection d'outils en os ; ces derniers sont des stylets taillÃĐs dans des mÃĐtatarsiens et mÃĐtacarpiens de gazelle. Ils portent des dessins au trait souvent curieux ; nous avons eu deux cavaliers coiffÃĐs de bonnets, vÊtus de pantalons ; leur monture et harnachÃĐe, selle et bride. Il ne manque que les ÃĐtriers pour avoir la reprÃĐsentation d'un cavalier persan moderne. Le motif le plus frÃĐquent dans cette sÃĐrie est la chÃĻvre et une sorte de rameau. Les lames de silex et d'obsidienne sont abondantes ainsi que les balles de fronde, les figurines d'animaux parfois peintes. Notons un beau couteau formÃĐ d'une longue lame de silex, avec la poix ou le bitume qui servait à la fixer sur une monture sans doute en bois. AprÃĻs avoir notÃĐ des cuillÃĻres à manche et des palettes en terre cuite, une jolie petite coupe à manche en pierre, nous allons dÃĐcrire avec plus de dÃĐtails les deux trouvailles vraiment intÃĐressantes de cette tranchÃĐe. Elles ont ÃĐtÃĐ faites prÃĻs de la base à une dizaine de mÃĻtres l'une de l'autre, non loin de l'axe du tell.
La premiÃĻre est un galet de riviÃĻre calcaire de forme allongÃĐe, long d'une vingtaine de centimÃĻtres, avec deux mÃĐplats opposÃĐs assez irrÃĐguliers. Il porte une quinzaine de lignes d'ÃĐcriture au qalam (
pl.VI,8
) . (p. 4) Les caractÃĻres sont en gÃĐnÃĐral reliÃĐs les uns aux autres et difficiles à isoler. Cependant la svastika se reconnaÃŪt plusieurs fois. Certains caractÃĻres ont des analogies avec le dÃĐmotique, d'autres avec l'aramÃĐen ; d'autres ressemblent à des signes avestiques. Il s'en faut du reste que la copie soit facile et certaine ; Mr. Unvala en a fait une, j'en ai essayÃĐ une autre et les deux rÃĐsultats sont diffÃĐrents. Le sens mÊme de l'ÃĐcriture varie parfois d'une ligne à l'autre, de mÊme que le mode d'ÃĐcrire comme s'il y avait eu plusieurs scribes. Le galet ÃĐtait pris dans une masse de terre argileuse du chantier ; il n'y avait pas de traces de puits ni de drainage ; nous sommes donc convaincus que ce monument est de l'ÃĐpoque de son gisement ; immÃĐdiatement au-dessus de la couche de Suse I et au-dessous des constructions en briques crues dont nous avons parlÃĐ plus haut, nous lui attribuons l'anciennetÃĐ minimum de 3500 ans avant notre ÃĻre. La prÃĐsence du swastika sur les coupes peintes et sur le beau cachet gravÃĐ que nous avons trouvÃĐ de Suse I, nous porterait à voir dans cette ÃĐcriture archaÃŊque, l'ÃĐcriture des premiÃĻres populations fixÃĐes à Suse. Le dÃĐcor si remarquable de leurs poteries, leurs connaissances mÃĐtallurgiques nous avaient toujours persuadÃĐ qu'ils ÃĐtaient capables d'utiliser une ÃĐcriture.
La deuxiÃĻme trouvaille a ÃĐtÃĐ faite non loin et au mÊme niveau comme nous l'avons dit. C'est un petit lion (L = 0m,13) en bitume taillÃĐ (
pl.VIII, 9,10 et 11
et
pl.IX,12
) . Il est couchÃĐ ; entre ses pattes de devant est un homme assis, les jambes ployÃĐes, le buste lÃĐgÃĻrement penchÃĐ Ã l'avant, les mains posÃĐes sur les cuisses. La partie postÃĐrieure de sa tÊte est dans la gueule ouverte du lion. Les dents de la mÃĒchoire supÃĐrieure de l'animal dessinent en quelque sorte des cheveux sur le front de l'homme, coiffÃĐ par la face de l'animal. La mÃĒchoire infÃĐrieure de celui-ci est figurÃĐe jusqu'à la canine seulement. L'expression du visage humain est tranquille; les coins de la bouche lÃĐgÃĻrement prolongÃĐs vers le bas indiquent un certain dÃĐgoÃŧt ; l'attitude de la bÊte ne marque pas de fÃĐrocitÃĐ, et les lignes de sa face marquent plutÃīt de l'ironie que du triomphe. L'exÃĐcution est magistrale, sans fignolage. La partie infÃĐrieure de l'objet a cependant ÃĐtÃĐ travaillÃĐe pour montrer les pattes du lion et les jambes de l'homme.
Cet ensemble nous rappelle d'abord puisque nous sommes en Perse, les monuments funÃĐraires ÃĐrigÃĐs sur les tombes de chefs, surtout dans les montagnes du Luristan et des Bakhtyaris, mais j'en ai ÃĐgalement vu sur les pentes du Sahend, prÃĻs de Tauris. Ce sont des lions grossiÃĻrement taillÃĐs en pierre ; l'animal ayant dans la gueule ou sous sa patte un crÃĒne ou parfois une boule. Ce symbole avertit le passant que l'individu enterrÃĐ là ÃĐtait un brave.
Le cÃĐlÃĻbre lion de Babylone, Ã prÃĐsent au musÃĐe de Bagdad, est debout, remarquablement sculptÃĐ ; le corps dâun homme, trÃĻs fruste, est ÃĐtendu sur le dos, entre les pattes de l'animal. Ce monument est attribuÃĐ au VIe siÃĻcle avant notre ÃĻre, d'aprÃĻs l'ÃĐtiquette.
Nous pensons que notre petit objet est un ex-voto funÃĐraire, et exprime cette idÃĐe que le mort a ÃĐtÃĐ victime de sa virilitÃĐ dÃĐpensÃĐe au service de son suzerain.
Il se compare au sphinx ÃĐgyptien, qui pourrait Être aprÃĻs tout une stylisation plus avancÃĐe de la mÊme scÃĻne ; de cette reprÃĐsentation toute simple ; l'homme terrassÃĐ par un lion destinÃĐe à la tombe d'un guerrier ; (si simple qu'elle est encore moderne), l'artiste est passÃĐ par le stade de notre objet : l'homme accroupi devant le lion, qui le dÃĐvore seulement virtuellement, avant d'arriver à confondre l'homme et le lion en un seul Être ÃĐnigmatique. Il se pourrait encore que la coutume de reprÃĐsenter l'homme fort et gÃĐnÃĐreux que fut Hercule, avec un vÊtement fait d'une peau de lion (p. 5) soit une rÃĐminiscence occidentale de cette mÊme idÃĐe symbolisÃĐe.
La plus ancienne reprÃĐsentation du lion semblait Être jusqu'à prÃĐsent celle que J. de Morgan avait retrouvÃĐe à Negadah dans une tombe de la premiÃĻre dynastie ÃĐgyptienne. La chronologie actuellement en faveur place le dÃĐbut de cette dynastie vers 3300 avant notre ÃĻre. C'est vers cette mÊme ÃĐpoque que nous plaçons actuellement à Suse, le dÃĐbut des tablettes proto-ÃĐlamites et la cÃĐramique à anses torsadÃĐes, à ÃĐcuelles grossiÃĻres ; le petit lion de bitume et le galet inscrit, trouvÃĐs tous les deux au-dessous des constructions en briques crues, qui semblent marquer le dÃĐbut de cette pÃĐriode, nous paraissent pouvoir Être attribuÃĐs à 3500 avant notre ÃĻre. Notons que nous n'avons pas encore trouvÃĐ dans la couche infÃĐrieure à vases peints du Ier style, de reprÃĐsentations du lion.
D- entre 9m.,10 et 11m,20 au-dessous du IIe niveau
Une tranchÃĐe longue de 100m., large de 3 Ã 5m., a ÃĐtÃĐ poussÃĐe sur les 2/3 de sa longueur, jusqu'Ã 12m,60 au dessous du IIÃĻme Niveau.
PrÃĻs de l'axe du tell, nous avons dÃĐblayÃĐ un grand four, avec sole circulaire de 1m76 de diamÃĻtre (
pl.III,6
), percÃĐe d'une cheminÃĐe et de 45 carneaux aboutissant dans la chambre à feu ; cette derniÃĻre, haute de 0m,90 sous voÃŧte, prÃĐsentait un pilier central, et ,une porte de chargement. PrÃĻs du four, se trouvait un amas de briques crues, lÃĐgÃĻrement incurvÃĐes, destinÃĐes à monter les parois de la chambre de cuisson.
Nous avons recueilli dans cette tranchÃĐe de nombreux fragments de poterie peinte et à engobe rouge ; des lames de silex et d'obsidienne, des balles de fronde ; de rares cachets plats ; quelques figurines. Nous avons atteint le sol naturel presque partout sauf prÃĻs de l'axe du tell. Il suffira pour la suite des travaux sur ce point de descendre jusqu'à 11m.,20 au-dessous du IIÃĻme Niveau et de faire par endroits des sondages de la couche infÃĐrieure. La prÃĐsence de restes de construction, à la cÃīte -8m. nous a fait espÃĐrer des objets intÃĐressants.
Travaux sur la Ville Royale
1- angle sud-ouest (
pl.V
)
Nous avons continuÃĐ le chantier de l'annÃĐe prÃĐcÃĐdente en nous bornant à l'exploitation de l'ÃĐtage infÃĐrieur, entre 5m.,70 et 13m.,20 au-dessous du sol naturel. Seulement 7 wagons et 3 ÃĐquipes y ont travaillÃĐ : du 3 Janvier au 10 Avril.
Nous avons expliquÃĐ antÃĐrieurement qu'il s'agit d'une butte funÃĐraire, constituÃĐe par des tombes amoncelÃĐes en ÃĐcailles. Nous avions l'annÃĐe derniÃĻre dÃĐpassÃĐ le noyau central constituÃĐ par des tombes à fosses, comportant un mobilier de vases peints et d'objets de cuivre, que nous avons attribuÃĐes à 2800 avant notre ÃĻre. Cette annÃĐe, nous ne les retrouvons plus à la base de notre tranchÃĐe, mais les tombes en fosses contenant des vases à anse pastillÃĐ, des coupes à libation de 2.500 avant notre ÃĻre. Vers la cÃīte -11m. et au dessous nous trouvons des sarcophages de 2.300 datÃĐs par la prÃĐsence de briques inscrites au nom de Gimil-Sin, roi d'Our. Bien que nous soyons arrivÃĐs à ce mÊme niveau dans nos tranchÃĐes du Donjon, nous n'avons pas voulu abandonner cette tranchÃĐe, parce que les tombes ÃĐtaient relativement plus riches.
Nous avons en effet recueilli deux vases en terre noire, cylindriques, avec quatre boutons percÃĐs pour anses funiculaires ; ils sont dÃĐcorÃĐs de dessins incisÃĐs, dans des cadres peints de rouge ; l'un d'eux montre (p. 6) quatre compartiments ; deux d'entre eux sont remplis de lignes de cercles ; un troisiÃĻme par une chÃĻvre sauvage, passant ; dans le quatriÃĻme, un hÃĐron (?) est perchÃĐ sur le dos d'un poisson (barbeau?) et le dÃĐvore (
pl.XIX, 25
) . L'autre vase est dÃĐcorÃĐ de deux compartiments de cercles sÃĐparant deux chÃĻvres sauvages. Les incisions sont remplies de pÃĒte calcaire trÃĻs blanche, ressortant bien sur le fond sombre.
Une ÃĐcuelle de bitume taillÃĐ est dÃĐcorÃĐe d'une tÊte de bÃĐlier en haut relief (
pl.XI, 14 et 15
) ; le corps de l'animal est indiquÃĐ en lÃĐger relief sur la panse de la coupe ; la toison est figurÃĐe.
Un grand plateau en terre cuite, Ã engobe rouge, comportait trois pieds (pl.X,13) ; nous n'en avons retrouvÃĐ qu'un, assez analogue, aux pieds des meubles Louis XV.
Les plus riches sarcophages ont fourni des diadÃĻmes de clinquant d'or, d'argent, des bracelets d'or et d'argent, des colliers de perles d'or, d'agate, de cornaline, des cylindres (
pl.XIII,18bis
) ; le plus prÃĐcieux ornement recueilli fut un petit aigle en or (
pl.XI,16
) : les ailes ÃĐployÃĐes sont garnies de restes d'ÃĐmail bleu et blanc ; les pattes sont ramenÃĐes sur la poitrine, plante vers l'observateur, dans une attitude de priÃĻre. Cet objet fait penser aux faucons dÃĐcorant les pectoraux ÃĐgyptiens mais l'attitude de l'oiseau est diffÃĐrente ; du reste, nous pensons que ces bijoux d'Egypte ne sont connus que des Ramessides, soit un peu postÃĐrieurs au nÃītre.
Parmi les objets de cuivre, signalons des haches et des poignÃĐes de canne ; lâune de celles-ci prÃĐsente deux ailes de part et d'autre de la douille, sur lesquelles sont des ornements en relief ; sur l'une on voit d'un cÃītÃĐ un petit lion et de l'autre une petite chÃĻvre (
pl.XII,17
) , sur l'autre, est de chaque cÃītÃĐ, une ligne ondulÃĐe. Le style de ce dÃĐcor rappelle les reliefs de bronze du Louristan. Nous avons trouvÃĐ des miroirs, avec ou sans poignÃĐe (
pl.XVII,24
) ; l'un de ces derniers est recouvert d'une mince couche d'argent. Une longue tige pointue d'un cÃītÃĐ est divisÃĐe de l'autre en trois palettes, à 120° ; peut-Être est-ce une broche, avec une manivelle? Un autre objet ÃĐnigmatique est une tige de section rectangulaire, terminÃĐe à chaque extrÃĐmitÃĐ par une petite pale arrondie (
pl.XVII,24
) ; la tige a ÃĐtÃĐ trouvÃĐe, tordue sur elle-mÊme, de sorte que l'apparence est celle d'une hÃĐlice. Etait-ce la position d'abord envisagÃĐe pour permettre un brassage de liquide? Signalons plusieurs poignards ; l'un d'eux avait une poignÃĐe garnie d'une mince feuille d'argent fixÃĐe avec des clous dorÃĐs. Une lance, tige de cuivre, de section carrÃĐe, conservÃĐe avec une douille en cuivre qui sertissait l'extrÃĐmitÃĐ du bois.
Le mobilier comportait encore des vases de cuivre, de formes diverses, surtout de simples marmites à deux anses, des vases de terre cuite, parfois peints. L'un d'eux est un gobelet, presque cylindrique, avec une dÃĐcoration de bandes circulaires, un carrÃĐ en damier, un autre occupÃĐ par des lignes obliques. Un autre est une sorte de marmite avec des rameaux ou des mains peints sur la panse.
Les tombes de la couche supÃĐrieure, de 2.000 avant notre ÃĻre, ÃĐtaient plus pauvres et nous n'avons recueilli que quelques poids en pierre et de plus petits en hÃĐmatite. Notons, tout en haut de la derniÃĻre tranchÃĐe, un lot de 120 tablettes de comptabilitÃĐ en terre crue. De plus, un assez grand nombre de lames de silex avec leur enduit de bitume, ayant servi à les monter en faucilles.
(p. 7)2- milieu de la bordure regardant le sud-ouest
Reprise de travaux antÃĐrieurs. Ce chantier a ÃĐtÃĐ ouvert le 2 Mars et arrÊtÃĐ le 9 Avril.
Travail à trois niveaux.
Niveau infÃĐrieur. Des ÃĐquipes ont dÃĐblayÃĐ Ã la couffe, le fond du sondage jusqu'au sol vierge ; il a ÃĐtÃĐ mis au jour des tombes à fosse avec mobilier de vases peints.
Niveau moyen. Deux ÃĐquipes (6 wagons) sont descendues dans la couche des tombes de 2300 avant notre ÃĻre ; il a ÃĐtÃĐ dÃĐblayÃĐ deux sarcophages et des vases funÃĐraires. Nous avons recueilli quelques figurines et des tablettes inscrites ; nous espÃĐrions bien de l'intÃĐrÊt de l'une d'elles, trÃĻs grande, mais elle s'est trouvÃĐe relater un simple relevÃĐ cadastral.
Niveau supÃĐrieur. Ce chantier a ÃĐtÃĐ plus actif ; le niveau sassanide et trÃĻs ÃĐpais sur ce point, constituÃĐ surtout par un remblayage (12m.) au dessous de constructions. Il a ÃĐtÃĐ rencontrÃĐ des tombes d'enfants dans des jarres et des sarcophages ; les puits ont fourni des lampes, des gourdes et de vases de terre cuite. Il a ÃĐtÃĐ recueilli des petits objets, figurines et piÃĻces de monnaie en cuivre ; au milieu du remplissage, nous avons trouvÃĐ un tombeau ÃĐlamite, voÃŧtÃĐ, en briques cuites ; il renfermait les restes de deux individus, quelques vases de terre cuite, des poids de balance en pierre et une belle marmite en arragonite.
Notons encore un petit fragment d'inscription achÃĐmÃĐnide sur calcaire noir.
3- Milieu de la bordure regardant le Nord-ouest (
pl. XIV
et
XXIII, 29
)
Reprise de travaux commencÃĐs en 1930-1931 et non repris l'annÃĐe derniÃĻre. La tranchÃĐe avait rencontrÃĐ de nombreux fragments de matÃĐriaux provenant de l'Apadana et nous avons espÃĐrÃĐ trouver de nouveaux ÃĐlÃĐments de bas-reliefs. Nous avons travaillÃĐ activement du 4 Janvier au 2 Mars.
Nous avons dÃĐblayÃĐ des constructions arabes ; les unes au niveau de la plaine et d'autres montant sur les pentes du tell ; nous avons rencontrÃĐ un escalier desservant le niveau supÃĐrieur (diffÃĐrence de niveau de 5m). Nous avons trouvÃĐ des vases en terre cuite, des dÃĐbris de vaisselle en terre cuite ÃĐmaillÃĐe, des fioles de verre ; au dessous du niveau arabe, nous avons trouvÃĐ les constructions sassanides, avec leurs puits de dÃĐcharge ; nous avons obtenu des vases de terre cuite, quelques figurines, de rares cylindres et cachets. Les constructions sassanides suivent la mÊme disposition que les maisons arabes, leur niveau s'ÃĐlevant vers l'intÃĐrieur du tell. Une tranchÃĐe plus profonde nous a fait reconnaÃŪtre le niveau nÃĐo-babylonien, avec des petites figurines en fritte ; le peu de rÃĐsultats obtenus nous a fait diffÃĐrer la suite de l'exploration.
4- Donjon
(
pl.XVIII
et
pl. XXXIV, 52
)
C'est là que fÃŧt portÃĐ notre principal effort du 2 Janvier au 10 Avril.
Nous avons achevÃĐ de niveler la butte jusqu'au dessous des fondations du palais sassanide ; nous sommes descendus à 2 mÃĻtres plus bas, sur les deux tiers de la surface ; nous avons largement prÃĐparÃĐ l'exploitation du niveau infÃĐrieur (7,70 m au-dessous du sommet primitif).
Etage supÃĐrieur. Du sol primitif au niveau du dallage sassanide (de 0m à -1m.20)
(p. 8) Nous avons trouvÃĐ de nombreuses tombes à mÊme la terre, du dÃĐbut de l'hÃĐgire et sassanides ; nous avons conservÃĐ quelques crÃĒnes ; sur l'un deux nous avons observÃĐ de nombreuses perforations circulaires de 0m.,005 de diamÃĻtre ; elles nous ont paru le travail de quelques insectes à dÃĐterminer. Des perforations analogues de plus grand diamÃĻtre cependant ont ÃĐtÃĐ observÃĐes sur des crÃĒnes prÃĐhistoriques et ont ÃĐtÃĐ attribuÃĐes à des trÃĐpanations posthumes. Nous avons trouvÃĐ quelques colliers de perle de pierre et de pÃĒte, des amulettes, dans les tombes d'enfants. Nous avons rencontrÃĐ quelques pierres, rÃĐemployÃĐes dans l'ÃĐdifice sassanide, telles que : base de colonne achÃĐmÃĐnide, fragment d'inscription achÃĐmÃĐnide (
pl.XXV,35
) , gros bloc de calcaire avec inscription grecque, fragment de marbre avec inscription grecque (
pl.XXX,41
et
XXXI, 42
) , et des dÃĐbris ÃĐgarÃĐs dans les ÃĐboulis : fragment de statuette en fritte ÃĐmaillÃĐe de bleu, avec des traces d'inscription hiÃĐroglyphique dans un cartouche (
pl.XXVI,36
) , une ÃĐpaule de statue en marbre, un petit pied de mÊme matiÃĻre, des briques ÃĐmaillÃĐes achÃĐmÃĐnides (
pl.XXV,34
) , quelques figurines et vases de terre cuite. Parmi les jarres, remplies de terre, placÃĐes verticalement pour maintenir les terres du mur d'enceinte, nous avons conservÃĐ une grande jarre, estampillÃĐe de la galÃĻre de Sidon et par consÃĐquent achÃĐmÃĐnide ou sÃĐleucide (
pl.XXVII,37
et
XXVIII, 37 bis
) .
Etage moyen, de -1m20 Ã -3m20
Entre les massifs de fondation du palais sassanide, nous avons dÃĐblayÃĐ plusieurs tombeaux voÃŧtÃĐs, du dÃĐbut de l'Elam (
pl.XXIX, 40
et
XXXIII, 47 et 48
) ; nous avons recueilli des vases de terre cuite, des figurines de terre cuite et en particulier une collection de tÊtes de poupÃĐes en terre crue et en terre cuite (
pl.XXXI, 43
) ; des trous, à la base du cou et sur le pourtour du front, permettaient de fixer vÊtements et coiffures ; les terres cuites ÃĐtaient peintes ; nous avons trouvÃĐ un corps de terre cuite pour l'une de ces poupÃĐes (
pl.XXXII, 44
) ; c'est une simple plaquette de forme rectangulaire, avec un trou central et des logements pour les bras articulÃĐs ; nous avons trouvÃĐ un fragment de bras, mais qui paraÃŪt trop petit pour ce corps ; une petite poupÃĐe de terre cuite trouvÃĐe au mÊme lieu, ÃĐtait percÃĐe de trous permettant une suspension par fils, comme pour une marionnette (
pl.XXXII, 45
) . Nous avons eu de ce niveau des tablettes de terre crue ; quelques piÃĻces de monnaie dont une petite collection d'Alexandre le Grand.
De -3m20 Ã -5m60
Nous avons dÃĐblayÃĐ de nombreux sarcophages (
pl.XXXIII, 49
;
pl. XXXIV, 50 et 51
) et vases funÃĐraires en terre cuite. Ils ne renfermaient en gÃĐnÃĐral que peu d'objets ; on trouvait surtout des outils en cuivre, et nous pensions que cette butte ÃĐtait un cimetiÃĻre d'artisans. Cela semblait corroborÃĐ par la trouvaille dans le secteur est de nombreux moules de fondeurs en grÃĻs tendre ou en serpentine, parfois complets en deux parties, souvent rÃĐduits à une moitiÃĐ, ou cassÃĐs, et des pierres de mÊme nature oÃđ le moule ÃĐtait parfois seulement ÃĐbauchÃĐ. C'ÃĐtaient des moules de pointes de flÃĻches, de javelines, de poignards, d'ÃĐpingles, des types trouvÃĐs dans la pÃĐriode Our III.
Nous avons recueilli dans les sarcophages de nombreux fragments d'os travaillÃĐs pour incruster des boÃŪtes en bois, pensons-nous, mais nous n'avons pu arriver à reconstituer aucun ensemble et il n'avait ÃĐtÃĐ mis dans les tombes que des ÃĐchantillons, semble-t-il. Dans les terres, nous trouvions cependant des dÃĐbris d'ÃĐcuelles et de plateaux en bitume taillÃĐ qui encourageaient nos efforts ; ce (p. 9) ne fut cependant que vers le milieu de Mars, que nous trouvÃĒmes quelques objets intÃĐressants une statuette en terre crue de dÃĐesse debout (
pl. XXXVII, 57
) ; elle est vÊtue d'une robe à franges, les deux mains sont levÃĐes devant la poitrine, attitude de priÃĻre ; un vase rond taillÃĐ dans du bitume, le bord est dÃĐcorÃĐ de coquille, une anse est formÃĐe de deux plaques superposÃĐes, rejointes par une paire de figurines (hauteur 0m08) analogues comme costume et attitude à la statuette dont nous venons de parler, les tÊtes couvertes d'un bonnet (
pl.XLIII, 73 et pl. XLIV, 74
) ; un vase de mÊme forme et de mÊme matiÃĻre montre une anse formÃĐe d'une chÃĻvre sauvage accroupie (
pl. XLII, 72
) ; la tÊte de l'animal est tournÃĐe vers le vase ; les cornes dÃĐtachÃĐes de la masse ne sont pas complÃĻtes ; le corps de l'animal est couvert de traits fins et rÃĐguliers, figurant les poils ; une ÃĐcuelle de mÊme matiÃĻre n'est qu'à demi conservÃĐe, elle est dÃĐcorÃĐe d'une tÊte de bÃĐlier en haut relief, les yeux ÃĐtaient incrustÃĐs de coquille (
pl. XLI,71
) .
Nous avons recueilli dans ce niveau de nombreuses tablettes en terre crue gÃĐnÃĐralement en assez mauvais ÃĐtat, surtout des tablettes en forme de lentilles, des figurines de terre cuite (prÃĻs d'un four, 70 figurines de femme, les mains croisÃĐes sous la poitrine) (
pl. XXXVIII
et
XXXIX
) , des vases de cuivre des armes (
pl. XXXVIII,1
) et des outils de mÊme mÃĐtal, quelques diadÃĻmes de clinquant d'or, des perles en pierre et d'or, parfois filigranÃĐ, de nombreux cylindres cachets ; notons une empreinte sur terre crue (
pl. XXXIX, 65
) . Elle montre une divinitÃĐ assise sur un trÃīne formÃĐ par les plis du corps d'un serpent à tÊte presque humaine ; le dieu tient un caducÃĐe ; M. Godard nous a dit avoir vu la mÊme reprÃĐsentation sculptÃĐe en bas relief sur un rocher de la vallÃĐe de Chapour prÃĻs de Kazeroun ; cela implique la souverainetÃĐ susienne sur l'Anzan au temps de la IIIe dynastie d'Ur.
A la base du niveau nous avons trouvÃĐ des restes de constructions, pans de murs et dallages. Parmi les briques se trouvaient des fragments inscrits au nom de Doungi, premier roi de la IIIe dynastie d'Ur.
De -5m60 Ã -7m70
Une longue tranchÃĐe (115m) traverse le champ de fouilles, de l'est à l'ouest, dans la partie nord du chantier ; elle a rencontrÃĐ des vases funÃĐraires et des tombes à mÊme la terre, avec mobilier de vases de terre cuite, annonçant le niveau de 2500 avant notre ÃĻre. Elle a rencontrÃĐ les fondations du mur d'enceinte à l'est (celles-ci descendent encore plus bas, du reste) et les a traversÃĐes ; il a ÃĐtÃĐ trouvÃĐ dans le voisinage un fragment dâune stÃĻle de Choutrouk NakhountÃĐ (
pl. XLVI, 79
) .
Une amorce de tranchÃĐe, parallÃĻle à la prÃĐcÃĐdente, d'une trentaine de mÃĻtres de longueur, mais au milieu de la fouille, du cÃītÃĐ est, rencontre encore jusqu'à sa base les tombes et les sarcophages de 2300 avant notre ÃĻre, mais plus riches semble-t-il que celles du niveau supÃĐrieur. Un sarcophage ÃĐtait rectangulaire avec un fond et un couvercle ; les parois ÃĐtaient renforcÃĐes par des cordons en relief (
pl. XLIV, 74
) ; il ne contenait pas d'ossements. Non loin, nous avons recueilli une coupe en albÃĒtre ; la panse ÃĐtait dÃĐcorÃĐe en bas-relief, d'un lion devant un taureau (
pl. XLV, 76
) ; trois serpents formaient une anse. Dans une autre tombe, se trouvait un vase au dÃĐcor incisÃĐ, rempli de pÃĒte blanche ; quatre compartiments ÃĐtaient sÃĐparÃĐs par des bandes peintes en rouge ; deux de ceux-ci ÃĐtaient occupÃĐs par des lignes de petits cercles ; un autre par une oie, le quatriÃĻme par une barque avec des rames (?) levÃĐes ; dans un (p. 10) sarcophage, fut trouvÃĐe une ÃĐcuelle de bitume taillÃĐ (longueur maxima 0m.,21), dÃĐcorÃĐe d'une tÊte de taureau en ronde bosse (
pl. XLV, 77
et
XLVI, 78
) .
On le voit, la succession des couches est tout à fait rÃĐguliÃĻre ; le centre de la butte funÃĐraire se trouvait dans l'axe de notre tranchÃĐe nord ; la fortification achÃĐmÃĐnide rÃĐparÃĐe par les sassanides a donnÃĐ Ã la butte une apparence de bastion compris entre deux lignes parallÃĻles nord-sud arrÊtÃĐes au sud par une muraille est-ouest, puis par une ligne sud-est, nord-ouest. C'est un ravinement postÃĐrieur à l'ÃĐpoque sassanide qui a isolÃĐ le Donjon de la Ville Royale, par un grand ravin sur la face regardant le Sud-ouest, que nous avons explorÃĐ l'annÃĐe derniÃĻre, et sur la face regardant le Sud-est, par un autre ravin que nous avons explorÃĐ cette saison.
De ce dernier point, nous avons peu à dire, nous avons dÃĐblayÃĐ des constructions sassanides en briques crues, trouvÃĐ des aqueducs et des puits de dÃĐcharge ; nous avons observÃĐ quelques tombes de basse ÃĐpoque, recueilli une gourde ÃĐmaillÃĐe, une main en marbre de statue sans doute d'ÃĐpoque parthe (
pl. XLVII, 80
) , quelques figurines (
pl. XLVII, 81
) , une coquille dont la nacre ÃĐtait gravÃĐe.
Notre niveau infÃĐrieur (-7m.,70) est du cÃītÃĐ de l'Est à 8m seulement au dessus de la plaine, mais encore à 15 mÃĻtres au-dessus de la route, du cÃītÃĐ de l'Ouest. Il nous semble, d'aprÃĻs l'exploration des ravins que les terres rapportÃĐes ont bien cette derniÃĻre ÃĐpaisseur ; nous avons donc la possibilitÃĐ de trouver sur ce point tous les niveaux de Suse, et une grande facilitÃĐ pour l'ÃĐvacuation des dÃĐblais et une concentration de chantiers, nous permet une exploration ÃĐconomique. Jusqu'à prÃĐsent, la terre n'ÃĐtait pas trÃĻs tassÃĐe et le dÃĐgagement des objets plus facile que dans les autres chantiers de la Ville Royale ; en revanche, la densitÃĐ des objets intÃĐressants ÃĐtait cette annÃĐe plus faible, mais il est possible qu'elle s'accroisse en profondeur. Une autre remarque en passant, les rÃĐsultats de cette saison ont un caractÃĻre gÃĐnÃĐral trÃĻs mÃĐsopotamien ; nous ne trouvons rien d'anzanite ; cela peut tenir à ce que Suse ÃĐtait nettement sous la suzerainetÃĐ de la ChaldÃĐe, sous Doungi et ses successeurs comme sous Hammourabi, et c'est cette pÃĐriode que nous venons de reconnaÃŪtre, mais il semble plutÃīt que nous sommes dans le quartier sÃĐmitique de la ville ; c'est du reste le Sud des ruines, face à la MÃĐsopotamie que nous travaillons ; ce n'est qu'à la fin de cette exploration, qui peut nous occuper encore deux ou trois saisons que nous pourrons rechercher sÃĐrieusement au nord de la Ville Royale des restes de la civilisation purement susienne.
Travaux à la Ville des Artisans
Comme ces derniÃĻres annÃĐes, en fin du saison, du 1er Mars au 6 Avril, le Dr. Unvala continua ses recherches à la Ville des Artisans ; un ouvrier nous avait apportÃĐ deux figurines de plÃĒtre sculptÃĐes qu'il prÃĐtendait avoir trouvÃĐ prÃĻs du chantier qui, l'annÃĐe prÃĐcÃĐdente avait vu la dÃĐcouverte d'un tombeau voÃŧtÃĐ sassanide. De nouvelles recherches furent faites pour trouver le complÃĐment de ce dÃĐcor, mais ce fut en vain ; la poursuite de l'exploration du petit tell, entamÃĐ l'an dernier se heurta à un massif de briques crues et fut abandonnÃĐ de mÊme. M. Unvala revint alors sur la face des ruines opposÃĐes à la Ville Royale ; il eut la chance de trouver au centre d'un petit tertre, un caveau voÃŧtÃĐ sassanide (
pl. XLVIII, 82
) . La voÃŧte ÃĐtait en partie effondrÃĐe de sorte que le caveau put Être vidÃĐ par le haut ; il renfermait trois sarcophages (
pl. XLVIII, 83
) , dont deux ÃĐmaillÃĐs ; il a ÃĐtÃĐ (p. 11) recueilli dans les terres de remplissage quelques lampes de terre cuite, des vases ÃĐmaillÃĐs ou non, quelques figurines, des perles de cornaline, de petits objets.
à noter de ce chantier, une belle jarre en terre cuite rouge, à deux anses, et au fond prolongÃĐ en pointe (
pl. XLIX, 84
) , un scarabÃĐe-cachet d'origine ÃĐgyptienne, quelques jetons en terre cuite jaune portant des empreintes de style hellÃĐnistique, une petite terre cuite moulÃĐe en forme de colonne cannelÃĐe, des piÃĻces de monnaie de cuivre.
Travaux à l'Apadana
PrÃĻs de la porte orientale du palais achÃĐmÃĐnide, des gamins avaient signalÃĐ des fragments de cailloux avec des inscriptions. Une ÃĐquipe travailla à cet endroit à plusieurs reprises ; dans le gravier, à son contact avec le mur d'enceinte, nous avons trouvÃĐ quelques fragments inscrits, dissÃĐminÃĐs.
Inventaire
L'inventaire des documents les plus intÃĐressants a ÃĐtÃĐ dressÃĐ en 14 opÃĐrations. Il prÃĐsente 865 numÃĐros contre 1038, en 1932, bien que notre effort ait ÃĐtÃĐ plus grand. Cette diffÃĐrence tient à ce que l'annÃĐe prÃĐcÃĐdente a fourni davantage de fragments de pierres inscrites, bas-reliefs, provenant des dallages et fondations du palais sassanide, et que cette fois, nous avons peu travaillÃĐ dans les niveaux ÃĐlamites et nÃĐo-babyloniens. Ces rubriques ont manquÃĐ sur nos listes. En tout cas, nous avons trouvÃĐ plus de tablettes inscrites et plus de cylindres-cachets (290 contre 222) et les piÃĻces de "musÃĐe" ont ÃĐtÃĐ plus nombreuses que lors de la campagne prÃĐcÃĐdente.


 veuillez patienter...
veuillez patienter...