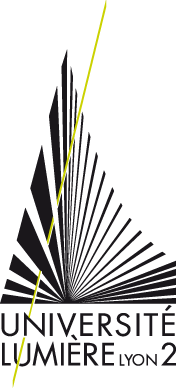Cote conservation : F/17/17255 / Document original conserv├® aux Archives Nationales, Paris.
Fouilles arch├®ologiques de Perse
Rapport de Mission
Campagne de fouilles ├Ā Suse
1926
I.
Partie arch├®ologique
Les travaux ont port├® sur les tells de lŌĆÖAcropole, de lŌĆÖApadana, de la Ville Royale. Quelques recherches ont ├®t├® faites sur la Ville des Artisans, au t├®p├® Dou├½cya et au t├®p├® Djafferabad.
Travaux ├Ā lŌĆÖAcropole.
Le sondage en profondeur commenc├® pr├©s du ch├óteau, en 1924, a ├®t├® poursuivi. Nous rappelons quŌĆÖil sŌĆÖagissait dŌĆÖobtenir une coupe des terrains du tell ├Ā comparer avec celle de la grande tranch├®e du Sud-Ouest, et en particulier de v├®rifier la position de la c├®ramique peinte du premier style. Cette fouille longue de trente m├©tres a atteint vingt m├©tres de largeur au III┬░ niveau, cinq m├©tres au IV┬░ niveau et trois m├©tres pour la derni├©re partie du travail, ├Ā 11m25 au-dessous du II┬░ niveau. Le sol naturel doit se trouver encore ├Ā trois m├©tres plus bas. (p.2)
Les r├®sultats obtenus en 1925 dans lŌĆÖexploration des cinq premiers m├©tres du sondage ont ├®t├® corrobor├®s : ├Ā la partie sup├®rieure, nous avons trouv├® quelques tablettes proto├®lamites, accompagn├®es dŌĆÖune c├®ramique comprenant surtout des jarres ├Ā fond conique et des vases ronds, munis de becs dirig├®s vers le base ; des masses en pierre, des balles de fronde, de rares outils en m├®tal, des poin├¦ons en os, de petits vases dŌĆÖalb├ótre, des cachets plats ├Ā gravure archa├»que.
Au-dessous, lŌĆÖon rencontre des vases de terre cuite ├Ā bec ouvert sur le bord du col, des ├®cuelles ├Ā long manche perfor├®, des vases ronds avec une anse dont la courbe sŌĆÖ├®l├©ve au-dessus du plan de lŌĆÖorifice ; aussi, de tr├©s nombreuses ├®cuelles grossi├©res, des vases en pierre souvent quadrangulaires, des faucilles en terre cuite, des outils de potier qui sont des racloirs au tranchant convexe ; ils sont en pierre ou en terre cuite.
La couche inf├®rieure abonde en lames de silex dentel├®es ou non, en nucl├®i de silex ; les pi├©ces retouch├®es sont tr├©s rares ; lŌĆÖobsidienne est fr├®quente ; nous ne trouvons plus les ├®cuelles grossi├©res, mais de petits gobelets en terre cuite ; nous avons recueilli plusieurs vases peints entiers rappelant le styles des vases peints trouv├®s ├Ā Abou Charein, tell Obeid en M├®sopotamie, t├®p├® Moucian en Perse ; les fragments de vases peints du 1er style sont tr├©s abondants dans les terres, mais il nŌĆÖy a pas de pi├©ces enti├©res. En fin de fouille, nous avons trouv├® une tombe (p.3) dŌĆÖenfant ; les ossements ├®taient recueillis dans un tr├©s grand vase ├Ā fond plat pourvu de deux poign├®es (Fig.1) ; nous avons travers├® un four de potier, et trouv├® non loin des amas des boules de terre crue de 7 cm. de diam├©tre, des balles de fronde, probablement pr├¬ts pour la cuisson.
Nous avons mis ├Ā part provenant de ce chantier, quelques cachets archa├»ques en pierre, un tr├©s beau cylindre cachet, avec l├®gende, des masses de pierre, des vases dŌĆÖarragonite, des grosses perles, des figurines dŌĆÖanimaux en terre cuite avec peinture, une fusa├»ole peinte etcŌĆ”
En r├®sum├® ce sondage est descendu jusquŌĆÖau niveau de la civilisation du 1er style, il a rencontr├® une civilisation ├Ā vases peints analogue ├Ā celle des couches inf├®rieures dŌĆÖOur et de Mou├¦ian ; le d├®cor nŌĆÖest pas en progr├©s, mais les formes sont plus pratiques.
Travaux ├Ā lŌĆÖApadana.
Palais Ach├®m├®nide :
a) Parvis central
Une tranch├®e de trois m├©tres de largeur moyenne sur six m├©tres de profondeur et trente m├©tres de longueur a ├®t├® exploit├®e en avant du mur de briques crues limitant ├Ā lŌĆÖOuest les fondations de gravier ; ce mur ├®tait ├®lev├® verticalement du fond dŌĆÖune fouille de 9m de profondeur pratiqu├®e dans la colline n├®cropole. Au niveau du dallage, le terrain remblay├® entre le mur et la colline a (p.4) une largeur dŌĆÖenviron 1m50 qui diminue en profondeur ; notre travail a exploit├® en partie ce remblai, ce qui explique en partie son peu de rendement ; nous avons trouv├® un puits ach├®m├®nide avec garnissage en briques cuites dans lŌĆÖangle Sud Ouest de la Cour ; ├Ā trois m├©tres de profondeur nous avons d├®gag├® plusieurs tombeaux de la fin de lŌĆÖ├®poque ├®lamite, avec bracelets de bronze et perles de cornaline, vases ├®maill├®s ├Ā base carr├®e et couvercle ├Ā bouton ; ├®pingles ├Ā t├¬te de bitume recouverte dŌĆÖune feuille dŌĆÖargent.
b) Parvis oriental
Les campagnes pr├®c├®dentes avaient montr├® quŌĆÖ├Ā lŌĆÖEst du parvis central, une partie importante de la butte n├®cropole avait ├®t├® ├®pargn├®e par les travaux de fondation du palais ; nous y avions fait des tranch├®es depuis 1923, et en 1925, un sondage avait atteint le sol naturel ; nous avions soup├¦onn├® quŌĆÖil sŌĆÖagissait dŌĆÖune troisi├©me cour, dont le dallage manquait pour nous indiquer les dimensions ; notre travail ├®tait g├¬n├® par le manque de d├®gagement pour nos wagons, nous avions une seule sortie ├Ā 2m20 de profondeur, ├®largie pour deux voies ; nous nous sommes d├®cid├®s ├Ā traverser la fondation de gravier vers le Nord, sur une longueur dŌĆÖune vingtaine de m├©tres, ├Ā une profondeur de 5m50. Ce travail amorc├® en 1925 a ├®t├® termin├® vers le 20 F├®vrier 1926. Il nous a permis dŌĆÖactiver notre exploration.
Le parvis oriental ├®tait carr├® comme les deux autres ; (p.5) il avait 53m50 de c├┤t├®, entre les murs de briques crues limitant le gravier, un d├®crochement en saillie de 3m60, sur 14m50 de longueur, existe au milieu du c├┤t├® Sud.
Le c├┤t├® Nord est bord├® par la ligne de huit fondations en pierre pour bases de colonnes trouv├®e en 1923. Elle est ├Ā deux m├©tres au-dessous du niveau g├®n├®ral du palais ; nous pensons quŌĆÖelle nŌĆÖa pas de rapport avec le parvis oriental et que cŌĆÖest un t├®moin dŌĆÖune id├®e dŌĆÖarchitecte qui nŌĆÖa pas ├®t├® suivie.
Nous avons surtout explor├® lŌĆÖEst du parvis jusquŌĆÖ├Ā 7m50 de profondeur. Les r├®sultats sont diff├®rents suivant les points de fouilles, le niveau des vases polychromes par exemple est de 3 ├Ā 6m. de profondeur au Nord, ├Ā 7m50 de lŌĆÖEst et nŌĆÖa pas encore ├®t├® atteint au Sud. Nous sommes donc sur le flanc Sud de la butte N├®cropole et ├Ā une extr├®mit├® orientale, alors quŌĆÖau parvis central, nous avons d├®termin├® lŌĆÖextr├®mit├® occidentale.
Toutes les tombes d├®gag├®es cette campagne sont ant├®rieures ├Ā lŌĆÖ├®poque de Hammourabi ; les inhumations sont faites sous des sarcophages en terre cuite, ou dans des jarres, ou sous des ├®clats de grandes jarres (
pl. II
) . Les sarcophages les plus anciens sont ├Ā moulures renfor├¦ant les parois, ils sont accompagn├®s de vases en terre cuite, parfaitement tourn├®s et cuits, g├®n├®ralement de forme assez trapue ; le col est souvent peint en rouge. Nous avons (p.6) recueilli en particulier deux vases de formes tr├©s anciennes ; ils sont cylindriques, l├®g├©rement tronconiques. Quatre boutons en saillie sont perc├®s verticalement pour le passage dŌĆÖanses fun├®raires qui traversaient aussi le bord inf├®rieur du vase par un trou inclin├® ; elles se r├®unissaient sous le fond qui est relev├® ├Ā cet effet. Ces vases sont d├®cor├®s de traits en rainures qui ├®taient remplies de couleur blanche. Le d├®cor de lŌĆÖun dŌĆÖeux est un oiseau na├»vement ex├®cut├® et des lignes de petits cercles (
pl. III
) ; sur lŌĆÖautre est un oiseau et un bouquetin. Nous avons trouv├® dans la fouille du parvis central 1924, un vase analogue, mais sans trace dŌĆÖincrustation blanche dans les rainures.
Au dessous du niveau ├Ā sarcophages et jarres fun├®raires, nous trouvons de nombreux fours de potier et des tombes qui nous avaient paru dŌĆÖabord ├¬tre ├Ā m├¬me la terre et recouvertes de terre pil├®e. Les exemples suivants relev├®s cette ann├®e, nous montrent que plus probablement ces inhumations sont faites dans des caveaux en terre crue, difficiles ├Ā distinguer.
Un petit sarcophage de terre crue ├®tait ouvert par en haut ; (ovale : 0m70x0.45-prof.0 m27) il contenait un squelette complet dŌĆÖenfant et un cr├óne dŌĆÖadulte ( ?) ; il renfermait plusieurs tr├©s petits vases de terre cuite, de jolis petits vases dŌĆÖalb├ótre et dŌĆÖarragonite qui contenaient deux cylindres cachets tout neufs, il a ├®t├® recueilli des perles en p├óte et en pierre dŌĆÖun petit collier. (p.7) Un sarcophage analogue contenait plusieurs vases de bitume taill├® : un gobelet, une coupe, une ├®cuelle quadrangulaire ; leurs formes rappellent les vases des tombes du 1┬░ style ; de plus, deux petits vases dŌĆÖalb├ótre, un petit vase de terre cuite ├Ā quatre boutons, un grand vase de terre cuite ├Ā oreilles, une ├®pingle de bronze, un petit cylindre cachet, quelques perles de pierre et de p├óte.
Dans un autre cas, lŌĆÖinhumation avait ├®t├® faite sur une natte en fibres v├®g├®tales ; et accompagn├®e du d├®p├┤t de petits vases peints et dŌĆÖun cylindre cachet en coquille.
Un autre squelette ├®tait pos├® sur une plaque de terre cuite de 0m03 dŌĆÖ├®paisseur ; pr├©s de lui, ├®taient des vases ├Ā becs dirig├®s vers le bas, des ├®cuelles de terre cuite.
Une tombe contenait un riche mobilier de vases et dŌĆÖarmes de bronze malheureusement tr├©s oxyd├®s.
Il a ├®t├® trouv├® ├Ā ce niveau un tr├©s beau poignard de bronze : la soie se termine par un crochet fixant la poign├®e.
La c├®ramique des tombes de cette ├®poque, comprend des crat├©res ├Ā quatre boutons perc├®s pour anses funiculaires et recouverts dŌĆÖengobe rouge (Pl. IV); des vases peints ├Ā peinture polychrome de la fin du II┬░ style. Un grand fragment, montre un taureau ├Ā bosse en plein galop, et la vache de m├¬me esp├©ce peints noir et rouge (
Pl. IV
).
Les fours de potier rencontr├®s servaient ├Ā la cuisson de ces vases : nous avons trouv├® dans un m├¬me four, onze (p.8) vases peints d├®j├Ā cuits (
Pl. VI
) , un crat├©re ├Ā engobe rouge dans une chambre ├Ā feu ; pr├©s des fours nous avons trouv├® des amas dŌĆÖ├®cuelle, des vases de terre crue, de nombreux tr├®pieds pour la s├®paration des pi├©ces, des bobines (?) grossi├©res en terre cuite, des balles de fronde, des r├ócloirs de potiers.
La chambre ├Ā feu, para├«t avoir ├®t├® creus├®e dans la colline, avec une ouverture pour mettre le combustible. La plus grande ├®tait rectangulaire (1.10x2.50 - Hr1M25) et vo├╗t├®e en briques (
Pl. V
) ; lŌĆÖ├®paisseur de la vo├╗te ├®tait 0m30 ├Ā la clef ; des trous de 0m30 de diam├©tre s├®par├®s par un intervalle analogue, ├®taient perc├®s dans la vo├╗te ├Ā lŌĆÖaplomb des parois ; celles-ci ├®taient fondues en scories sur 0m03 ├Ā 0m05 dŌĆÖ├®paisseur. Les fondations du mur de la chambre de cuisson d├®passaient de peu le sol. DŌĆÖautres chambres ├Ā feu ├®taient circulaires, dŌĆÖun m├©tre de diam├©tre ├Ā la base.
Ce niveau nous para├«t correspondre ├Ā lŌĆÖ├®poque de Naramsin.
Au-dessous nous avons trouv├® des ├®chelles grossi├©res des vases ├Ā bec prolong├®, des faucilles de terre cuite, des silex taill├®s et des obsidiennes, des fragments de vase peint du 1er style.
├Ć signaler encore en provenance de ce chantier quelques figurines de terre cuite, quelques tablettes (p.9) inscrites dont plusieurs en forme de lentilles ; du mobilier des tombeaux, des pendants dŌĆÖoreille et des ├®pingles en argent, des bracelets et haches de bronze.
En r├®sum├®, nous trouvons que la colline argileuse primitive de lŌĆÖApadana fut occup├®e dŌĆÖabord par des cimeti├©res et des ateliers de potiers. Les cimeti├©res ├®taient alors group├®s autour de petits ├®difices religieux.
c) Mur ext├®rieur du palais.
Nous avons pu suivre les fondations du mur ext├®rieur du palais ├Ā lŌĆÖEst jusquŌĆÖ├Ā la hauteur du 3┬░ rang de colonnes de la salle hypostyle ; dans les mat├®riaux nous avons encore trouv├® quelques briques ├Ā relief appartenant aux animaux ail├®s ; ceux-ci sont donc ant├®rieurs ├Ā la construction de la salle hypostyle. Quelques briques ├Ā relief et inscrites proviennent du temple dŌĆÖIn Chouchinak r├®par├® par Kutir Nakhunt├® et Silhak.
├Ć ce propos, nous indiquerons que les panneaux homme, taureau et arbre, ont ├®t├® mont├®s par les ateliers du Louvre ; en rapprochant des deux motifs, on sŌĆÖaper├¦oit quŌĆÖil nŌĆÖest pas impossible de supposer quŌĆÖils se compl├©tent lŌĆÖun lŌĆÖautre ; de sorte que lŌĆÖhomme taureau tiendrait lŌĆÖarbre dŌĆÖune main, et de lŌĆÖautre cueillerait des fruits. LŌĆÖarbre nŌĆÖaurait pas de bras lui appartenant, ce qui ├®tait une singularit├® ; celui que nous lui avions (p.10.) attribu├® serait form├® des deux avant bras de lŌĆÖhomme taureau. Pour ├¬tre absolument certain de cette nouvelle interpr├®tation, il faudrait trouver r├®unis sur une m├¬me brique la base du tronc de lŌĆÖarbre et lŌĆÖextr├®mit├® du sabot du taureau ; cette extr├®mit├® nous manque encore.
Les fondations du mur avaient une largeur de 1m27, la base est ├Ā 4m50 au-dessous du niveau du palais. LŌĆÖappareillage ├®tait bien conserv├® sur une hauteur de 0m75, au-dessus les briques ├®taient moins r├®guli├©rement dispos├®es. La distance du mur au gravier des fondations est de trois m├©tres. Nous avions d├®blay├® dans cet intervalle en 1925, un fragment de f├╗t de colonne des portiques,de 3m de longueur (Pl.
VII
et
VIII
) ; nous avons trouv├® au voisinage, une base de colonne ├Ā peu pr├©s compl├©te (Pl.
VII
et
VIII
) , soit quŌĆÖelle ait ├®t├® entra├«n├®e dans lŌĆÖentonnoir cr├®├® par le f├╗t de colonne en tombant, ou enterr├®e ├Ā dessein dans un nivellement de terrain ├Ā b├ótir. Elle est du m├¬me type que celles qui ont ├®t├® d├®j├Ā exhum├®es mais lŌĆÖornementation de m├¬me style est un peu diff├®rente.
Nous lŌĆÖavons recouverte de terre pour ├®viter les d├®t├®riorations, dans le m├¬me esprit nous avons commenc├® ├Ā ├®pandre de la terre (10 ├Ā 20 centim├©tres) sur les sols b├®tonn├®s du palais qui souffraient beaucoup du va et vient des troupeaux. La terre n├®cessaire a ├®t├® extraite des parvis ouest et est ; ces derni├©res fouilles ont fourni quelques vases de terre cuite. (p.11)
├Ć lŌĆÖext├®rieur et au-dessous des fondations du mur nous avons trouv├® des tombeaux ; pr├©s de la surface, des caveaux vo├╗t├®s en briques cuites entour├®s des jarres fun├®raires contenant des squelettes dŌĆÖenfant ; ├®poque ├®lamite ; au-dessous des sarcophages sans moulures puis des sarcophages ├Ā moulures ; lŌĆÖun de ceux-ci ├®tait ├Ā 5m de profondeur (ovale de base : 1m18 et 0m55). Le mort ├®tait couch├® au-dessous sur le c├┤t├® droit ; les membres repli├®s ; il ├®tait par├® de pendants dŌĆÖoreille et de deux bracelets dont lŌĆÖun en argent ; pr├©s du cr├óne ├®tait une hache de bronze ; contre le tombeau, ├®taient dispers├®s un vase de bronze, plusieurs poteries dont un vase au col peint en rouge ; une poign├®e de pointes de fl├©ches en bronze.
Imm├®diatement au dessous du mur se trouvaient plusieurs grands vases ├Ā peinture polychromes, malheureusement bris├®s par les racines de c├óprier sauvage qui descendent jusquŌĆÖau niveau aquif├©re ; nous avons poursuivi la fouille ├Ā 7m50 de profondeur, trouvant quelques tombes ├Ā mobilier de vases polychromes pris dans une terre tr├©s dure. Un peu plus bas, nous avons trouv├® des vases ├Ā becs, des faucilles de terre cuite des ├®cuelles grossi├©res, en r├®sum├® la m├¬me coupe quŌĆÖau parvis oriental.
Fouille ├Ā lŌĆÖEst du palais.
Nous avons voulu ├®tudier la largeur du remblayage qui sŌĆÖ├®tendait en avant de la grande porte orientale du (p.12) palais ; le nivellement avait ├®t├® commenc├® autrefois et avait fourni des briques dŌĆÖarchers ach├®m├®nides r├®employ├®es dans des canalisations. Nous avons rencontr├® des restes dŌĆÖune construction arabe assez importante ; deux colonnes en briques d├®signaient lŌĆÖentr├®e ; les pi├©ces ├®taient carrel├®es en briques jointes au pl├ótre. Cette fouille a donn├® quelques fragments de vases arabes.
Fouilles ├Ā la Ville Royale.
CŌĆÖest ├Ā la ┬½ Ville Royale ┬╗ que nous avons fait le plus grand effort ; nous avons repris les travaux de 1924, qui avaient suivi en lŌĆÖ├®largissant et lŌĆÖapprofondissant la grande tranch├®e Morgan de 1897.
Un premier niveau de trois ├Ā cinq m├©tres au-dessous de la superficie a ├®t├® cr├®├® ; sol dŌĆÖune grande tranch├®e de 25m├©tres de largeur et 80 m├©tres de longueur ; il a ├®t├® choisi parce que nous avions reconnu ├Ā lŌĆÖentr├®e des vestiges de sol b├®tonn├® recouvert dŌĆÖocre rouge que nous connaissions du palais ach├®m├®nide ; nous pensions trouver un ├®difice important ; en r├®alit├®, nous avons rencontr├® un mur en briques crues ach├®m├®nide fort ├®pais et affleurant presque sur toute sa longueur, un mur semblable perpendiculaire existe au bout de la tranch├®e ; il est possible que ce soient les restes de la fortification ach├®m├®nide. Une tranch├®e perpendiculaire ├Ā la premi├©re de cinquante m├©tres de longueur, a ├®t├® fouill├®e ├Ā un deuxi├©me niveau (p.13) de 5m25 plus bas que le premier. Nous avons dŌĆÖautre part commenc├® ├Ā explorer un niveau interm├®diaire ├Ā 2m au-dessous du Niveau I ; nous avons profit├® dŌĆÖun ravin au Nord de la tranch├®e de profondeur pour amorcer une autre sortie du Niveau II.
a) Fouille au dessus du Niveau I.
├Ć fleur de sol, nous avons rencontr├® des carrelages et fondations de constructions arabes ; nous avons explor├® leur nombreux puits de d├®charges ; la trouvaille dŌĆÖun vase en terre cuite ├®maill├®e (
Pl. X
) contenant un petit tr├®sor de monnaies coufiques, nous permet dŌĆÖattribuer les constructions au XIe si├©cle de notre ├©re ; nous avons pu s├®parer la poterie et la fa├»ence dŌĆÖune ├®poque un peu plus ancienne, Xe si├©cle environ.
Au dessous du niveau arabe, nous avons rencontr├® de nombreuses tombes de basse ├®poque, sassanides et parthes (
Pl. XI
) ; les corps sont referm├®s dans de grandes jarres cylindriques ├Ā fond arrondi, ├Ā large orifice, et sans col ; elles sont enduites int├®rieurement de bitume ; parfois la s├®pulture a lieu dans un sarcophage en terre cuite, fait pour contenir un corps couch├® sur le dos ; cŌĆÖest ├Ā dire ├®largi aux ├®paules et r├®tr├®ci progressivement vers les pieds, avec une petite rentr├®e int├®rieure de lŌĆÖextr├®mit├®. Parfois la s├®pulture est plus compliqu├®e ; cŌĆÖest ainsi quŌĆÖun sarcophage ├®tait recouvert par deux rang├®es de grandes jarres debout inclin├®es lŌĆÖune vers (p. 14) lŌĆÖautre ; pr├©s des jarres ├®tait une ├®cuelle en et une gourde en terre cuite ├®maill├®e et une lampe de terre cuite ; ce sarcophage renfermait les restes de trois enfants. Un sarcophage ├®tait en terre cuite ├®maill├®e int├®rieurement.
Nous pensons que cet ├®tage est sassanide ou partho romain..
Nous avons trouv├® dans les terres des figurines gr├®co parthes, en terre cuite, des statuettes grossi├©res en os travaill├®, une jolie lampe en bronze orn├®e ├Ā la poign├®e dŌĆÖune croix byzantine ; nous avons trouv├® des fragments de vases romains et de vases grecs, un sceau ach├®m├®nide sur terre crue, plusieurs entailles partho-grecques, de nombreuses poteries arabes, fa├»ences arabes, gourdes sassanides et parthoromaines, une ├®p├®e en fer, des fragments de poterie avec inscription ├Ā lŌĆÖencre, probablement sassanide, des estampilles grecque et aram├®enne sur anses de jarres, ou sur poterie.
Aux deux tiers de la tranch├®e, nous avons constat├® lŌĆÖexistence dŌĆÖun ancien ravin ; les constructions arabes descendent jusquŌĆÖau sol de la tranch├®e signal├®e par deux colonnes en briques, portant encore trace du stuc qui dessinait un tore au-dessus de la base carr├®e (
Pl. XIII
) ; dans cette construction ├®taient r├®employ├®es des briques estampill├®es de Nabuchodonodor.
Il y avait donc ├Ā lŌĆÖ├®poque arabe deux monticule distincts et le mur ach├®m├®nide dont nous avons parl├® en (p.15) suivait les pentes. Dans le noyau du monticule ouest, nous avons trouv├® un caveau fun├®raire en briques crues qui ne renfermait pas moins de sept squelettes accompagn├®s dŌĆÖun riche mobilier, de nombreuses jarres en terre cuite ├Ā long col et sans anses, ├Ā fond conique (
Pl. XIV
) , de grands vases ronds et de nombreux flacons en terre cuite ├®maill├®e ces derniers sont souvent ├Ā d├®cor polychrome, des vases de bronze. Citons en particulier une petite tasse ├®maill├®e en blanc dont lŌĆÖanse se recourbe en t├¬te de canard au bec jaune, un vase en p├óte de verre ; des perles de pierre et de p├óte, deux boucles dŌĆÖoreille en or filigran├®.
Une tombe analogue a ├®t├® d├®couverte fortuitement au niveau du sol de la tranch├®e ; elle renfermait un seul corps ├®tendu sur le c├┤t├® gauche ; les bras ├®taient repli├®s, les mains plongeaient dans une coupe de bronze ; le long du dos ├®taient plac├®s plusieurs petits vases ├®maill├®s.
b) fouille du niveau interm├®diaire
La d├®couverte pr├®c├®dente nous a engag├® ├Ā cr├®er une nouvelle voie de sortie pour explorer ce point particulier, la tranch├®e est descendue ├Ā deux m├©tres au-dessous du Niveau I.
Cette profondeur sŌĆÖest trouv├®e correspondre ├Ā un ancien sol de constructions ; nous avons d├®gag├® un ensemble de canalisations en briques cuites. Cette tranch├®e nŌĆÖa pas encore atteint son but ; cependant pr├©s du bord du tell, (p. 16) nous avons trouv├® plusieurs tombes pr├®ach├®m├®nides ├Ā grandes jarres (
Pl. XVII
) ; lŌĆÖune dŌĆÖelles contenait des vases en terre cuite ├®maill├®e, des vases de bronze, dont un grand bassin, diam. 0m42, ├Ā deux anses fondues ; nous avons recueilli une centaine de bracelets de bronze, quelques bracelets en argent, des outils de bronze, des armes en fer.
Cette tranch├®e a fourni quelques fragments de tablettes inscrites, des figurines, parmi celles-ci, une statuette dŌĆÖun type connu par de nombreux fragments ; un marchand de poisson criant sa marchandise ; elle nŌĆÖest pas encore cuite ; dans des puits nous avons trouv├® des fragments de vases grecs avec traces de peinture, une lampe grecque, quelques intailles, des fragments de fa├»ence arabe.
c) Tranch├®e en profondeur
Nous avions trouv├® dans cette tranch├®e en 1924, plusieurs tombeaux vo├╗t├®s et des jarres fun├®raires ; lŌĆÖ├®largissement et lŌĆÖapprofondissement que nous avons r├®alis├® nous a donn├® les m├¬mes r├®sultats. Nous avons trouv├® trois tombeau vo├╗t├®s, n├®o-babyloniens, presque sans mobilier ; ils ├®taient rev├¬tus int├®rieurement dŌĆÖun enduit ├Ā la chaux. Nous avons d├®blay├® deux tombeaux un peu plus anciens ; entre lesquels se trouvait un sarcophage ├Ā moulures peint au bitume ; lŌĆÖun dŌĆÖeux contenait de (p. 17) nombreux ossements, une grande coquille marine, trois petits poids en h├®matite, un cylindre en p├óte bitumineuse, une perles en or ├Ā bossettes. Le sarcophage ne contenait rien en dehors de ossements.
Parmi les sarcophages en terre cuite d├®blay├®s, signalons en deux particuliers (
Pl. XVI
) : dŌĆÖabord, ils avaient un fond et un couvercle, de plus, ce dernier ├®tait pourvu dans un cas dŌĆÖun ├®vent, dans lŌĆÖautre, il ├®tait orn├® dŌĆÖune t├¬te de b├®lier en ronde bosse.
Ce chantier a donn├® des figurines de terre cuite, quelques intailles ├®lamites.
d) Fouilles du ravin oriental.
Cette fouille dŌĆÖune quarantaine de m├©tres de longueur amorce une tranch├®e de m├¬me profondeur que la pr├®c├®dente et sensiblement parall├©le, distante dŌĆÖune vingtaine de m├©tres ├Ā lŌĆÖEst.
Elle a mis ├Ā nu sur sa paroi ouest, un mur en briques crues ; en avant de celui-ci ├®tait un puits dŌĆÖalimentation en eau, dont la t├¬te ├®tait en briques moul├®es ├Ā voussoir, et un r├®servoir citerne en briques jointes au bitume.
Nous avons trouv├® pr├©s de l├Ā une brique ├Ā reliefs appartenant ├Ā ┬½ lŌĆÖhomme taureau ┬╗ ; il est possible quŌĆÖil y ait eu l├Ā encore un sanctuaire au dieu Chouchinak. Ce sanctuaire se trouvait pr├®cis├®ment entre les deux ravins qui ont facilit├® nos tranch├®es. (p. 18)
├Ć part des restes de construction, nous nŌĆÖavons rencontr├® que des tombes dans toute la coupe.
Au sommet (+10m25) ├®tait un sarcophage de 0m95 de longueur, en terre cuite, contenant des ossements dŌĆÖenfants (Sassanide)- au-dessous des tombes ├Ā m├¬me la terre avec mobilier de vases de terre cuite, n├®o-babyloniens, plus bas de nombreuses jarres fun├®raires (hauteur 0m70-Diam. sup. 0m75) renfermant parfois plusieurs individus ; une grande jarre (H :1m) renfermait des ossements dŌĆÖenfants, plusieurs coquilles marines, un broyeur ├Ā grains, un percuteur, une pierre de gond, une tablette inscrite ; non loin un vase de terre cuite contenait plusieurs tablettes inscrites ; ce sont des tombes ├®lamites. Nous avons d├®blay├® plusieurs tombeaux vo├╗t├®s en briques cuites.
Le plus important, n├®o-babylonien (
Pl. XIX
) , mesurait 1m70 de largeur, 2m50 de longueur hors ┼ōuvre ; il ├®tait orient├® Est Ouest ; ├Ā lŌĆÖune des extr├®mit├®s ├®tait accol├® un puits lat├®ral (1m50x1.10) ; il communiquait avec le tombeau par une fen├¬tre (0.80x0.70) qui au moment de la d├®couverte, ├®tait ferm├®e par un grand carreau de poterie ; nous nŌĆÖavons trouv├® que des ossements.
Un autre tombeau, n├®obabylonien ├®galement ├®tait sur plan carr├® (1m50) il ├®tait pr├®c├®d├® dŌĆÖun puits construit avec des briques sur champ. (1m70 x 0.90). Sous la vo├╗te ├®taient entass├®s les ossements dŌĆÖune vingtaine (p.19) dŌĆÖindividus ; de petits fragments de feuilles dŌĆÖor adh├®raient encore sur les os frontaux ; parmi les ossements gisait une t├¬te model├®e en argile de 0m255 de hauteur (
Pl. XXI, fig. 1. et 2.
) . Le cou trop rond (0.09) est perc├® par en dessous dŌĆÖun trou assez profond, pour la cheville de la sellette du praticien, ou pour un b├óton destin├® au transport. Les cheveux, la barbe, les sourcils, la prunelle sont peints avec un vernis noir. Le visage est assez allong├®, la l├©vre inf├®rieure est saillante, les yeux tr├©s grands se rel├©vent vers les temporaux ; le nez est busqu├®, la barbe et les cheveux sont fris├®s. La nuque et la partie post├®rieure du cr├óne sont n├®glig├®es ; lŌĆÖexpression du visage est tr├©s douce et s├®rieuse. Nous supposons que lors de lŌĆÖinhumation, le visage du mort nŌĆÖ├®tait pas susceptible dŌĆÖune exhibition publique, et a ├®t├® remplac├® sur la civi├©re par la t├¬te h├ótivement model├®e et faite pour avoir une certaine stabilit├® couch├®e horizontalement. Nous ne savons pas du tout si lŌĆÖinhumation comportait parfois de semblable c├®r├®monie ; nous le pr├®sumons ├Ā cause de la pr├®sence de feuilles dŌĆÖor sur les cr├ónes du m├¬me tombeau ; nous savons que les morts ├®taient ensevelis avec un suaire et avec des bijoux ; ├Ā quoi bon cet ├®talage, si la c├®r├®monie ├®tait sans t├®moins ; nous avons du reste trouv├® deux autres simulacres de visage humains dans les tombeaux ; lŌĆÖun est une petite t├¬te grossi├©re model├®e en argile et portant traces de peinture ; lŌĆÖautre ├®tait un pain de terre blanchi ├Ā la chaux, dans lequel on avait esquiss├® grossi├©rement au pouce, les yeux, le nez, la bouche.(p.20)
Dans la chambre ou puits attenant au tombeau nous avons trouv├® des fragments dŌĆÖune t├¬te en argile analogue ├Ā celle que nous avons d├®crite.
Le tombeau renfermait encore quelques petits vases de terre cuite, une petite coupe en pierre dure, une pendeloque, une agrafe de bronze.
Un autre tombeau, sur plan rectangulaire (1m60 x0.95) ne renfermait quŌĆÖun seul individu ; ├Ā lŌĆÖentr├®e, dans un petit vase se trouvait une quinzaine de petits poids en h├®matite, g├®n├®ralement en fuseaux, lŌĆÖun ├®tait un petit canard, un autre, une souris ( ?), un autre, un insecte ; de plus, nous avons recueilli un petit miroir circulaire et un bracelet de bronze. Un tombeau analogue (1.10 x 0.70) ├®tait pr├®c├®d├® dŌĆÖune petite chambre ├Ā offrandes, couverte en partie par un grand ├®clat de jarre (
Pl. XXIII, fig. 3
) ; il renfermait les restes dŌĆÖune douzaine dŌĆÖindividus, nous avons recueilli quelques vases de terre cuite, deux dŌĆÖentre eux ├®taient jumel├®s, aussi une paire de petits b┼ōufs en terre cuite.
Cette tranch├®e a fourni dŌĆÖautre part deux poids en pierre, dont lŌĆÖun est en forme de canard (environ 3Kgs), quelques figurines, dont un petit personnage grotesque ├®maill├®, une plaquette de schiste grav├® repr├®sentant sans doute lŌĆÖ├®bauche dŌĆÖun artiste en intaille, un petit bas relief en terre cuite, etcŌĆ”(p.21)
Fouilles ├Ā la ┬½ Ville des Artisans ┬╗
La construction dŌĆÖun bureau de douane ├Ā Suse a incit├® les chercheurs de briques anciennes ├Ā entreprendre des recherches de pans de murs ├Ā exploiter. Je nŌĆÖai pu obtenir que leur cantonnement ├Ā la Ville des Artisans, hors de la Suse ├®lamite.
Ils ont repris la d├®molition dŌĆÖune villa arabe, du XIIe si├©cle, celle o├╣ lŌĆÖon avait trouv├® en 1923, un petit pot contenant 14 pi├©ces dŌĆÖor coufiques. JŌĆÖai fait suivre ces travaux qui ont fourni quelques vases arabes ; jŌĆÖai rapport├® en particulier deux belles terrines ├®maill├®es du IXe si├©cle ; ├Ā citer encore un grand vase en terre cuite de m├¬me ├®poque, d├®cor├® ├Ā la pointe et au pouce, une lampe taill├®e en pierre tendre avec de nombreux becs p├®riph├®riques.
Les gamins ont profit├® des pluies pour ramasser des petits objets h├®t├®roclites et de nombreux petits bronze, g├®n├®ralement de la monnaie dŌĆÖElymaide, quelques pi├©ces dŌĆÖargent sassanide et parthes.
Fouilles de Djafferabad
Djafferabad est un petit groupe dŌĆÖ├®minences artificielles, qui se trouve en amont de Suse, sur la rive gauche du Chaour, ├Ā environ 7 kilom├©tres ; le campement dŌĆÖun s├®id est aupr├©s et d├©s les premiers jours de mon arriv├®e, on mŌĆÖapporta des ├®chantillons de c├®ramique peinte, et des fragments de vaisselle arabe du XIIe si├©cle. Je fis (p.22) travailler en cet endroit par intermittence et surtout apr├©s le 21 mars.
Nous avons recueilli des fragments de vases peints du 1er Style, une petite coupe peinte enti├©re, des figurines de m├¬me ├®poque ; des fragments dŌĆÖ├®cuelles et de plats appartenant ├Ā un style interm├®diaire ; la forme des ├®cuelles nous a rappel├® les poteries de Rhag├©s ; nous avons eu un pot en terre cuite ├®maill├®e ├Ā deux anses, deux pierres tombales assez grossi├©res que nous attribuons au XIIe si├©cle de notre ├©re (
Pl. XXIII, fig. 1.
) ; les objets repr├®sent├®s sont ├®p├®e, poignard, vases, bracelets.
On nous a apport├® ├®galement un cachet archa├»que et une entaille greco-parthe.
Fouilles de Douecya
Une tentative a ├®t├® faite sur ce t├®p├® ├Ā la requ├¬te dŌĆÖun chef de chantier jaloux de celui qui op├®rait ├Ā la Djafferabad.
Il a ├®t├® recueilli des fragments de vase peint du 1er style sans int├®r├¬t particulier.
On trouvera plus loin lŌĆÖinventaire des 530 objets au lot dŌĆÖobjets inventori├®s ; les fragments de vases peints de Suse, de Djafferabad, de Douecya, les briques ├Ā relief, les briques ├®maill├®es ach├®m├®nides ; objets dŌĆÖ├®tude ou parties dŌĆÖensembles ├Ā reconstituer nŌĆÖont pas ├®t├® inventori├®s.(p. 23)
Les antiquit├®s rapport├®es comprennent grosso modo : 30 poids en h├®matite, 3 poids en pierre, 69 intailles, 75 figurines, 14 vases en bronze, 18 vases de pierre, 60 vases ├®maill├®s, 25 num├®ros de bijoux et pi├©ce de monnaie en argent et or, 17 objets en os, 5 armes de fer, 22 outils et armes de bronze, 13 bracelets et ├®pingles de bronze, 9 amulettes, 19 objets en pierre, 6 fragments de pierre inscrite 3 objets en bitume ;
Notre envoi comprend 19 caisses dŌĆÖantiquit├®s, dont sept contiennent des briques ach├®m├®nides et ├®lamites ; les douze autres contiennent les ├®l├®ments d├®finis plus haut et les objets inventori├®s de la campagne pr├®c├®dente.
Les difficult├®s de transport et dŌĆÖemballage, le souci de ne pas d├®passer mon budget, mŌĆÖont emp├¬ch├® de rapporter des colis trop encombrants, tels que jarres fun├®raires (
Pl. XXIV
) , sarcophages sassanides ou ├®lamites.
Nous avons proc├®d├® au triage de toutes les briques ├®maill├®es entrepos├®es dans nos magasins ; il pourrait ├¬tre rapport├® une dizaine de caisses de belles briques.
Nous avons travaill├® ├Ā la reconstitution dŌĆÖun panneau globe ail├® et lion ail├® ├Ā t├¬te humaine ; le Louvre poss├©de deux de ces panneaux ; le lion et le soleil ├®tant les embl├©mes de la Perse actuelle comme de la Perse de Darius, il nous a paru quŌĆÖil serait peut ├¬tre politique dŌĆÖoffrir ce panneau au nouveau gouvernement de lŌĆÖIran.


 veuillez patienter...
veuillez patienter...