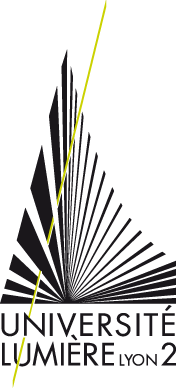Cote conservation : F/17/17255 / Document original conservÃĐ aux Archives Nationales, Paris.
NOTE SUCCINCTE
Sur la campagne de Suse 1921-1922 et ses rÃĐsultats
L'effort principal a portÃĐ sur l'exploration de la nÃĐcropole ÃĐlamite commencÃĐe en 1914 et continuÃĐe en 1921 Ã l'est du palais des rois AchÃĐmÃĐnides.
NÃĐcropole ÃĐlamite
Les tombeaux retrouvÃĐs s'ÃĐtagent là sur une hauteur d'une quinzaine de mÃĻtres, reprÃĐsentant tous les modes d'inhumation en usage depuis le XXe siÃĻcle avant notre ÃĻre jusqu'à l'ÃĐpoque de Darius I°.
Les corps sont souvent inhumÃĐs vÊtus et parÃĐs, accompagnÃĐs d'un mobilier de vases funÃĐraires en bronze, en terre cuite, en terre cuite ÃĐmaillÃĐe, d'armes et d'outils. Ils sont parfois rassemblÃĐs dans des caveaux voÃŧtÃĐs en briques crues ou cuites ou enterrÃĐs isolÃĐment dans des jarres de dimensions appropriÃĐes, ou dans des sarcophages en terre cuite dont la forme rappelle celle de "baignoires renversÃĐes". Des tablettes inscrites sont frÃĐquemment trouvÃĐes dans les sÃĐpultures. Il a ÃĐtÃĐ recueilli de nombreux objets dont le plus inÃĐdit est une statuette, haute de 0,40 en terre cuite ÃĐmaillÃĐe polychromÃĐe. Le personnage, à la tÊte grimaçante, est vÊtu d'une robe et a les mains jointes sur la poitrine.
Dans les ruines de constructions ÃĐlamites ont ÃĐtÃĐ retrouvÃĐes des briques cuites inscrites au nom des rois Kutir Nakkunte et Silhak et des briques à reliefs.
Ces derniÃĻres ont servi à dÃĐcorer le sanctuaire du dieu Chouchinak, construit par les rois susiens prÃĐcÃĐdemment nommÃĐs. (p. 2)
En rÃĐunissant les briques à reliefs à celles trouvÃĐes dans les trois campagnes de fouilles prÃĐcÃĐdentes, il a ÃĐtÃĐ possible de reconstituer trois diffÃĐrents sujets hauts chacun de 14 ÃĐlÃĐments (1m.20) qui devaient Être rÃĐpÃĐtÃĐs le long du mur ; ils ÃĐtaient surmontÃĐs d'une frise à dessin gÃĐomÃĐtrique en relief, qui a ÃĐtÃĐ reconstituÃĐe.
Les motifs sont :
un homme taureau ;
une sorte de sphynx, le bas du corps se terminant en demi-colonne engagÃĐ.
un palmier stylisÃĐ ; un bras humain sort du tronc au-dessous de la naissance des feuilles et des fruits et la main vient ressaisir l'arbre.
Ces figurations dont les deux derniÃĻres sont originales dans les reprÃĐsentations assyro-babyloniennes, sont "susiennes" de conception comme d'exÃĐcution.
La fouille a ÃĐgalement recueilli de nombreuses tablettes et empreintes datant d'ÃĐpoques diverses à partir des rois d'Ur (XXIIIe siÃĻcle avant notre ÃĻre).
Des fouilles prÃĐparatoires exÃĐcutÃĐes en surface au bord du ÂŦ tell Âŧ ont trouvÃĐ dans des ruines musulmanes une curieuse lampe en bronze dont le couvercle à charniÃĻre figure une coquille et dont l'anse recourbÃĐe se termine par un masque humain. Une collection de pointes de flÃĻches et de piques en bronze et une grande dalle de calcaire blanc (2m.50 x 1,10 x 0,35).
Cette derniÃĻre ÃĐtait taillÃĐe en forme de stÃĻle pour Être dressÃĐe verticalement ; sur une des faces, est mÃĐnagÃĐe en saillie, une bande qui suit le contour arrondi au sommet. Un dard en relief pointÃĐ vers le bas, traverse obliquement le champ ; nulle inscription ; l'ÃĐpoque est incertaine (grÃĐcoparthe ?) ; mais il s'agit certainement d'un monument funÃĐraire ; c'est la stÃĻle au guerrier (p. 3) inconnu. Une autre dalle de pierre porte, sculptÃĐ en creux, un svastika, symbole rare à Suse.
Apadana
Il avait ÃĐtÃĐ observÃĐ que la nÃĐcropole ÃĐlamite devait se prolonger sous les terrassements du palais achÃĐmÃĐnide.
Une fouille entreprise au-dessous du dallage de la grande cour centrale (30m. x 30m.) a prouvÃĐ cette continuation. Elle a dÃĐblayÃĐ plusieurs caveaux funÃĐraires voÃŧtÃĐs, retrouvÃĐ de trÃĻs nombreuses sÃĐpultures ; un vase funÃĐraire contenait, avec un squelette d'enfant, des figurines de terre cuite d'un exceptionnel ÃĐtat de conservation. Une dalle carrÃĐe probablement sanctuaire a ÃĐtÃĐ reconnue entourÃĐe de murs en briques crues ; on a trouvÃĐ des petits murs dÃĐlimitant des terrains concÃĐdÃĐs à des groupements pour l'inhumation, et, dans ces enclos, de beaux sarcophages en terre cuite (1m.70 x 0,70 x 0,60) en forme de "baignoires renversÃĐes". La surface extÃĐrieure est ornÃĐe et fortifiÃĐe par des moulures et peinte au bitume. Le mobilier en ÃĐtait particuliÃĻrement riche, comportant des vases d'argent et de bronze ; l'un d'eux renfermait deux coiffures en argent, cinq couvre-seins de mÊme mÃĐtal ; un bracelet d'or, deux en argent, des boucles de ceinture en bronze ; un autre contenait, avec des vases de bitume et d'albÃĒtre, un prÃĐcieux plateau de bitume noir qui est un des trÃĻs beaux objets sortis des fouilles de MÃĐsopotamie ; il est circulaire, de prÃĻs de trente centimÃĻtres de diamÃĻtre ; le rebord est dÃĐcorÃĐ de six plaquettes blanches (en coquille), fixÃĐes chacune avec deux clous de bronze à tÊte dorÃĐe ; il ÃĐtait portÃĐ sur trois pieds montÃĐs à goujon de bronze formÃĐs chacun d'un bouquetin se raccordant d'une part au plateau par l'arriÃĻre-train et de l'autre, reposant sur la poitrine, les pattes repliÃĐes sur le corps, le cou redressÃĐ supporte la tÊte raccordÃĐe au corps par la coupe gracieuse des cornes sculptÃĐes à jour. (p. 4)
Les yeux sont incrustÃĐs en blanc avec une pupille bleue ; hauteur totale 0m185. Cette piÃĻce date d'au moins 2000 ans avant notre ÃĻre, tandis que les sarcophages sont provisoirement attribuÃĐs au VIIIe siÃĻcle avant notre ÃĻre.
à la profondeur de 7m au-dessous du sol du palais, il a ÃĐtÃĐ dÃĐblayÃĐ deux grands caveaux funÃĐraires jumeaux, construits tous deux en briques cuites, inscrites au nom du roi Attapaksou (2000 avt. J.C.). Ils avaient ÃĐtÃĐ tous deux violÃĐs, mais prÃĻs de l'un d'eux on retrouva des vases de bronze et d'argent, des restes de piÃĻces en marqueterie, ivoire et bitume et, au-dessus, un bandage en bronze d'une roue de char. Il dessinait un cercle de 1m.05 de diamÃĻtre posÃĐ Ã plat sur le squelette d'un cheval de forte taille. Il se compose de six sections ; chacune d'elles, demi-circulaire en coupe, comporte trois paires de pattes traversÃĐes d'un gros clou pour la fixation sur le bois de la jante. Il ne subsiste de celle-ci que des traces charbonneuses. Il a ÃĐtÃĐ encore recueilli comme appartenant au char, une piÃĻce de bronze qui devait se fixer sur le timon pour recevoir les rÊnes et deux clavettes de bronze pour arrÊter les roues sur l'essieu ; la tÊte en est terminÃĐe par un petit hÃĐrisson.
Ces piÃĻces sont ici rencontrÃĐes pour la premiÃĻre fois de toutes les fouilles assyro-babyloniennes.
Dans toute la fouille dite du "parvis central", il a ÃĐtÃĐ trouvÃĐ de nombreuses tablettes en terre crue ou cuite, en particulier à 6m. de profondeur, 5 à 6 grosses tablettes circulaires en forme de lentilles inscrites sur les deux faces. Le PÃĻre SCHEIL a reconnu d'un cÃītÃĐ quelques mots sumÃĐriens, sur l'autre la prononciation ou appellation de ces signes en babylonien et ensuite leur traduction dans cette mÊme langue. (p. 5)
La transcription phonÃĐtique prÃĐsente quelques diffÃĐrences avec celle donnÃĐe pour les mÊmes mots par les vocabulaires assyriens, ce qui ne s'explique guÃĻre que par des diffÃĐrences de prononciation dialectales : le sumÃĐrien aurait donc ÃĐtÃĐ parlÃĐ. On pourrait en tirer un argument puissant pour la thÃĻse soutenue par Oppert ; le sumÃĐrien, une ancienne langue tombÃĐe en dÃĐsuÃĐtude avec permanence d'emploi de son ÃĐcriture, contre celle d'HalÃĐvy, qui semblait avoir ralliÃĐ le plus de partisans, le sumÃĐrien, une ÃĐcriture hiÃĐratique ou forgÃĐe par les scribes pour le babylonien primitif.
Ces tablettes sont de l'ÃĐpoque des rois d'Ur (XXIIIe siÃĻcle avant JÃĐsus-Christ).
En dehors de la nÃĐcropole, le dÃĐblaiement du palais des rois achÃĐmÃĐnides a ÃĐtÃĐ achevÃĐ, laissant un massif tÃĐmoin au-dessus de l'enceinte, au Nord-Est.
Il a ÃĐtÃĐ retrouvÃĐ des dallages, deux seuils de portes ; recueilli des fragments d'inscriptions achÃĐmÃĐnides de Darius et de ses successeurs, des briques cuites et estampillÃĐes au nom de Darius, des briques à reliefs, se rapportant à des grands panneaux reprÃĐsentant des griffons, des lions.
Il a ÃĐtÃĐ recueilli deux fragments d'inscriptions grecques ; l'un d'eux vient complÃĐter fort heureusement un autre fragment trouvÃĐ en 1906. Ces inscriptions feront prochainement l'objet d'une communication de M. HAUSSOULLIER Ã l'AcadÃĐmie des Inscriptions.
à deux mÃĻtres au-dessous du sol gÃĐnÃĐral du palais, il a ÃĐtÃĐ retrouvÃĐ une ligne de huit fondations de colonnes achÃĐmÃĐnides, se rapportant à un palais plus ancien.
Acropole
Quelques sondages sur l'Acropole ont recueilli des tablettes protoÃĐlamites ; Ã la Ville Royale, quelques sÃĐpultures ÃĐlamites (p. 6) mises au jour par les pluies ont ÃĐtÃĐ fouillÃĐes au pied du donjon.
En dehors de Suse
En dehors de Suse, il a ÃĐtÃĐ explorÃĐ une butte, Ã 3km au nord, sur les bords du cours d'eau Chaour. La partie infÃĐrieure renferme de nombreux fragments de la poterie fine prÃĐhistorique de Suse ; la partie supÃĐrieure, des tombes parthes.
à Ahwaz, enfin, la mission a pu recueillir, dans les ruines de l'ancienne citÃĐ, de nombreux ÃĐchantillons de poterie parthe et sassanide.
Il a ÃĐtÃĐ remis au musÃĐe du Louvre trois cent cinquante-trois objets ou sujets inventoriÃĐs, comprenant 47 grammes d'or et 2200 grammes d'argent. Il a ÃĐtÃĐ payÃĐ au gouvernement persan, aux termes de la convention rÃĐgissant les fouilles, une somme de 1030 krans (1088 F au change moyen), valeur au poids de mÃĐtaux prÃĐcieux.
Il a ÃĐtÃĐ employÃĐ environ 350 ouvriers. Sur 150.000 F ordonnancÃĐs, il a ÃĐtÃĐ dÃĐpensÃĐ environ 121000 F dont 70000 pour les travaux de fouilles.
Le programme de l'annÃĐe 1922-1923 comporte l'achÃĻvement du sondage du parvis central du palais achÃĐmÃĐnide et quelques recherches dans les autres fondations et l'approfondissement des sondages au "tell" de la Ville Royale, celui-ci devant refermer les ruines des palais des rois ÃĐlamites, encore inconnus.


 veuillez patienter...
veuillez patienter...