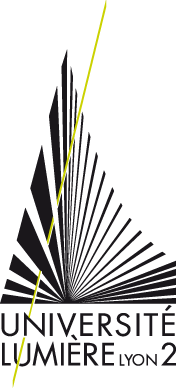Cote conservation : F/17/17255 / Document original conservÃĐ aux Archives Nationales, Paris.
Compte-rendu
de la Campagne de Fouilles à SUSE -1922-
Au cours de cette campagne il a ÃĐtÃĐ procÃĐdÃĐ Ã l'achÃĻvement du dÃĐblaiement du Palais des rois AchÃĐmÃĐnides, à des sondages dans les fondations de cet ÃĐdifice, à une fouille en profondeur au-dessous du parvis central ; d'autre part l'exploration de la NÃĐcropole à l'est du palais a ÃĐtÃĐ activement poussÃĐe.
Nous allons exposer successivement les principaux rÃĐsultats obtenus en ces diffÃĐrents points.
Palais des rois AchÃĐmÃĐnides
C'est en fin de saison 1908 que nous attirions l'attention de M. S. de Morgan, alors dÃĐlÃĐguÃĐ gÃĐnÃĐral sur un affleurement de bÃĐton composÃĐ de mortier de chaux et de fragments de briques cuites et recouvert d'un bel enduit d'ocre rouge mis à dÃĐcouvert par les pluies au sud du tell dit de "l'Apadana".
M. de Morgan, qui n'est plus revenu à Suse ensuite, nous prescrivit de faire en ce point des travaux d'essais.
En 1909, avec M. Toscanne comme adjoint, nous dÃĐblayons le parvis Ouest et en partie les dalles adjacentes ; en 1910 et 1911, avec M. PÃĐzard, le parvis central et la grande salle de l'Ouest ; en 1912 avec M. Tocanne de nouveau furent dÃĐblayÃĐes les dalles et circulations au Nord des parvis. Le dÃĐblaiement avait ÃĐtÃĐ arrÊtÃĐ presque partout au niveau du bÃĐton colorÃĐ, de maniÃĻre à respecter les assises infÃĐrieures des murs constituÃĐes par un ou deux lits de briques cuites. ChargÃĐ de la (p. 2) direction des fouilles à Suse, nous fÃŪmes appel à M. Pillet, alors jeune architecte diplÃīmÃĐ pour effectuer le relevÃĐ gÃĐnÃĐral du palais et surveiller les recherches complÃĐmentaires. M. Pillet fit un beau travail personnel exposÃĐ au Salon de 1914, et dont il entretint l'AcadÃĐmie à cette ÃĐpoque.
Le travail de dÃĐblaiement de la partie orientale du palais fut poursuivi en 1914, amena la dÃĐcouverte de quelques seuils de porte et de parcelles de dallages. En 1921 fut dÃĐblayÃĐ l'angle Nord-Est. En 1922, ce dÃĐblaiement fut achevÃĐ retrouvant trace de constructions secondaires au Nord d'une porte principale de l'enceinte orientale. (Fig.
2
et
5
)
à part un massif tÃĐmoin laissÃĐ au-dessus de l'enceinte elle mÊme au Nord Est, le dÃĐblaiement est terminÃĐ (
Fig. 1
) .
Nous remettons ci-joint un premier relevÃĐ gÃĐnÃĐral (
plan 2
) pour faciliter nos explications, nous rÃĐservant de le corriger s'il y a lieu par de nouvelles vÃĐrifications ; l'ÃĐtude des fondations commencÃĐes dans la derniÃĻre campagne est d'autre part susceptible de fournir des renseignements complÃĐmentaires.
En 1911, dans le Bulletin de la DÃĐlÃĐgation en Perse (Fasc. II), nous avons attribuÃĐ le palais au roi Darius Ier. Les parties alors dÃĐcouvertes semblaient trop ÃĐloignÃĐes de la salle hypostyle d'ArtaxerxÃĻs Mnemon pour n' en Être pas indÃĐpendantes ; l'exemple de la terrasse de Persepolis sur laquelle chacun des grands souverains AchÃĐmÃĐnides avait tenu à construire un palais personnel nous permettait de croire au mÊme usage à Suse ; l'abondance des inscriptions sur pierre, sur briques, (p. 3) au nom de Darius, la trouvaille surtout d'une grande tablette de fondation, du mÊme roi rendait l'attribution vraisemblable.
Cependant au fur et à mesure de l'avancement des travaux au Nord, les parvis et les circulations se rapprochaient de la salle hypostyle ; le palais prenait l'extension d'une vÃĐritable habitation, analogue à la demeure impÃĐriale des Assyriens à Khorsabad.
Il a du Être occupÃĐ par tous les souverains achÃĐmÃĐnides depuis Darius jusqu'à la conquÊte d'Alexandre, par consÃĐquent bien souvent rÃĐparÃĐ et remaniÃĐ dans les dÃĐtails.
Le plan remis est donc le relevÃĐ gÃĐnÃĐral de ce qui subsistait au-dessus du terrassement recouvert de gravier, au niveau de 17 m au-dessus du plan aquifÃĐrÃĐ.
Ce terrassement devait Être rectangulaire mesurant environ 270 m. de l'Est à l'Ouest, de 150m. au moins du Nord au Sud, et prÃĐsentait un dÃĐcrochement Nord de 120m du cÃītÃĐ correspondant à la salle hypostyle.
Les pierres de fondation des bases de colonnes de cette salle, sont ÃĐtablies au-dessus du niveau gÃĐnÃĐral du palais proprement dit ; le pavÃĐ de la salle devait donc Être à 0m50 environ plus haut que celui des appartements.
La salle hypostyle a ÃĐtÃĐ complÃĻtement dÃĐblayÃĐe sauf un tÃĐmoin entre le 5° et le 6° rang de colonne à l'Est. Dans le but de rechercher les traces du mur de sÃĐparation entre la grande salle et l'aile droite, il a ÃĐtÃĐ dÃĐblayÃĐ quatre bases de colonnes du portique oriental, jusqu'au 6° rang des colonnes (p. 4) à base carrÃĐe : une de ces bases avait ÃĐtÃĐ trouvÃĐe par un sondage de M. JÃĐquier, une autre par un sondage de Loftus, les deux autres ÃĐtaient seulement supposÃĐes. Il a ÃĐtÃĐ reconnu que les fondations parthes descendaient là au-dessous de fondations du portique et qu'il ÃĐtait impossible de retrouver de traces du mur de sÃĐparation. Loftus et M. JÃĐquier aprÃĻs lui avaient ÃĐchouÃĐ ÃĐgalement dans la mÊme recherche. M. Dieulafoy et ensuite M. Pillet ont cependant restituÃĐ les grands murs ; je pense qu'ils ont eu raison et en particulier parce qu'il ÃĐtait de toute nÃĐcessitÃĐ d'accÃĐder facilement sur la terrasse des toits non seulement pour en jouir, mais encore pour les travaux de rÃĐfection. Ces escaliers auraient tout naturellement leur place dans l'ÃĐpaisseur des murs, (ÃĐpaisseur probable = 5m50).
Le dÃĐblaiement total effectuÃĐ au Nord de la grande salle n'a retrouvÃĐ aucune base de colonne d'un portique Nord.
Il a ÃĐtÃĐ retrouvÃĐ trÃĻs peu des chapiteaux aux taureaux opposÃĐs ; M. Dieulafoy en a rapportÃĐ un trÃĻs beau au MusÃĐe du Louvre, M. JÃĐquier en a trouvÃĐ un ; les dÃĐbris d'un troisiÃĻme existent dans la salle hypostyle, un autre dans une tranchÃĐe au Nord de l'Apadana ; Nous en avons retrouvÃĐ un cinquiÃĻme, seulement un peu moins bien conservÃĐ que celui du Louvre (
fig. 7 et 8
) ; il gisait à l'Est du portique oriental à cÃītÃĐ du dernier ÃĐlÃĐment de fÃŧt de colonne qui s'y rapportait (
fig. 9 et 9 bis
) ; les cannelures du fÃŧt s'arrÊtent en effet à trois centimÃĻtres de l'extrÃĐmitÃĐ de moindre diamÃĻtre. La longueur de l'ÃĐlÃĐment ÃĐtait de 2m95, son diamÃĻtre à l'extrÃĐmitÃĐ 1m39, (p. 5), ce qui donne pour son poids approximatif une dizaine de tonnes.
Il a ÃĐtÃĐ retrouvÃĐ deux fragments importants des oreilles en pierre qui ÃĐtaient rapportÃĐes au moyen d'un tenon carrÃĐ scellÃĐ au plomb.
On sait que les cornes ÃĐtaient ÃĐgalement rapportÃĐes et en pierre.
Il a ÃĐtÃĐ remarquÃĐ que les fragments de pierre brisÃĐs au cours de la sculpture ÃĐtaient remis en place au moyen de tenons en plomb, et qu'il reste dans les cannelures du fÃŧt de colonne des traces d'un enduit qui avait pour but de dissimuler les imperfections du travail et protÃĐger aussi la pierre trÃĻs fissile, contre l'humiditÃĐ.
Comme on le voit sur le plan, le palais proprement dit a beaucoup d'analogies avec celui de Khorsabad et doit Être restituÃĐ dans le mÊme esprit en ÃĐlÃĐvation. J'attirerais l'attention sur la nÃĐcessitÃĐ de prÃĐvoir des accÃĻs aux terrasses, et je verrais la place des escaliers dans l'ÃĐpaisseur des plus gros murs.
On remarque que les grandes circulations vont de l'Est à l'Ouest, c'est-à -dire viennent de la Ville Royale ; une grande allÃĐe carrelÃĐe accessible aux chars, amenait au parvis central ; elle ÃĐtait bordÃĐe de dÃĐpendances mal conservÃĐes.
Les appartements royaux plus fermÃĐs entouraient le parvis de l'Ouest.
à l'Ouest et au Sud, le mur d'enceinte ÃĐtait bordÃĐ dâun (p.6) canal facilitant l'approvisionnement en eau potable. Les eaux de vidange et les eaux de pluies ÃĐtaient sans doute ÃĐliminÃĐes par des puits de drainage descendant jusqu'au plan d'eau.
Il ne reste rien de l'enceinte Sud ; l'enceinte orientale ÃĐtait bordÃĐe d'un long mur droit en briques crues, dont il a ÃĐtÃĐ retrouvÃĐ les fondations du parement en briques cuites.
Les murs du palais ÃĐtaient en briques crues recouvertes d'un enduit intÃĐrieur ; la principale dÃĐcoration ÃĐtait sans doute des parements en briques ÃĐmaillÃĐes, composant panneaux aux multiples dÃĐcors.
Il n'a jamais ÃĐtÃĐ retrouvÃĐ dans nos fouilles de panneaux complets en place, mais le plus ou moins grand nombre d'ÃĐlÃĐments d'un mÊme sujet au mÊme lieu permet des conjonctures ; c'est ainsi que sur le parvis Ouest devait exister le sÃĐparant en deux un mur Est-Ouest dÃĐcorÃĐ de panneaux reprÃĐsentant des griffon ailÃĐs.
M. Dieulafoy a retrouvÃĐ des briques ÃĐmaillÃĐes d'archers qu'il a rapportÃĐes au Louvre dans une tranchÃĐe qu'il avait faite, au nord de la grande porte orientale, et en dÃĐblayant complÃĻtement le terrain à cet endroit nous en avons trouvÃĐ quelques ÃĐlÃĐments. Les trÃĻs nombreuses briques rapportÃĐes par M. de Morgan ont ÃĐtÃĐ trouvÃĐes à l'Est de cette mÊme porte en dehors du palais rÃĐemployÃĐes dans la construction d'aqueducs ; des briques d'archers plus petits et sans relief ont ÃĐtÃĐ trouvÃĐes sur le parvis de la salle (A) à l'Ouest, et les briques de griffons à tÊte (p. 7) humaine et globe ailÃĐ au Nord Est du parvis ouest.
M. Dieulafoy a reconstituÃĐ deux panneaux en carreaux de briques cuites portant sur une face rectangulaire un relief : ces panneaux reprÃĐsentent un lion ailÃĐ et un griffon ailÃĐ. Nous avons trouvÃĐ un grand nombre d'ÃĐlÃĐments de panneaux semblables ou analogues. Sur la face opposÃĐe au relief sont une à trois bandes ÃĐtroites en saillie, et sur une face adjacente un rebord ÃĐgalement saillant ; ces dispositions servent à mÃĐnager l'espace rÃĐservÃĐ au mortier de sorte qu'il n'y ait pas dans la composition de joint vertical apparent. Les briques de cette nature ont ÃĐtÃĐ trouvÃĐes principalement dans les fondations du mur d'enceinte oriental (
Fig. 28
) ; il en a ÃĐtÃĐ ÃĐgalement retrouvÃĐ dans la composition des dallages du palais dÃĐblayÃĐ au Nord-Est (
fig. 2
) . Beaucoup de ces reliefs portent les traces d'un enduit assez ÃĐpais et colorÃĐ. Leur rÃĐemploi dans les constructions nous en font attribuer à Darius.
Rappelons enfin qu'il a ÃĐtÃĐ trouvÃĐ en 1913 quelques fragments d'une grande statue achÃĐmÃĐnide ; partie de visage, pan de robe et pied chaussÃĐ.
Dans les travaux de dÃĐblaiement, il a ÃĐtÃĐ rencontrÃĐ d'assez nombreuses tombes parthes ; parmi les objets les plus intÃĐressants, je citerai une grande coupe en argent en forme de barque, une inscription grecque sur un fragment de socle en calcaire blanc (
fig. 10
) ; un fragment d'inscription grecque sur marbre blanc, appartenant à une tente dont une partie avait dÃĐjà ÃĐtÃĐ dÃĐcouverte en 1908.
(p. 8) Sondages au-dessous du niveau du palais :
Nous avions eu l'impression en regardant le relevÃĐ gÃĐnÃĐral du palais que toute l'aile orientale oÃđ l'on ne trouvait pas de parvis bÃĐtonnÃĐ avait ÃĐtÃĐ remaniÃĐe ou mÊme ajoutÃĐe au plan primitif : d'autre part on pouvait se demander si les rois achÃĐmÃĐnides n'avaient pas ÃĐtabli leur palais sur les ruines des demeures royales ÃĐlamites encore inconnues ; un sondage en profondeur de la terrasse ÃĐtait donc à notre programme.
Un sondage de 20 m de longueur, de 3m de largeur fut pratiquÃĐ au-dessous du carrelage du parvis Ouest. Il rencontra un remblayage de gravier remaniÃĐ, mÊlÃĐ Ã des fragments de briques ÃĐmaillÃĐes jusqu'à une profondeur de 2m50. La fouille fut alors rÃĐduite à six mÃĻtres de longueur dans sa partie mÃĐdiane ; la profondeur fut poussÃĐe à 4m, on atteignit alors l'argile du noyau de terrassement, dans laquelle se trouva (sic) des vases funÃĐraires analogues à ceux que l'on obtenait trois mÃĻtres plus bas à l'Est du palais dans la nÃĐcropole.
Une tranchÃĐe (I) à l'Est du parvis central descendit à 2m. de profondeur sur 50 m. de longueur, avec une largeur variant de 4m. à 6m. ; elle traversa un radier de galets au-dessous de l'allÃĐe carrelÃĐe (rÃĐtablie en H), venant de la porte Orientale et à la base on retrouve des vases funÃĐraires.
Une tranchÃĐe (II) à l'Est de celle-ci fut poussÃĐe à 3m50 de profondeur et rencontra en particulier à ce niveau, un sarcophage en terre cuite en forme de "baignoire renversÃĐe" (p. 9) de 1m24 de longueur sur 0m58 de largeur maxima ; au-dessous on trouva les restes de deux individus et on recueillit une sÃĐbile de bronze, dans le reste de la tranchÃĐe, au mÊme niveau, se trouvaient des vases funÃĐraires.
Une tranchÃĐe (III) beaucoup plus à l'Est, rencontra un gravier remaniÃĐ (mÊlÃĐ de fragments de briques et de poterie) et des ÃĐboulis de fragments de briques ; elle dÃĐblaya une construction en briques cuites soigneusement jointes au bitume, dont le sommet affleurait presque au niveau supÃĐrieur (0) et dont le socle rectangulaire (3m70 sur 1m50) reposait au niveau.
Au-dessus du massif de base de 7 briques de hauteur, il ÃĐtait rÃĐservÃĐ un canal longitudinal de 0.20 de largeur en bas, de 0.40 en haut ; il ÃĐtait fermÃĐ sur le dessus par des briques placÃĐes à champ et entrÃĐe de coin, à la rÃĐserve d'une ouverture de 0.60 sur 0.33 de largeur. La construction trÃĻs soignÃĐe et impermÃĐable, devait se rapporter à un rÃĐservoir citerne. (
fig.6
) . Dans la construction se trouvaient des briques ÃĐmaillÃĐes et des briques estampillÃĐes au nom de Darius.
En avant et affleurant au niveau -2m, fut dÃĐblayÃĐe une fondation de base de colonne analogue à celle de l'Apadana, mais de dimension moins considÃĐrable ; elle ÃĐtait formÃĐe par la juxtaposition de deux pierres en calcaire bitumineux, jointes au plomb et taillÃĐes de maniÃĻre à dessiner une face supÃĐrieure carrÃĐe de deux mÃĻtres de cÃītÃĐ ; à peu prÃĻs plane avec un ÃĐvidement (p. 10) central circulaire d'environ 1m de diamÃĻtre et 0m10 de creux. (
fig. 4
) .
Une tranchÃĐe IV, perpendiculaire à la tranchÃĐe III retrouva à la mÊme profondeur, en tout huit pierres, analogues, alignÃĐes avec l'orientation des lignes E.O. du palais ; les pierres des deux extrÃĐmitÃĐs ÃĐtaient distantes de la suivante d'environ 10m, les six autres pierres ÃĐtant à des intervalle d'environ 7m. Les pierres extrÊmes s'alignent sur l'axe par une diagonale de leur carrÃĐ supÃĐrieur, les diagonales de deux des autres pierres faisant 45° avec cet axe (
fig. 3
) . Il ne s'agit pas là d'une salle hypostyle, la tranchÃĐe IV en prolongement de la tranchÃĐe III, n'ayant pas rencontrÃĐ de pierres analogues. Il est possible que des lignes de fondations se retrouvent perpendiculairement à partir des pierres extrÊmes, ce que semblerait indiquer leur orientation ; c'est une recherche à faire.
La tranchÃĐe V, comme la tranchÃĐe III a montrÃĐ un remblayage assez hÃĒtif de graviers et de fragments divers ; il a ÃĐtÃĐ recueilli de nombreux fragments de briques ÃĐmaillÃĐes, et un fragment de stÃĻle en pierre avec une inscription pleine de fautes de scribe, au nom d'ArtaxerxÃĻs. Il n'a ÃĐtÃĐ retrouvÃĐ aucune trace de colonnes elles-mÊmes. La profondeur de ces pierres de fondation rend difficile la supposition que la ligne de colonnes put se rapporter au palais ÃĐtabli sur le Niveau 0 ; il est donc probable qu'elle appartenait à un palais plus ancien. (p. 11)
L'extrÃĐmitÃĐ de la tranchÃĐe V à l'Est, rencontra de nombreux vestiges de canalisations en briques cuites jointes au bitume de mÊme style que le rÃĐservoir notÃĐ dans la tranchÃĐe III.
La tranchÃĐe IV rencontra des dallages à 1m50 de profondeur avec une autre orientation que celle du palais.
Fouille du Parvis Central
Voir
plan N° II
Le parvis central ÃĐtait dallÃĐ en carreaux de briques cuites de 0m33 de cÃītÃĐ, et bordÃĐ de murs d'environ 3m65 d'ÃĐpaisseur ; la terrasse de gravier s'arrÊte un peu au-delà , maintenue verticalement par un mur en briques crues montÃĐ dans une fouille pratiquÃĐe dans l'ancien tell ; l'intervalle entre le talus de la fouille et la brique crue est remblayÃĐ par de la terre fine peut-Être ancien mortier.
L'ÃĐpaisseur du gravier à cet endroit doit Être de 11m. Elle est donnÃĐe par un puits creusÃĐ Ã l'angle sud-est de la grande salle adjacente à l'est.
Il n'y avait pas de gravier sous le carrelage ; immÃĐdiatement au-dessous des briques, il fut trouvÃĐ deux coupes de bronze trÃĻs oxydÃĐes avec ornementation florale au repoussÃĐ ; à 0.30 de profondeur on retrouvait dÃĐjà des tombes, avec mobilier de vases funÃĐraires (
fig. 11
) parfois en terre cuite ÃĐmaillÃĐe et des amphores ; et bientÃīt la voÃŧte en partie effondrÃĐe d'un grand caveau funÃĐraire (A,
fig. 12
) . Longueur 5m, largeur 3m - hauteur 3m hors Åuvre - soigneusement construit, orientÃĐ Ã peu prÃĻs est Est-Ouest, magnÃĐtique ; il avait une porte sur la face Est en (p. 12) avant de laquelle ÃĐtait une petite case entourÃĐe de murs (0.87 intÃĐrieur) contenant quelques os de mouton.
L'intÃĐrieur du caveau lui-mÊme renfermait les restes de nombreux individus ; le mobilier de vases en terre cuite avait beaucoup souffert de l'effondrement de la voÃŧte ; on recueillit cependant un vase en pÃĒte blanche ÃĐmaillÃĐe, un cylindre cachet, un petit outil de bronze, une hache polie en roche dure.
Au niveau - 2m - apparurent sur la surface dÃĐgagÃĐe des traces de murs en terre crue entourant une salle carrÃĐe ; les murs furent isolÃĐs et la chambre explorÃĐe soigneusement sans rÃĐsultat apprÃĐciable ; il y avait là peut-Être une chapelle funÃĐraire. Un tombeau voÃŧtÃĐ (B,
Fig. 13 et 14
) en briques cuites (dimension 3m x 2m) fut dÃĐblayÃĐ au Sud-Est : une petite chambre en avant de la porte (Ã l'Ouest cette fois) contenait trois petits vases en terre cuite ; dans le caveau furent reconnus quatre crÃĒnes et recueillis quatre petits vases ovoÃŊdes en terre cuite noirÃĒtre.
Un autre tombeau analogue (D) fut fouillÃĐ Ã peu prÃĻs au mÊme niveau, il contenait deux corps, quelques vases, une bague de bronze (
fig. 17
) . Parmi les nombreux vases funÃĐraires trouvÃĐs dans cette premiÃĻre partie de la fouille, signalons : un vase en poterie jaune enduit intÃĐrieurement de bitume (H.0.39 â D.0.38) fermÃĐ avec une poterie rouge retournÃĐe ; au pied du vase furent recueillis une lame de silex et un nucleus ; à l'intÃĐrieur du vase se trouvaient les restes de deux enfants, et de petits jouets ou ex-voto de terre cuite aussi bien conservÃĐs qu'au sortir du magasin du potier : c'ÃĐtaient trois figurines de femme (p. 13) nue parÃĐe et haut coiffÃĐe tenant ses seins, une figurine de musicien nu et barbu jouant de la viole, et un petit lit à quatre pieds (
fig. 16
) .
Un groupe de cinq vases analogues pourvus de couvercles trouÃĐs à leur sommet ; une petite bouteille ronde en terre cuite ÃĐtait posÃĐe sur l'un de ces trous ; dans un des vases ÃĐtaient les restes de deux enfants sÃĐparÃĐs par un broyeur à grain, et une figurine de terre cuite ; dans un autre, un squelette d'enfant et un petit vase. Non loin, un squelette d'adulte ÃĐtait couchÃĐ sur un lit de brique, et prÃĻs de lui de petits vases de terre cuite, des perles, une perle cachet en pÃĒte, des anneaux de bronze (
fig. 18
) .
Une autre tombe contenait des perles dont 8 en or, deux bracelets en argent, un vase haut en bronze : un grand vase de 0.60 de hauteur et d'ouverture renfermait encore deux crÃĒnes et un bracelet de bronze.
Signalons encore du mÊme niveau, quelques lots de tablettes inscrites (contrats), et la prÃĐsence gÃĐnÃĐrale de pierres polies en forme de hache et de marteaux ; on trouve du reste frÃĐquemment dans les vases funÃĐraires ou à leur pied des cailloux arrondis, galets, paraissant avoir ÃĐtÃĐ des oursins fossiles.
Entre 2 et 4 m de profondeur :
Au-dessous du tombeau voÃŧtÃĐ B, se trouvait un autre caveau C plus petit à peu prÃĻs carrÃĐ (L.l.=1.60) renfermant les restes de deux individus dont un enfant et deux petits vases (p. 14) en terre noire. En allant vers le Nord, on recueillit prÃĻs des vases funÃĐraires de petites roues de char en terre cuite dÃĐcorÃĐes de bonettes (sic) en relief ou de traits en creux ; des amphores, des broyeurs à grains ; enfin un grand sarcophage en poterie en forme de baignoire renversÃĐe, mais dont les parois extÃĐrieures au lieu d'Être lisses comme celles rencontrÃĐes prÃĐcÃĐdemment ÃĐtaient renforcÃĐes par des moulures (
fig. 19
) .
Nous avons cru reconnaÃŪtre deux squelettes à l'intÃĐrieur, sÃĐparÃĐs par un grand morceau de poterie ; au dessous de cette sÃĐparation prÃĻs d'un crÃĒne qui paraÃŪt avoir ÃĐtÃĐ coiffÃĐ d'argent se trouvaient de nombreux vases de bronze, et un miroir de bronze (
fig. 21
) . PrÃĻs du tombeau on trouvait à l'extÃĐrieur une belle hache fondue en bronze, un anneau fondu sans soudure de mÊme mÃĐtal, un petit vase rond en terre cuite, des fragments de tablettes inscrites.
à un niveau un peu plus profond (4m50) on trouvait en bordure orientale de la fouille cinq sarcophages en poterie à peu prÃĻs analogues (M I J K L du plan II) sÃĐparÃĐs par de petits murs en partie construits en briques cuites, dÃĐlimitant des chambres d'environ 3m de dimensions, contenant aussi des vases funÃĐraires ; cette portion ÃĐtait remblayÃĐe sur 1m50 d'ÃĐpaisseur par des casseaux dans lesquels on recueillait des fragments de trÃĻs belle poteries en terre cuite rouge, recouvertes extÃĐrieurement d'un bel enduit rouge foncÃĐ, prÃĐsentant des trous de suspension au sommet des saillies sur la panse. (p. 15)
L'extÃĐrieur de ces sarcophages est dÃĐcorÃĐ de moulures saillantes, et souvent peint au bitume.
Le tombeau M (dimensions : L.l. 1.02-0.60-h.0.40) renfermait un squelette les jambes repliÃĐes : des traces de feuille d'argent furent observÃĐes sur la poitrine ; on recueillit un collier de perles en cornaline, deux boucles d'oreille en argent, un bracelet de bronze, deux grands anneaux de cheville en bronze entourÃĐs d'une ÃĐtoffe.
PrÃĻs du tombeau L, on recueillait des vases de terre cuite, un bracelet de bronze, de petits cylindres de terre crue (H 0.10 â D. 0.05). Le sarcophage (H. 1m- l.0.63) contenait deux squelettes deux bagues de bronze, un vase de bronze.
Le tombeau I (
fig. 24
) la profondeur de 5m80, ÃĐtait plus important : (L .1.71- l. 0.70- h. 0.55) il ÃĐtait posÃĐ sur un lit de carreau de briques ; il fut recueilli à l'extÃĐrieur, une grande pointe de lance ou poignard de bronze, et des vases de mÊme mÃĐtal ; des vases d'albÃĒtre et de bitume, et un plateau de bitume taillÃĐ qui mÃĐrite une mention spÃĐciale
Il est circulaire de 0.28 de diamÃĻtre, avec un rebord de un centimÃĻtre de largeur, dÃĐcorÃĐ de six plaquettes rectangulaires de coquille blanche fixÃĐes chacune par deux clous de bronze à tÊte dorÃĐe ; il est montÃĐ sur trois pieds rapportÃĐs avec tenons fixÃĐs par une ou deux chevilles de bronze ; chaque pied est un bouquetin sculptÃĐ en bitume, les pattes repliÃĐes contre le corps ; celui-ci raccorde au plateau par l'arriÃĻre (p. 16) train, tandis que la poitrine pose à terre, le cou est redressÃĐ et la tÊte droite ; les cornes bien enlevÃĐes vont rejoindre le corps par l'extrÃĐmitÃĐ de leur courbure ; les poils du cou de la barbe sont bien figurÃĐs, de mÊme que les marques de croissance de l'ÃĐtui cornÃĐ ; les yeux sont incrustÃĐs de blanc avec une pupille bleu clair. La hauteur de l'ensemble est de 0.185.
Le travail est plus soignÃĐ que d'ordinaire pour les objets de cette matiÃĻre. Nous attribuons la date de fabrication au moins au XX° siÃĻcle avant note ÃĻre.
Ce prÃĐcieux monument un peu fragmentÃĐ est presque complet (il manque une des plaquettes de coquille) ; il est en voie de rÃĐparation aux ateliers du Louvre.
à l'intÃĐrieur du sarcophage, un squelette ÃĐtait allongÃĐ, il fut recueilli deux bagues, deux bracelets, deux fibules de bronze, une coupe en argent, un vase de bronze.
Le tombeau J (L. 1.06-1.20 - l. 0.60â0.73- h. 0.36,) (
fig. 25
) renfermait un squelette parÃĐ de bagues et bracelets de bronze ; il ÃĐtait entourÃĐ de petits vases en terre cuite, en albÃĒtre et d'objets de bronze.
Le tombeau K (L. 1.40 - l 0.94 â h. 0.70) renfermait un squelette : prÃĻs du crÃĒne ÃĐtait une sorte de double coiffe en argent, on recueillit cinq couvre-seins en argent, deux boucles de bronze ayant chacune une anse formÃĐe par deux mains rejoignant l'anneau principal, de grosses bagues de bronze, deux bracelets en argent, un bracelet en or trÃĻs grossiÃĻrement ciselÃĐ. A (p. 17) l'extÃĐrieur du tombeau se trouvaient des vases de terre cuite et de bronze, nous citerons parmi ceux-ci un grand plateau à deux anses dont le rebord est rapportÃĐ par des rivures sur le fond et dÃĐcorÃĐ au repoussÃĐ.
à 4.80 de profondeur fut trouvÃĐ posant à plat sur le sol au-dessus des restes d'un cheval de forte taille un bandage en bronze d'une roue de char formant un cercle de 1m05 de diamÃĻtre (
fig. 20
) ; il ÃĐtait composÃĐ de six sections. La pÃĐriphÃĐrie demie circulaire en coupe, formait gorge vers l'intÃĐrieur, se prolongeant pour chaque section par trois paire de pattes triangulaires à sommet arrondi de 0.045 de largeur à la base, de 0.095 de longueur ; une paire à chaque extrÃĐmitÃĐ et une paire mÃĐdiane. Les pattes de chaque paire ÃĐtaient reliÃĐes à l'extrÃĐmitÃĐ par un rivet de bronze transversal, avec un ÃĐcartement moyen de 0.03 ; cet ÃĐcartement reprÃĐsente en cet endroit, l'ÃĐpaisseur de la jante en bois de la roue. Il ne subsistait du bois que des traces charbonneuses dans la terre remplissant la gorge.
PosÃĐe en travers du cercle ÃĐtait une tige de bronze courbÃĐe un peu comme la ligne d'ÃĐcriture dit "accolade", avec les extrÃĐmitÃĐs recourbÃĐes en crochet et un anneau ÃĐtait fixÃĐ par un lien au milieu de la tige. D'aprÃĻs les dessins de Rawlinson, ce serait une piÃĻce attachÃĐe à l'extrÃĐmitÃĐ du timon et servant à lier les deux chevaux d'attelage.
Il fut enfin recueilli deux clavette en bronze ; gros (p. 18) clous terminÃĐs chacun par une tÊte fondue en forme de petit hÃĐrisson, dont les touffes de piquants sont remplacÃĐs par de petits cercles en relief ; un trou latÃĐral permet de passer comme dans les clavettes actuelles utilisÃĐes en charronnerie, l'extrÃĐmitÃĐ d'une laniÃĻre pour ÃĐviter que la piÃĻce ne sorte de son logement dans les chaos.
Ces deux piÃĻces sont de la force convenable pour l'usage mais le bandage de jante et le joug dÃĐcrits plus haut ne paraissent pas suffisamment forts pour appartenir à un chariot rÃĐel. Le bandage ne permettrait le roulement que sur un carrelage à cause de sa trop faible ÃĐpaisseur ; une jante de 3 centimÃĻtres d'ÃĐpaisseur paraÃŪt faible pour le diamÃĻtre de la roue ; d'autre part le diamÃĻtre de la tige de bronze recourbÃĐe qui peut Être de cinq à six millimÃĻtres sous l'oxyde, ne permet pas de supposer qu'elle ait servi pour des chevaux, et le lien qui la rÃĐunissait à un anneau, est un simple fil qui bien que faisant plusieurs tours ne pouvait avoir de rÃĐsistance sÃĐrieuse. Si ces objets ont ÃĐtÃĐ utilisÃĐs, ce serait pour un char de parade supportant un faible poids, peut-Être une statuette de divinitÃĐ. MalgrÃĐ cette restriction ces piÃĻces sont fort intÃĐressantes ; ce sont les premiÃĻres du genre trouvÃĐes dans les fouilles de Babylonie et d'Assyrie ; le petit char en bronze à quatre roues connu de Toprak Kaleh, environs de Van, ÃĐtant encore plus simplement reprÃĐsentatif.
Non loin de la roue fut trouvÃĐ un vase funÃĐraire fermÃĐ par une ÃĐcuelle renversÃĐe et renfermant les restes d'un trÃĻs jeune enfant avec trois petits bracelets de bronze et une (p. 19) petite tÊte en pÃĒte calcaire aux yeux incrustÃĐs d'argent avec une pupille bleue ; le front est ÃĐgalement incrustÃĐ d'argent ; cette petite figurine ÃĐtait montÃĐe sur une tige d'argent.
Reposant sur le niveau -7 mÃĻtres, il a ÃĐtÃĐ dÃĐblayÃĐ deux grands tombeaux voÃŧtÃĐs construits en grands carreaux de briques mal cuites, le plus souvent portant les inscriptions du roi Attapaksu pasteur des peuples, se rÃĐfÃĐrant à la dÃĐdicace d'un pont et d'un temple (fig.
22
et
27
) .
PrÃĻs de l'un de ces tombeaux (F) (L. 3.25- l.2m â h. 1.64) on recueillit un vase de bronze, un vase d'argent trÃĻs brisÃĐ, un anneau de bronze ; Ã l'intÃĐrieur, deux grands vases de terre cuite et quelques rares ossements.
Au dessus de l'autre (G) on ramassa des fragments d'os dÃĐcorÃĐs de cercles au trait et qui alternant avec des plaques en bois noir, devaient dÃĐcorer un objet mobilier ; à l'intÃĐrieur du tombeau on trouva calÃĐ avec des briques, une poterie de terre cuite peinte au bitume, analogue à celle des sarcophages dÃĐcrits, mais cette fois, disposÃĐe l'ouverture en haut, et à l'intÃĐrieur quelques restes d'ossements avec traces d'objets en argent.
Le sarcophage prÃĐsentait une particularitÃĐ : à une extrÃĐmitÃĐ ÃĐtait moulÃĐ dans la paroi vers l'intÃĐrieur, un cylindre vertical à trou axial ne dÃĐbouchant pas. La cavitÃĐ fut vidÃĐe sans rÃĐsultat. (
fig. 26
) .
(p. 20) Dans le voisinage des deux tombeaux voÃŧtÃĐs entre le niveaux 4 et 7, il a ÃĐtÃĐ recueilli d'assez nombreuses tablettes inscrites. Quelques-unes ayant la forme d'une grosse lentille portent un texte au recto et au verso. à l'examen du pÃĻre Scheil, ces textes qui remontent à l'ÃĐpoque des rois d'Our, prÃĐdÃĐcesseurs en hÃĐgÃĐmonie du roi Hammurabi, sont d'une part quelques caractÃĻres sumÃĐriens, de l'autre le nom ou prononciation de ceux-ci en babylonien, et à la suite leur signification dans cette mÊme langue. Le nom ou prononciation offrirait des variantes avec les vocabulaires analogues trouvÃĐs en Assyrie donnant les mÊmes caractÃĻres. Ces variations sont d'un ordre tel qu'on ne peut les attribuer qu'à des diffÃĐrences de prononciation, correspondant à divers dialectes du sumÃĐrien qui serait dÃĐcidÃĐment une langue parlÃĐe selon l'opinion d'Oppert contre celle d'HalÃĐvy.
Ajoutons à propos des tablettes trouvÃĐes dans cette fouille souvent en relation ÃĐvidente avec l'inhumation qu'il n'a ÃĐtÃĐ rencontrÃĐ aucun texte funÃĐraire, mais surtout des contrats.
Fouilles de la NÃĐcropole à l'est du terrassement de gravier
Plan N° III
- Le sondage en profondeur commencÃĐ l'annÃĐe prÃĐcÃĐdente en avant de l'angle N. E. de la terrasse de gravier et descendu à 12m80 en contrebas de cette terrasse a ÃĐtÃĐ continuÃĐ et portÃĐ Ã 17 m. de profondeur. Il est probable que l'on est entrÃĐ dans le sol primitif vers 15m40, sans en avoir la certitude. Le niveau aquifÃĐrÃĐ a arrÊtÃĐ le sondage à 17m (fig.
36
et
38
) . (p. 21)
Ce sondage a rencontrÃĐ des tombes avec mobilier de vases en terre cuite (
fig. 34
) et un dÃĐpÃīt de tablettes inscrites, et d'empreintes sur bouchons de jarre de l'ÃĐpoque des rois d'Our, Ã 15 m au-dessous du palais de Darius, il a ÃĐtÃĐ trouvÃĐ un sarcophage en poterie sans moulures, sous lequel ÃĐtaient quelques ossements et une sÃĐbile de bronze (
fig. 37
) .
L'exploration de la nÃĐcropole a ÃĐtÃĐ poursuivie entre le niveau 5 et 8.50 le long du terrassement de gravier ; il a ÃĐtÃĐ trouvÃĐ de nombreuses tombes et dÃĐpÃīts funÃĐraires, parmi lesquels je signalerai deux tombeaux probablement voÃŧtÃĐs en briques crues ; l'un contenait avec les restes de plusieurs individus, un mobilier de vases de terre cuite ÃĐmaillÃĐe, un vase de bronze, de nombreux bracelets de bronze, jusqu'à 14 sur un seul avant-bras, des bagues de bronze, plusieurs fibules tige en fer, à tÊte de bitume recouverte d'argent, avec trace de dÃĐcor guillochÃĐ, une ÃĐpÃĐe, plusieurs poignards et des pointes de flÃĻches en fer ; l'autre contenait de grands vases et des amphores en terre cuite, des vases de terre cuite ÃĐmaillÃĐe, un vase d'argent, des vases de bronze (
fig. 30
) , un peigne et un miroir de mÊme mÃĐtal, des perles de pierre, de pÃĒte et d'or, un pendant d'oreilles filigranÃĐ en or, trois bagues en coquilles recouvertes d'or, un burin en silex taillÃĐ.
Un autre dÃĐpÃīt funÃĐraire contenait une grande quantitÃĐ de dattes carbonisÃĐes par le temps sans doute, une centaine de bracelets de bronze assez frustes, un bracelet d'argent, un (p. 22) peigne en bronze aux dents de fer et traces d'argentures, une fibule à tÊte de bitume recouvert d'argent, des perles d'or à bossettes ou unies. à signaler encore une curieuse statuette en terre cuite ÃĐmaillÃĐe polychrome de 0m28 de hauteur ; la tÊte est coiffÃĐe d'un bonnet, la figure est grimaçante, les mains sont jointes sur la poitrine ; le personnage est vÊtu d'une robe qui ne laisse voir que les pieds (
fig. 35
) . Il a ÃĐtÃĐ ÃĐgalement recueilli des figurines d'hommes et d'animaux en terre cuite ÃĐmaillÃĐe, quelques-unes en pÃĒte blanche ÃĐmaillÃĐe, mais ces derniÃĻres appartiennent surtout au niveau infÃĐrieur de 8.50 Ã 10m qui a ÃĐtÃĐ explorÃĐ pour retrouver la suite de canalisations en briques dÃĐblayÃĐes l'annÃĐe prÃĐcÃĐdente.
L'intÃĐrÊt de cette recherche rÃĐside en ce que les matÃĐriaux de rÃĐemploi comprennent des brique inscrites au nom des rois Silhak et Kutir Nakhunte et des briques à relief parfois inscrites par dessus le motif ornemental. Ces briques à relief sont les ÃĐlÃĐments de panneaux dÃĐcoratifs qu'il n'avait pas encore ÃĐtÃĐ possible de reconstituer.
Les fouilles de la nÃĐcropole en avaient fourni un assez grand nombre en 1913, 1914 et 1921, malheureusement les briques d'un mÊme type ÃĐtaient souvent rÃĐpÃĐtÃĐes sans suffisamment de variÃĐtÃĐ.
Les canalisations furent retrouvÃĐes et fournirent quelques briques nouvelles. à la tÊte de l'un de ces canaux, on explora un dÃĐpÃīt pris dans une sorte de vase charbonneux, contenant avec (p. 23) des briques inscrites et à relief, des vases cylindriques en pÃĒte blanche ÃĐmaillÃĐe à dÃĐcor assyrien et leurs couvercles un long cylindre cachet de mÊme matiÃĻre reprÃĐsentant deux personnages debout buvant sÃĐparÃĐs par un guÃĐridon sur lequel est posÃĐ un grand vase, de nombreux dÃĐbris de vases et figurines de mÊme matiÃĻre des fusaÃŊoles, des plaques circulaires en coquille, percÃĐe d'un trou central, un fragment de plaque en onyx avec caractÃĻre cunÃĐiformes de l'ÃĐpoque de Silhak, une grosse perle d'agate.
Non loin de là , au mÊme niveau, l'on rencontrait un grand dallage orientÃĐ N.S., les carreaux de briques soigneusement posÃĐs sur un lit de sable ; immÃĐdiatement au-dessus, l'on recueillait de nombreuses tablettes et empreintes, des figurines de terre cuite trÃĻs grossiÃĻres. Le dallage semble s'arrÊter au Sud contre un escalier ruinÃĐ, de ce cÃītÃĐ l'on dÃĐcouvrit deux exemplaires d'une nouvelle brique à reliefs.
Ce nouvel apport de briques à reliefs fait au Louvre, joint aux prÃĐcÃĐdents nous a permis de reconstituer trois motifs de dÃĐcoration et leur frise (
dessin
) .
Le sujet le plus certainement reconstituÃĐ est l'homme taureau, auquel il manque une brique pour Être complet, la liaison du cou aux ÃĐpaules. Le personnage debout est de face jusqu'au-dessous de la poitrine, plus bas il est de profil. Il est coiffÃĐ d'une mitre à cornes comme les taureaux à face humaine de Khorsabad. Le visage est humain à l'exception des oreilles qui sont celles d'un animal mais stylisÃĐes. (p. 24)
Un deuxiÃĻme est une sorte de sphynx ; la coiffure manque, la face est mutilÃĐe à l'exception des oreilles, cette fois nettement humaines ; les avant-bras se terminent sur la poitrine par des mains rudimentaires ; le bas du corps se perd dans une demie colonne engagÃĐe.
Le troisiÃĻme sujet est une sorte d'arbre, palmier ou cocotier au feuillage raide figurÃĐ par les seules nervures. Au-dessous de la naissance des feuilles, pend de part et d'autre un fruit arrondi ; un bras droit se dÃĐtache de l'arbre et la main revient en saisir le tronc, qui prÃĐsente les rugositÃĐs classiques de celui du palmier.
La frise a ÃĐtÃĐ reconstituÃĐe avec les trois types de briques d'ornement recueillis. C'est un motif purement gÃĐomÃĐtrique.
Nous avons ÃĐtÃĐ aidÃĐs dans la reconstitution parce que dans chaque motif il se trouve un ÃĐlÃĐment portant parfois une inscription sur le relief lui-mÊme, et toujours sur le mÊme, et en tenant compte de ce que cette inscription devait toujours Être à la mÊme hauteur dans le mur.
Le Louvre possÃĻde dÃĐjà une douzaine d'exemplaires de quelques briques de chaque motif, il en existe d'autres à Suse, il s'agit donc d'un mur dÃĐcorÃĐ par la rÃĐpÃĐtition frÃĐquente des trois sujets.
Les inscriptions appartiennent à deux rois diffÃĐrents se retrouvant l'une ou l'autre pour chacun des motifs. L'une du roi Kutir Nakhunte :
"Moi Kutir Nakhunte, fils de Sutruk Nakhunte, rejeton "chÃĐri d'Insusinak, du "Kumpum" le "Kidu" en briques crues (p. 25) avait ÃĐtÃĐ construit et je relevais sa ruine et en briques cuites je le reconstruisis et le vouai à Insusinak, mon dieu. O Insusinak mon dieu, mon travail et mon oeuvre, garde le à jamais et ce que j'ai fait protÃĻge-le."
Il s'agit sans doute du sanctuaire au dieu Susinak que Choutrouk Nakhunte, pÃĻre de Kutir avait fait en briques cuites et dont Kutir restaura l'enceinte qui avait ÃĐtÃĐ ÃĐlevÃĐe prÃĐcÃĐdemment en briques crues.
L'autre inscription est de Silhak, frÃĻre et successeur du prÃĐcÃĐdent :
"Moi Silhak in Susinak, fils de Shutruk Nahhunte roi d'Anzan et de Susiane, mon frÃĻre Kutir Nakhunte avait fait une dÃĐcoration de bas relief en terre cuite pour le temple de In Susinak et ne l'avait pas achevÃĐe, moi je l'ai achevÃĐe et l'ai vouÃĐe à In Susinak, mon dieu. O In Susinak etcâĶ"
Notons que le temple de In Shusinak fut modifiÃĐ par les fils du roi Silhak et reconstruit à nouveau par Shutruk Nakhunte II et Hallutus. Rien d'ÃĐtonnant dÃĻs lors à ce que les dÃĐcorations assez grossiÃĻres de Silhak aient ÃĐtÃĐ remplacÃĐes par les dÃĐcors en pÃĒte ÃĐmaillÃĐe, et que les anciens matÃĐriaux en briques cuites aient ÃĐtÃĐ utilisÃĐs pour les nouvelles substructions.
Les inscriptions prÃĐcÃĐdentes sont anzanites, c'est-à -dire dans la langue non sÃĐmitique de la rÃĐgion de Suse ; comme la grossiÃĻretÃĐ de la facture et les reprÃĐsentations elles-mÊmes (p. 26) diffÃĐrentes du rÃĐpertoire dÃĐcoratif babylonien nous le faisait prÃĐvoir, nous avons devant nous un produit de l'effort ÃĐlamite.
Au Nord Est du terrassement du palais (
fig. 39
) , l'exploitation de la NÃĐcropole a donnÃĐ d'intÃĐressants rÃĐsultats ; entre 5.50 et 7.50, terrassement en terre pilÃĐe ; au-dessus, tombes avec mobilier de vases funÃĐraires ; à l'Est de la fouille poterie assez nouvelle : grands vases à larges cols avec anse et goulot, vases plus petits assez ÃĐlancÃĐs ; sur les uns et les autres enduit ou peinture rouge vif.
Plus prÃĻs du palais, le niveau 2.50 a donnÃĐ de nombreux tombeaux en forme de "baignoires renversÃĐes" sans moulure, contenant de un à deux squelettes, avec des vases de terre cuite comme mobilier, souvent une sÃĐbile de bronze dans laquelle plongeait parfois les mains, des bracelets, des anneaux de bronze, quelques traces d'argent ; autour de ces tombes de grands vases funÃĐraires contenant des ossements, parfois le squelette est trouvÃĐ recouvert de grands fragments de plusieurs vases analogues (fig.
40
Ã
44
) .
Il a ÃĐtÃĐ observÃĐ au pied de ces vases, quelques reprÃĐsentations plus ou moins grossiÃĻres de tÊte humaine, parfois simplement en terre grossiÃĻrement colorÃĐe. Il a ÃĐtÃĐ ÃĐgalement dÃĐblayÃĐ prÃĻs des groupes de tombes, deux plateformes en terre moulÃĐe, enduite de bitume avec des rigoles conduisant à un trou vertical percÃĐ au-dessus d'un petit vase enterrÃĐ, et de (p. 27) petites cuvettes ; il s'agit sans doute d'une sorte d'autel pour un sacrifice ou un repas rituel.
Cette fouille a ÃĐgalement fourni quelques tablettes.
Fouilles à l'est de la butte de l'Apadana
Il a ÃĐtÃĐ exÃĐcutÃĐ des travaux immÃĐdiatement en arriÃĻre de la muraille achÃĐmÃĐnide bordant à l'Est le tell de l'Apadana, provoquÃĐs par l'affleurement à la suite de pluie, d'un pan de muraille renfermant des briques ÃĐmaillÃĐes achÃĐmÃĐnides à dÃĐcor floral. Il s'agissait de fondations d'une construction musulmane, il a ÃĐtÃĐ retrouvÃĐ dans ces explorations, une grande dalle en calcaire blanc (L. 2.50 - l. 1m e. 0.30). Une de ses extrÃĐmitÃĐs ÃĐtait fruste sur une longueur de 0m50, bien que sa longueur ait ÃĐtÃĐ diminuÃĐe au marteau pour une implantation verticale, l'autre extrÃĐmitÃĐ est arrondie, une des grandes faces est polie avec un champ levÃĐ laissant en relief une bordure et un grand dard traversant obliquement le fond, dirigÃĐ vers la terre dans la position verticale de la pierre ; nulle inscription, c'est une stÃĻle funÃĐraire, probablement d'ÃĐpoque grÃĐco-parthe, c'est pour nous "la stÃĻle au guerrier inconnu" (
fig. 45
) .
Il a ÃĐtÃĐ encore trouvÃĐ au mÊme endroit de nombreux fragments de dÃĐcors floraux en terre cuite, un lot de pointes de flÃĻches et de piques en bronze, des fragments de statuettes en bronze.
Non loin de là dans des ruines musulmanes, on trouva une dalle en calcaire blanc portant sur l'ÃĐpaisseur à une extrÃĐmitÃĐ un svastika sculptÃĐ en creux ; symbole rare à Suse. (p. 28)
Il fut dÃĐblayÃĐ au niveau infÃĐrieur quelques dallages achÃĐmÃĐnides, et un escalier voÃŧtÃĐ de construction musulmane, descendant sans doute dans un "serdab" ou cave fraÃŪche (
fig. 46
) . On retrouva dans ce dÃĐblaiement une jolie lampe en bronze, probablement grecque. Le rÃĐcipient est fermÃĐ par un couvercle à charniÃĻres reprÃĐsentant une coquille, et l'anse se recourbe pour se terminer par un masque humain. à citer ÃĐgalement un grand nombre de figurines de terre cuite reprÃĐsentant des bovidÃĐs avec ou sans bosse.
Au niveau infÃĐrieur (5 à 7.50), on trouva des vases en terre cuite, aux cols hauts et longs, des vases hauts galbÃĐs vers l'intÃĐrieur et à la base de la tranchÃĐe on retrouva le niveau à objets en pÃĒte blanche ÃĐmaillÃĐe, comme plus prÃĻs du palais au mÊme niveau.
RÃĐsumÃĐ des rÃĐsultats gÃĐnÃĐraux
Nous comprenons à prÃĐsent comment fut ÃĐtabli le terrassement qui servit de base au palais des rois achÃĐmÃĐnides.
Il existait primitivement sous le tell de l'Apadana une ÃĐminence naturelle qui fut choisie par les habitants de Suse comme un des centres principaux d'inhumation au moins vers l'ÃĐpoque de Hammourabi. L'habitude d'enterrer les morts soit dans des poteries, soit dans des caveaux funÃĐraires en briques crues et en briques cuites donna lieu à un apport incessant de matÃĐriaux. Les intempÃĐries dÃĐgradant les constructions en briques crues les plus nombreuses, l'argile entraÃŪnÃĐe noya les tombes les plus (p. 29) rÃĐsistantes et il en rÃĐsulta la formation d'un tell allongÃĐ de l'Est à l'Ouest.
Le souverain achÃĐmÃĐnide qui eut le premier l'idÃĐe de construire à Suse et il semble bien que ce soit Darius, puisque ses inscriptions ne mentionnent pas ses prÃĐdÃĐcesseurs, fit raser la colline à la hauteur choisie pour base à son palais, et entourer d'une muraille en terre crue, la surface qu'il voulait transformer en terre plein ; les vides furent comblÃĐs avec du gravier, et sur la terrasse obtenue fut tracÃĐ le plan de l'ÃĐdifice ; pour assurer la soliditÃĐ des parties bÃĒties, on fit des fouilles à leur emplacement pour les combler ensuite avec du gravier ; les terre extraites furent employÃĐes à faire du mortier du boue pour les murs et rentrÃĻrent dans les constructions ou furent ÃĐvacuÃĐes pour faire une enceinte aux jardins du Nord.
Travaux sur le tell de l'Acropole
L'Acropole comme l'indique notre rapport de 1919, a ÃĐtÃĐ occupÃĐ pendant la guerre par un escadron de Cipayes qui y construisit des baraquements nombreux. Ceux-ci privÃĐs de toit et de boiseries ont servi de carriÃĻres pour les gens du pays et tombent peu à peu en ruines En fin de saison, nous avons fait procÃĐder à un nettoyage de la plate forme au voisinage du chÃĒteau. Ce travail a fourni quelques tablettes protoÃĐlamites et venant d'un puits, un beau fragment d'un buste grÃĐcoparthe en terre cuite, la tÊte manque, mais les seins et les ÃĐtoffes sont d'un dessin trÃĻs beau ; cette terre cuite ÃĐtait peinte en bleu tendre, mais la couleur pulvÃĐrulente disparut dÃĻs l'exposition à l'air, ne subsistant que dans les creux les plus profonds.
(p. 30) Travaux à la Ville Royale
Profitant des indications fournies par les ÃĐrosions nouvelles aprÃĻs les fortes pluies d'automne, il a ÃĐtÃĐ recueilli quelques tablettes inscrites, et explorÃĐ quelques tombes au pied du "donjon". Pour l'une d'elles, le crÃĒne ÃĐtait posÃĐ sur un carreau de brique cuite accompagnÃĐ d'une tablette inscrite et de quelques petites ÃĐcuelles à bord plat.
Travaux au nord de Suse
à trois kilomÃĻtres environ au Nord de Suse, sur le bord du Chaour, se trouvent plusieurs buttes artificielles dont le nom en groupe est "Douecya" ; l'une de ces buttes est ÃĐcornÃĐe par la riviÃĻre et depuis longtemps nous avions ramassÃĐ sur les pentes des fragments de la poterie fine et peinte du niveau infÃĐrieur de Suse.
Il a ÃĐtÃĐ fait dans ce petit tell plusieurs essais de tranchÃĐes qui ont montrÃĐ que le noyau en ÃĐtait un terrassement en terre pilÃĐe, entourÃĐ de tombes à mobilier de vases peints analogues à ceux de Suse ; il n'a pas ÃĐtÃĐ recueilli de vases entiers, mais de nombreux fragments dont les plus intÃĐressants donneront lieu à une ÃĐtude, quelques fragments aussi de petits cornets de terre cuite, sans doute pots à fards et quelques petits animaux en terre cuite peinte. Au niveau supÃĐrieur il a ÃĐtÃĐ retrouvÃĐ des tombes parthes.
Ahwaz
En repassant à Nasseri nous nâavons pas manquÃĐ de faire une visite aux ruines dâAhwaz, toujours exploitÃĐes comme carriÃĻres pour la construction de nouvelles maisons. Dans les fouilles les plus profondes à une douzaine de mÃĻtres de la surface nous avons constatÃĐ la prÃĐsence de carreaux en briques cuites de dimensions utilisÃĐes jusque sous les AchÃĐmÃĐnides.
Nous avons constatÃĐ ÃĐgalement dans la premiÃĻre colline au Nord de Nasseri, prÃĻs des anciennes carriÃĻres utilisÃĐes ensuite par les MazdÃĐens pour lâexposition des corps aux bÊtes de proie, des tombes creusÃĐes dans le rocher et recouvertes de dalles.


 veuillez patienter...
veuillez patienter...